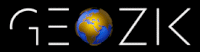- GeoZik
- DOCUS
- KITS
- La musique dans tous ses états
- La voix dans tous ses états
- La danse dans tous ses états
- Le théâtre dans tous ses états
- La littérature orale dans tous ses états
- Archéomusicologie
- Archéochorégraphie
- Instruments du monde
- Matériaux
- Facture instrumentale
- Orchestres
- Communication
- Géographie
- Religion
- Enfance
- Musicothérapie
- Patrimoine UNESCO
- Techniques et modes de vie
- CONF-EXPO
- BLOG
- CONTACT

Mali - Parole d'ancêtre Dogon 1/2
Les Dogon du Mali ont été rendus célèbres en Occident par Marcel Griaule puis, après lui, sa fille Geneviève Calame-Griaule et Germaine Dieterlin. Dans leur lignée, Patrick Kersalé a, dès 1993, publié le premier CD de musique dogon puis un second en 1996. Il a par la suite publié le livre-CD “Parole d'ancêtre Dogon - L'écho de la falaise” republié ici sous forme numérique.
Le collectage de l'ensemble des présents récits a été réalisé par le Dogon Zakari Saye entre 1997 et 2000.
Ce KIT permet, à travers la littérature orale des Dogon, de lever le voile sur leur quotidien et de découvrir par exemple que le nom de leur dieu unique prend sa source dans l'Égypte pharaonique !
© Zakari Saye & Patrick Kersalé 1993-2024. Dernière mise à jour : 9 septembre 2024.
SOMMAIRE
. Le hogon et son esclave
. L’orpheline et sa marâtre
. L'hyène et le lièvre
. Le respect de la parole
. Quatre orphelins et une culotte
. L’âne et le rhinocéros
. L’histoire des dix filles
. L’homme incestueux
. Dieu et le lièvre
. L’origine d’Amma
. Le respect des fétiches
. Les animaux de la brousse organisent une lutte
. Les deux chasseurs et les mauvais génies
. Le retour des femmes
. Le crocodile et le chien
. Les deux marchands de mil
. Une mère, sa fille et la fille de sa coépouse
. Le péteur et le malin
. L'hyène, ses enfants et les animaux de la brousse
. L’enfant et le roi
. Le mariage traditionnel
. Pourquoi le chien vit-il au village ?
. Pourquoi dieu ne parle-t-il plus aux hommes ?
. Le tambour enchanté
. Yassama
. Le lièvre tombe dans son propre piège
. Pourquoi les hommes dirigent-ils le monde ?
. Pourquoi le cheval ne parle-t-il pas ?
. Le hogon et le malin
. Le point fort de Yalè
. L’éléphant, l’autruche et le lièvre
. Pourquoi la kola est le symbole du mariage ?
. Le fils du caméléon
. Il ne faut jamais être jaloux de son prochain
. Pourquoi l’âne vit-il au village ?
. L’enfant unique n’est pas toujours aimé
. Yabémou chez le devin du Renard pâle
. Le lièvre et le vautour
. Pourquoi certaines familles ne mangent pas de lion ?
. Deux jeunes hommes à la recherche de femmes
. Pourquoi la tortue a-t-elle le dos quadrillé ?
. Pourquoi le chien vit-il parmi les hommes ?
. Pourquoi faut-il avoir beaucoup d’enfants ?
. Le chat renoue avec la coutume
. Amaga l’orpheline
. Le juste partage de l’amour
. L’histoire de Yassène
Chantefables (textes et audio)
. Le poisson guérisseur
. L’oiseau insatiable
. Le tamarinier
. Le pou
. Les trois idiots
KIT associés
PISTES PÉDAGOGIQUES
- Lecture. Silencieuse ou à haute voix.
- Lecture et écoute simultanée. Le chapitre « Chantefables (textes & audio) » permet une expérience inouïe : lire le texte en français et l'écouter simultanément en langue dogon.
- Thématiques. Sélectionnez une thématique dans le chapitre « Caractéristiques culturelles » et recherchez le mot correspondant dans le KIT. Croisez les divers textes répondant à vos critères s'il en est et étudiez les similarités. Par exemple, le “lièvre” : que/qui représente-t-il, quels sont ses traits de caractères…
- Origine religieuse. Découvrez, dans un des textes, l'origine du dieu unique des Dogon.
- Allez plus loin avec les Éditions Lugdivine.
Avant-propos
Ce KIT présente des récits de la tradition orale des Dogon du Mali.
L’Afrique subsaharienne, bien que ne possédant pas de littérature écrite, n’en détient pas moins un riche patrimoine de littérature orale. Transmise de génération en génération verbalement ou par l’intermédiaire des tambours. Même si elle véhicule des éléments de connaissance remontant à des temps immémoriaux (parfois plus de deux millénaires !), chaque nouvelle situation politique, économique ou événementielle, contribue à l’enrichir, tel le récit de ce KIT : L’enfant unique n’est pas toujours aimé. Contes, légendes, mythes, épopées, énigmes, devinettes, charades, proverbes, chansons, chantefables, prières, incantations... autant de qualificatifs susceptibles de désigner la variété de ses formes.
Chaque type de littérature est dévolu à une ou plusieurs fonctions et leur transmission spatio-temporelle est strictement codifiée par la tradition. Qu’il s’agisse d’éduquer, de jouer, d’initier, de rendre la justice, d’invoquer les esprits, de rendre hommage, d’entraîner la mémoire, il est toujours un texte adapté, appartenant à ce gigantesque patrimoine.
Cette littérature, collectée auprès des hommes et des femmes de savoir, nous dépeint divers traits de la société dogon en particulier, par extension de l’Afrique occidentale et, plus largement encore, de l’Afrique subsaharienne.
Exceptionnellement dans le monde de la littérature orale, chaque texte est nommément attribué au narrateur-source.
Les Dogon

Le pays dogon
Les Dogon expriment la vitalité de leur peuple à travers ce proverbe éloquent : « dᴐgᴐnɛ́ tɔ̀gu dɔ̀gᴐ i: mìne-nɛ tɛ́sɛ ɑŋɑ́y - Le peuple dogon est comme l’herbe qui pousse sur la Terre[1]».
Les Dogon représentent environ 3 % de la population du Mali (env. 550 000 âmes). Quelques villages se situent également en territoire burkinabè. Ils vivent dans la zone Sud de la bande sahélienne au sud-est de Mopti, dans les cercles de Bandiagara, Koro et Bankass, près de Douentza et, au Burkina Faso, au nord-ouest de Ouahigouya.
Le pays Dogon est séparé en deux par la falaise de Bandiagara longue de 200 km. On considère généralement trois zones d’habitat : le plateau, la falaise et la plaine.
Les Dogon dans l’histoire
Selon la tradition orale, les Dogon, refusant de se convertir à l’islam, auraient quitté le Mandé vers le XIIe s. Après avoir longé le fleuve Niger, ils se réfugièrent dans les falaises de Bandiagara où ils s’installèrent peu à peu entre le XIIIe et le XVe siècle.
La langue dogon
Les Dogon parlent des dialectes différents en fonction de leur situation géographique ; parmi les plus importants par rapport au nombre de locuteurs : tómo kɑ̃̀ (région de Ningari), jɑ́msɑj (région de Koro), dono sɔ̀ (région de Bandiagara), tɛngu kɑ̃̀ (région de Bankass), tɔ̀rᴐ sɔ̀ (région de la falaise). Des variantes dialectales existent également en fonction des villages.
Les Dogon et la littérature orale
Comme tous les peuples de la Terre, les Dogon détiennent de nombreuses formes de littérature orale. Pour ce qui concerne les types de textes représentés dans cet ouvrage, ils distinguent : les contes ordinaires (élumɛ sɑ́lɑ), les contes d’animaux (ólunɑ̀mɑ élumɛ), les chantefables (élumɛ nì:), les devinettes (élumɛ tà:nie). Raconter des contes se dit élumɛ élumɛ et deviner une devinette élumɛ kú: íe:, soit littéralement : “voir la tête de la devinette”.
________________
[1] D'après G. Calame-Griaule. Dictionnaire dogon.
Caractéristiques culturelles
Afin de vous guider pour exploiter au mieux ce riche patrimoine de la littérature orale des Dogon, nous avons listé ci-après, par catégorie, un certain nombre d’éléments caractéristiques contenus dans les récits.
Aliments : arachide, bière de mil, bouillie de mil, crème de mil, datte, fonio, fruit de baobab, igname, jujube, kola, mil, oseille de Guinée, piment, potasse, riz, sel, tamarin.
Animaux domestiques : âne, chameau (dromadaire), chat, chèvre, chien, coq, mouton, pintade, taureau, vache.
Arbres : baobab, dattier, figuier, jujubier, karité, nèrè, rônier, tamarinier.
Architecture : case, grenier, grand abri (tógu nà), mosquée.
Entités spirituelles : Amma (Dieu suprême), génie, Nommo (génie d’eau).
Insectes : abeille, mouche, pou.
Instruments de musique : sifflet, tambour en calebasse, trompe de terre.
Jeux : kintaa, lutte.
Lieux : falaise de Bandiagara, forêt de Omna, France, La Mecque.
Mammifères[1] : antilope, chacal, écureuil, éléphant, gazelle, hyène, lièvre, lion, ours, panthère, porc-épic, renard, rhinocéros, singe, souris.
Oiseaux : aigle, autruche, corbeau, épervier, vautour.
Reptiles : caméléon, cobra, crocodile, salamandre, tortue.
Maladies : goitre, lèpre.
Matières précieuses : cauris, or.
Objets et matériaux divers : sac en peau de chèvre, poix.
Personnages fonctionnels : berger, chasseur, commandant (chef de cercle), cultivateur, devin, féticheur, forgeron, Hogon, imam, pêcheur.
Prénoms de femmes : Godié, Ogohiré, Sami, Wagousserou, Yabémou, Yabogo, Yalè, Yamalou, Yana, Yapèrou, Yassaï, Yassama, Yassène, Yatanou, Yati, Yatimé, Yèsama, Yètimè.
Prénoms d’hommes : Adiè, Alè, Amaga, Amaïguéré, Amassagou, Amassom, Amayoko, Ampilema, Anaye, Ansama, Antanou, Assè, Assolou, Atanou, Ati, Atimé, Baseren, Dianviré, Djonjoro, Lèdou.
Ustensiles de cuisine : calebasse, canari, gourde en calebasse, meule, mortier, pilon, spatule.
Villages : Arou, Binsoy, Kangnin, Kondo, Koundou, Omo, Pèguè, Téréli.
_______________
[1] La plupart de ces mammifères ont aujourd’hui disparu du pays dogon, exterminés par la chasse ou ayant migré vers des zones méridionales plus arrosées.
Contes
Le hogon et son esclave, par Togo Ousmane. Guéourou
Il était une fois un hogon très riche qui avait acheté plus de mille vaches ainsi qu’un jeune esclave pour les garder. Un matin de bonne heure, alors que le petit captif accompagnait le troupeau au pâturage, il aperçut devant lui une fille belle, très belle, plus belle que toutes celles qu’il avait jamais rencontrées. Il se mit aussitôt à trembler. La jeune beauté s’approcha et demanda :
— Pourquoi trembles-tu ?
— Je n’ai, de ma vie, jamais vu plus belle fille que toi.
— Ce n’est pas une raison pour trembler ainsi ! Si tu m’aimes, je resterai avec toi.
— Je t’aime plus que toutes les créatures de ce monde ! s’écria le jeune berger qui ne s’attarda pas plus longtemps en brousse.
Ils rentrèrent ensemble au village avec le troupeau. Tout le monde les regardait. Lorsqu’ils arrivèrent devant la maison du hogon, celui-ci n’avait d’yeux que pour la jeune fille. Comme il commençait à trembler, celle-ci lui demanda :
— Pourquoi trembles-tu ainsi ?
— Je t’aime. Tu es mille fois plus belle que mes femmes, répondit le hogon.
— Je vous remercie pour votre compliment. Puisqu’il en est ainsi, je reste chez vous.
Le hogon tourna la tête vers son esclave et le regarda de curieuse manière. Ce dernier prit aussitôt la parole :
— Vous êtes mon maître, je respire grâce à Dieu et à vous-même. Tout ce que vous ferez pour moi me satisfera.
— Bien mon esclave, répondit le hogon, prends la moitié de mon troupeau.
Puis le sage ajouta :
— Comme nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins, je ne célébrerai pas seulement la cérémonie selon la coutume, je veux que tous partagent ma joie[1].
Il envoya aussitôt un enfant chercher l’imam à la mosquée. Lorsque ce dernier arriva chez le hogon, il aperçut à son tour la jeune fille et se mit à trembler. La jeune beauté lui demanda :
— Pourquoi trembles-tu ainsi devant moi ?
— Je t’aime. Tu es plus belle que ma mère, ma tante et ma sœur, répondit l’imam.
— Puisqu’il en est ainsi, je viens chez toi, continua la jeune fille.
L’imam l’entraîna chez lui. Dès le lendemain matin, ils partirent ensemble chez le commandant[2] pour célébrer le mariage civil. Lorsque le fonctionnaire vit la jeune fille, il se mit à trembler.
— Pourquoi trembles-tu ainsi ? demanda la jeune beauté.
— Je t’aime. Tu es plus belle que toutes les femmes qui ont vécu, qui vivent et vivront sous mon toit.
— Alors je viens chez toi, répondit la fille.
Aussitôt le commandant donna ordre à sa garde de faire disparaître l’imam. Mais la fille protesta en s’adressant elle-même au garde :
— Va d’abord chercher le hogon et son esclave !
Ainsi fut fait.
Lorsque tous furent auprès d’elle, elle proposa un marché :
— Voilà. Afin de vous départager, nous allons faire une course ; celui qui m’attrapera pourra rester avec moi.
Les quatre prétendants acceptèrent la proposition et prirent place sur la ligne de départ. La fille les devançait d’un pas. Lorsque le signal fut donné, tous s’élancèrent. Après avoir parcouru quelque distance, le commandant s’affala.
Tout en continuant sa course, la jeune fille le remercia. Ravis de s’être débarrassés d’un concurrent, les trois autres protagonistes continuèrent leur course effrénée.
La fille était toujours en tête quand l’imam au grand boubou blanc hurla de douleur et s’écroula à son tour. Elle le remercia de l’avoir aimée. Peu de temps après l’imam, le hogon épuisé tomba et pleura d’avoir perdu une si belle fille. Le jeune esclave, quant à lui, continuait sa course. Lorsque le soleil atteignit le zénith, le captif et la fille couraient encore. Quand le soir vint à leur rencontre, la jeune beauté était toujours en tête. Elle redoubla alors d’efforts et leva les bras en disant :
— Mon ami, je ne suis pas de ce monde. Je prie Dieu qu’il te rende tout ce que tu as fait de bon. J’appartiens à l’univers de la beauté et nul ne peut s’en saisir !
Et la jeune fille disparut comme elle était venue.
Moralité : l’homme ne doit pas s’attacher au monde des apparences.
______________
[1] Bien qu’animiste, le hogon souhaite aussi inviter les musulmans et les chrétiens à ses festivités. Aujourd’hui, de plus en plus de Dogon continuent à se convertir à l’une ou l’autre de ces deux religions.
[2] Chef de cercle. Le pays dogon est administrativement divisé en trois cercles : Bandiagara, Koro et Bankass pour la partie se trouvant au Mali.
Fête des semailles búlu
La fête des semailles búlu est célébrée au solstice d’été. C’est un moment important du calendrier dogon. Cette pièce est interprétée avec deux tambours gòmbòy et deux flûtes kelé.
Tambours et flûtes se substituent au langage parlé. Parole des tambours : « Dansez les jeunes, dansez les jeunes ». Parole des flûtes : « Salut nos beaux-parents. Nous venons. Ouvrez la porte. Le repas se trouve-t-il dans la maison ou dans la cour ? » Cette dernière parole est justifiée par le fait que lors du búlu, les jeunes gens vont de maison en maison saluer les prêtres, le hogon, le patriarche de la famille et les beaux-parents.
Lieu : Mali, vill. d’Iréli. Durée : 02:56. © Patrick Kersalé 1993-2024.
L’orpheline et sa marâtre, par Saye Yassama. Téréli-Sodangha
Dans le village de Binsoy[1], une fille nommée Yatimé avait perdu sa mère à l’âge de cinq ans. Depuis, elle était élevée par sa marâtre. En grandissant, elle devenait la plus belle et la plus souriante des jeunes filles du village, mais sa tutrice était tellement jalouse, qu’elle décida de la maltraiter.
Un jour où Yatimé faisait la vaisselle, elle fit tomber à terre une spatule. Sa marâtre lui dit :
— Maladroite que tu es, ramasse cette spatule et va la laver à la mare aux crocodiles[2], au village des mauvais génies !
— D’accord, répondit la jeune fille en souriant.
Elle prit la spatule et s’en alla la laver à la mare. Chemin faisant, elle rencontra un berger. Elle s’adressa à lui avec déférence :
— Bonjour mon frère. Peux-tu me dire où se trouve la mare aux crocodiles ?
— Bonjour belle sœur, répondit le berger, tu en es très loin, mais ce chemin t’y mènera.
Yatimé continua sa route. Dans les montagnes, elle découvrit une mare et s’en approcha. Se trouvait là une vieille femme qui lavait ses calebasses. Elle s’adressa à elle poliment :
— Bonjour grand-mère, est-ce bien la mare aux crocodiles ?
— Malheureusement pour toi, petite, tu n’es pas encore arrivée. À te voir ainsi, tu dois être affamée. Prends un peu de cette bouillie de mil[3] et que Dieu te conduise jusqu’à la mare, dit la vieille femme pour l’encourager.
Yatimé la remercia et continua son chemin.
Elle se trouvait maintenant seule au milieu des grands arbres. À la nuit tombée, elle s’installa au pied d’un arbuste dans la forêt d'Omna[4].
Le lendemain matin, elle reprit sa route et, vers midi, arriva enfin à la mare. Elle se mit à chanter.
Ô vous les dieux de cette mare
Je viens laver ma spatule
Ô vous les plus puissants de ce monde
Aidez-moi, pauvre petite orpheline.
Juste après son incantation, trois vieux[5] sortirent de la mare et lui dirent :
— Nous acceptons ta requête. Lave ta spatule. Nous savons que tu es pauvre. Aussi, accepte tous les biens de ce monde. Prends ces animaux domestiques, ces vêtements, ces ustensiles de cuisine et ces cauris. Ne t’inquiète pas. Tous ces biens te suivront jusque chez toi. Cependant, nous te donnons un commandement : ne regarde pas derrière toi jusqu’à ton arrivée, sinon tous ces biens disparaîtront.
La jeune fille accepta de respecter la règle et prit le chemin du retour. Tandis qu’elle continuait sa route sans dormir, les présents des trois vieux la suivaient. Vers la huitième heure du second jour, elle arriva au village avec ses biens. Tous les villageois, à l’exception de sa marâtre et de sa fille, sortirent pour l’accueillir avec des chants habituellement réservés aux seuls rois et reines. Arrivée dans sa famille d’adoption, Yatimé remit la spatule à sa propriétaire.
Une semaine plus tard, la marâtre et sa fille, rongées par la jalousie, décidèrent de tenter la même expérience que Yatimé. La fille fit tomber la même spatule. Sa mère l’autorisa à partir vers la mare aux crocodiles pour la laver. Elle se mit en route. Comme l’orpheline, elle aperçut tout d’abord le berger, mais passa sans le saluer. De même, elle rencontra la vieille femme à la mare au milieu les montagnes. Avec insolence, elle lui demanda :
— Eh toi, la vieille, c’est ici la mare aux crocodiles ?
Comme la femme ne répondait pas, la fille l’insulta avant de continuer son chemin. Arrivée enfin à la mare aux crocodiles, elle s’exclama avec impertinence :
— Je suis venue laver ma spatule !
— D’accord, répondirent les trois vieux.
Ils lui offrirent les mêmes biens et lui donnèrent le même commandement. La fille accepta et prit le chemin du retour. Malheureusement, à l’entrée du village, elle se retourna pour regarder les biens et vit sortir un gros serpent qui l’avala.
Les jours passèrent et la marâtre ne voyait pas réapparaître sa fille. Personne, toutefois, ne partit à sa recherche.
L’orpheline devint la jeune fille la plus riche du village et continua malgré tout à aimer sa marâtre.
« Depuis lors, les gens comprirent qu’il ne fallait pas traiter les orphelins avec mépris et laisser le sentiment de jalousie envahir le cœur. »
____________
[1] Village de la plaine.
[2] En pays dogon, le crocodile (ɑ̃́yō) (Crocodilus niloticus) est un animal sacré. Il peuple aujourd’hui encore quelques cours d’eau et mares. Celle de ce récit se trouverait aux pieds du village de Téréli.
[3] sɑ́gu jɑ́. Épaisse bouillie de mil communément appelée to en bambara. Aliment de base des Dogon et de la plupart des populations d’Afrique de l’Ouest, il est accompagné de sauce confectionnée avec diverses plantes : gombo, feuilles de baobab, oseille de Guinée…
[4] Autrefois située à l’est du village de Téréli.
[5] En Afrique, les termes “vieux, vieille” désignent respectueusement les hommes et les femmes âgés.
Chant de bienvenue
Chant en l’honneur du grand prophète et chanteur Ambiré. Quand il se rendait dans un village, les gens voulaient le rencontrer, lui tendre la main. Ce même chant est ici interprété en l’honneur des invités. Il est accompagné d'une timbale en calebasse barba.
Lieu : Mali, vill. Téréli. Durée : 03:54. © Patrick Kersalé 1993-2024.
L'hyène et le lièvre, par Dolo Bargon. Sangha-Gogoli
Un jour, deux amis, un lièvre et une hyène, partirent en voyage. Au cours de leur périple, ils furent tenaillés par une grande soif. Mais la chance leur sourit. Ils aperçurent, au fond de la brousse, un puits. L'hyène, se prétendant la plus âgée, prit la puisette[1]. Elle la glissa vers les eaux sombres dans l’espoir d’étancher rapidement sa soif. Malheureusement, elle ne remonta rien. Le lièvre, amusé par la tête déconfite de son amie, en fit autant. Il sortit quant à lui un gros bœuf. Très jalouse, l'hyène plongea de nouveau la puisette au fond du puits. Elle en sortit un mouton. Après cet effort, les deux amis partirent se reposer à l’ombre d’un arbre.
Le soir venu, bienheureux d’avoir chacun trouvé un moyen de locomotion, les deux amis poursuivirent leur chemin. Après avoir parcouru quelque distance, le mouton, épuisé, s’arrêta. L'hyène lui dit alors :
— Si tu ne peux pas avancer à quatre pattes, peut-être pourras-tu marcher avec trois !
L'hyène affamée coupa une patte à son mouton, la dévora et remonta sur son dos. Malgré l’insupportable douleur, la pauvre bête tenta d’avancer de quelques pas, mais elle s’effondra aussitôt. L'hyène lui dit :
— Comme je te l’ai dit tout à l’heure, si tu ne peux pas marcher avec trois pattes, je vais t’en enlever une autre et tu pourras ainsi mieux avancer !
Sans plus d’explications, l'hyène coupa une nouvelle patte à sa monture et la mangea. Puis elle enfourcha de nouveau sa victime. À l’évidence elle ne pouvait plus bouger. L'hyène lui enleva alors les deux dernières pattes en s’exclamant :
— Si tu ne peux pas aller à pattes, tu pourras bien ramper !
Comme le mouton ne pouvait ramper, son bourreau mangea le reste du pauvre animal à l’exception du cœur. N’ayant pas de poche, l'hyène le donna au lièvre qui continuait nonchalamment le voyage sur le dos d’un bœuf en pleine forme. Le boucher rassasié dut quant à lui marcher. Il marcha quelques heures durant quand soudain il demanda à son compagnon de route :
— As-tu le cœur ?
— Bien entendu ! répondit le lièvre.
Ils continuèrent leur voyage.
De temps en temps, afin de se rassurer, l'hyène reposait cette même question : « As-tu le cœur ? ».
Une fois, tandis qu’elle marchait derrière le bœuf, elle le frappa vigoureusement. Il sursauta. À l’insu du lièvre, le cœur jaillit de sa poche. L'hyène le ramassa et le mangea. Ils continuèrent leur chemin. Elle attendit d’avoir parcouru une bonne distance avant de réclamer de nouveau son cœur. Cette fois, c’est par surprise qu’elle s’adressa à son compagnon :
— Donne-moi le cœur, j’ai faim !
Le lièvre fouilla sa poche, ne le trouva pas et répondit à son amie :
— Il a dû tomber.
— Alors il faut égorger ton bœuf, rétorqua l'hyène.
— D’accord, répondit nonchalamment le lièvre.
Ils égorgèrent le bœuf, mais ils n’avaient pas de feu pour le faire cuire. La nuit tomba. Non loin d’eux, la lune se leva au-dessus de la dune de sable. À six kilomètres de là, un berger Peul gardait son troupeau.
L'hyène, se prétendant de nouveau la plus âgée, décida d’envoyer son ami le lièvre demander du feu à cet homme, tandis qu’elle irait chercher celui se trouvant proche de la dune…
Le feu de la lune ! Le lièvre courut six kilomètres à l’aller et autant au retour et grilla sa viande. Pendant ce temps, l'hyène grimpait sur la dune en quête du feu de la lune qu’elle croyait tout proche. Elle continua sa course tandis que son ami achevait de griller et de manger sa part de viande.
Le lièvre ramassa les restes du festin et monta sur un arbre situé en lisière de la piste. Entre-temps, l'hyène épuisée avait rebroussé chemin. Au moment où elle passa sous l’arbre où s’était réfugié le lièvre, ce dernier lui jeta quelques os. L'hyène très heureuse les ramassa et les mangea en se disant : « Quelle chance pour moi ! Aujourd’hui Dieu fait tomber des os du ciel. Je n’en dirai rien à mon pauvre ami ! »
Pour la seconde fois, le lièvre, là-haut perché, jeta un os sur la tête de l'hyène. Elle le ramassa tout en jetant un coup d’œil en l’air. C’est alors qu’elle découvrit son compagnon de route juché avec le reste de la viande. Ne pouvant monter elle-même dans l’arbre, elle courut chez son ami l’ours :
— Bonjour, mon ami l’ours. Je sais qu’avec vous, il est inutile de trop bavarder. J’ai besoin de votre aide. Il s’agit simplement de faire descendre quelque chose d’un arbre.
— D’accord, répondit l’ours. Il t’en coûtera deux sacs de dattes.
l'hyène lui donna les deux sacs demandés. Les deux compères partirent alors trouver le lièvre dans son arbre. L’ours grimpa jusqu’à la moitié du tronc et tira sa longue langue. Tout doucement le lièvre commença à déféquer.
Face à tant de ruse et sans plus tergiverser, l’ours et l'hyène s’enfuirent à travers la forêt.
En ricanant, le lièvre s’adressa à l'hyène qui s’éloignait :
— Vraiment, jamais tu ne seras maligne !
Depuis ce jour, l'hyène regarde toujours en l’air lorsqu’elle passe sous un arbre.
______________
[1] Terme français africain désignant une poche en cuir ou en caoutchouc (chambre à air recyclée) avec laquelle on puise l’eau au fond des puits.
Ambiance nocturne et danse pesay
Danse pratiquée les soirs de pleine lune. Chaque jeune fille entre à tour de rôle avec les bras en croix sur la poitrine à l’intérieur du cercle formée par ses camarades, effectue une rotation sur elle-même puis ressort. Il existe de nombreux textes pour ces chants. Les garçons viennent assister en curieux à ces danses qui sont prétextes à se courtiser. Les frappements sourds entendus ici sont le fruit de la percussion, par les jeunes filles, de la partie de leur jupe située entre les cuisses, avec les mains en cuillère.
Lieu : Mali, vill. de Sangha. Durée : 02:44. © Patrick Kersalé 1993-2024.
Le respect de la parole, par Saye Apomi. Téréli-Sodangha
Dans un petit village dogon vivait un homme qui, sa vie durant, n’avait eu que deux garçons, Adiè et Assè.
Un jour, il leur demanda de s’aimer éternellement. Il insista auprès d’Adiè afin qu’il soit toujours d’accord avec son petit frère Assè et ne conteste jamais ses décisions. Si toutefois il lui arrivait de protester, il serait frappé par l’âme de son père.
Deux années passèrent. Après la récolte, le père trépassa. À l’issue des funérailles, les deux garçons rentrèrent les céréales à la maison. Vers la fin des travaux, une souris sortit du tas de mil. Assè dit à son aîné :
— Comme il doit y avoir d’autres souris dans ce tas de mil, nous allons y mettre le feu et nous les mangerons.
— Penses-tu qu’il soit bon de brûler le tas de mil pour des souris, lui demanda Adiè ?
— Que notre père te frappe cette nuit ! s’exclama le cadet.
— Alors je suis d’accord, conclut Adiè effrayé par cette seule idée.
Ils brûlèrent le tas de mil, mais une seule souris en sortit. Ils se la partagèrent et rentrèrent au village pour engranger les épis de mil. Cette tâche accomplie, une nouvelle souris passa entre les pieds d’Assè qui demanda à son grand frère de brûler le grenier. L’aîné, afin de respecter la parole donnée à leur père, alluma le feu. Quand tout fut consumé, ils trouvèrent, dans le tas de cendres, une unique souris qu’ils savourèrent.
Restés très longtemps à vivre de la seule solidarité du village, les deux frères durent un jour partir car personne ne pouvait plus les aider. Ainsi, ils commencèrent à marcher à la recherche de nourriture. Chemin faisant, ils rencontrèrent un cultivateur qui travaillait avec son unique enfant. Les deux frères lui proposèrent de l’aider à cultiver en échange de nourriture. Le cultivateur accepta. Un moment plus tard, une souris sortit devant Assè. Ce dernier l’attrapa et l’homme lui dit :
— Va sous cet arbre, tu y trouveras mon fils. Demande lui du feu et cuis la souris.
Arrivé sous l’arbre, après avoir obtenu du feu, Assè attacha la souris et égorgea le fils du cultivateur. Après avoir cuit l’enfant, il donna sa chair à la souris qui ne pouvait pas la manger. Alors il appela l’homme et lui dit :
— La souris ne veut pas manger votre enfant !
— Quoi ? Qui doit manger qui ? demanda l’homme en vociférant.
Le cultivateur et Adiè se précipitèrent en courant sous l’arbre. L’homme se saisit alors brusquement de sa houe, mais les deux garçons se sauvèrent. Ils continuèrent ainsi leur périple et durent affronter de grandes difficultés.
Un jour, au milieu de leur souffrance, un grand oiseau vint se poser devant eux. Il leur dit :
— Montez sur mon dos et je vous déposerai à l’entrée d’un village proche d’ici.
Ainsi fut fait.
Arrivés là, Assè dit à Adiè :
— Je vais casser les ailes de cet oiseau ; que notre père te frappe si tu protestes !
Adiè, toujours très peureux, n’eut d’autre choix que d’accepter l’idée saugrenue de son petit frère. Après avoir cassé les ailes de l’oiseau, les deux garçons entrèrent dans le village et se rendirent chez le forgeron. Ils le trouvèrent en train de travailler.
Passées les salutations d’usage, l’homme leur offrit un bon plat et, après le repas, une natte pour se reposer.
L’homme se coucha auprès d’eux, laissant une tige de fer dans le feu. Comme Assè n’arrivait pas à trouver le sommeil, il réveilla son frère et lui dit :
— Je vais mettre cette tige de fer chaude dans l’anus du forgeron !
— Quoi, après tout ce qu’il a fait pour nous ? s’exclama Adiè.
— La parole de notre père est un œuf cassé[1] !
— Que tu es absurde, fais ce que tu voudras et tu découvriras la vérité, rétorqua Adiè.
Assè, tout doucement, prit la tige de fer et la plongea dans le derrière du forgeron qui se leva brusquement en hurlant de douleur. Alors les deux frères s’enfuirent avant que quiconque puisse réagir. Ils montèrent se cacher dans un arbre à la sortie du village. Les jeunes villageois les débusquèrent, mais ne purent grimper à leur tour dans l’arbre. Comme le forgeron avait des haches chez lui, les villageois s’en saisirent et commencèrent à couper le tronc. Tout le monde cogna jusqu’au soir : koy kay koy kay… L’arbre commença à faire des bruits : kin, kin, kin… et à gîter. Mais avant de toucher le sol, Adiè leva les mains au ciel et Dieu lui envoya un gri-gri. Rapidement, l’enfant le croqua et l’arbre reprit sa position initiale. Comme le gri-gri se transformait tout-à-coup en viande de salamandre bien cuite, le cadet dit à l’aîné :
— Partageons cette viande et mangeons-la.
Adiè, toujours effrayé par la parole de son père, donna la moitié de la salamandre à son frère, mais ne mangea pas la sienne. Pendant ce temps, les jeunes gens du village continuaient à couper le tronc. Au moment où l’arbre commençait à tomber, Adiè croqua la viande de la salamandre et, miraculeusement, il se redressa. Puis Assè demanda à Adiè de jeter la viande. À la troisième fois, au moment où l’arbre tomba, les deux frères furent sauvés par un grand oiseau qui les déposa très loin du village. Assè lui cassa les ailes avant de repartir. En cours de route, ils trouvèrent un gros tambour nommé “tambour de Dieu”. C’était un instrument que les gens frappaient en passant. Assè dit à son frère :
— Je vais percer la peau du tambour.
Ainsi fit-il.
Finalement, Dieu envoya du ciel deux cordes avec lesquelles il attacha Assè et Adiè. Tandis qu’il les remontait dans les cieux, les deux frères se mirent à crier. C’est leur cri que l’on appelle aujourd’hui encore “tonnerre”.
« Depuis ce jour, les pères ne donnent plus de tels conseils à leurs enfants avant leur mort. »
____________
[1] Proverbe dogon : une fois que l’œuf est cassé, on ne peut le reconstituer. Ainsi, lorsque la parole a été prononcée, on ne peut plus la retirer.
Chant de funérailles badiu ní
Le chant funéraire badiu ní est interprété lors des funérailles d’un homme ; il est accompagné par un tambour en forme de sablier gòmbòy et une timbale barba.
Lieu : Mali, vill. de Sangha. Durée : 02:44. © Patrick Kersalé 1993-2024.
Quatre orphelins et une culotte, par Togo Ousmane. Guéourou
Il était une fois quatre jeunes hommes qui avaient perdu leur mère alors qu’ils étaient en âge de se marier. Elle les avait quittés lors d’une grande famine, tout comme leur père. En héritage, elle leur avait légué une unique culotte. Le premier des garçons s’appelait Ati, le second Atimé, le troisième Atanou et le dernier Anaye. Comme ils n’avaient pas de sœur, ils faisaient eux-mêmes tous les travaux ménagers. De plus, du fait de leur pauvreté, ils n’avaient ni fiancée ni amie dans le village.
C’était l’hivernage, le temps des travaux champêtres. Ayant une seule culotte pour tous les quatre, ils allaient chaque jour cultiver à tour de rôle.
Un jour, Ati, le plus âgé, s’en alla aux champs. Pendant deux heures, il travailla durement. Fatigué, il se reposa à l’ombre d’un arbre. À sa grande surprise, il vit venir à lui une jeune fille plus belle que toutes celles de son village. Elle portait sur la tête un plat et une calebasse remplie de lait. Elle s’approcha de lui :
— Je te salue mon frère !
— Salut à toi ma sœur, assieds-toi.
— Je ne suis pas une amie mon bien-aimé, je viens juste te donner à manger. Quand tu auras terminé ce repas, nous ferons la course. Si tu m’attrapes entre ici et la rivière, je deviendrai ta femme et partirai avec toi.
Le jeune homme mangea avec empressement, but le lait et se mit en position de départ. Ils coururent ensemble sur quelque distance, mais la jeune fille, plus rapide, le laissa loin derrière elle et disparut. Ati s’en retourna à la maison. Sans même prendre le temps de se désaltérer, il raconta son incroyable aventure à ses frères :
— J’ai perdu un don que Dieu m’a donné.
— Quoi donc ? s’empressèrent-ils de lui demander.
— Tandis que je me reposais sous un arbre, une belle jeune fille est venue m’offrir à manger. Nous étions convenu de faire une course et si je la gagnais, je devais l’épouser. Et j’ai perdu.
— Mais moi, Atimé, je gagnerai demain ! s’empressa de dire le second frère.
Le lendemain matin, réveillé de bonne heure, Atimé se rendit aux champs. Il cultiva un peu et alla se reposer à l’ombre. La jeune fille arriva. Elle prononça les mêmes paroles que la veille. Mais comme son frère, Atimé perdit la course.
Quant au troisième, Atanou, il échoua lui aussi.
Alors, Anaye, le plus jeune, prit la parole :
— Vous ne préparez jamais les repas, c’est pour cela que vous avez perdu, mais si vous respiriez la fumée de l’âtre, vous ne perdriez jamais. Aujourd’hui c’est moi qui irai et je reviendrai avec la fille[1].
— Tu te moques de nous ? répondirent les frères. Comment toi, le plus jeune, pourrais-tu revenir avec cette fille ?
— Je vous en prie, donnez-moi la permission d’y aller !
Ayant finalement réussi à convaincre ses aînés, Anaye prit la culotte et s’en alla aux champs. Il cultiva d’une manière toute particulière : trois coups de houe en terre, un regard à gauche, trois coups de houe en terre, un regard à droite. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il vît arriver la jeune fille.
— Je te salue, mon bien-aimé ! Voici de quoi manger. Je pense que pour le reste, tes frères t’ont déjà expliqué ?
— Salut à toi ma sœur !
Le jeune garçon prit quelques boules de nourriture[2] et un peu de lait avant de se mettre en position de départ. Après avoir parcouru une centaine de mètres, Anaye dépassa la jeune fille. Mieux, en arrivant à la rivière, il revint sur ses pas et se mit à courir derrière elle. Mais avant qu’il ne l’attrape, elle se jeta à l’eau. Il plongea lui aussi et, ensemble, tombèrent sur la terrasse[3] de la maison d’une vieille femme. La jeune fille disparut.
Surprise par cet événement, la vieille se précipita chez le chef du village :
— Il y a chez moi un homme d’un autre monde[4] !
Le chef du village se rendit chez elle et demanda au jeune homme comment il était arrivé jusqu’ici. Il raconta son aventure et le vieil homme lui répondit :
— Dans mon village, il y a plus de mille filles de même taille, de même teint et de semblable beauté. Ce soir, je les ferai toutes sortir et tu me désigneras celle dont il s’agit. Si tu n’arrives pas à la retrouver, tu seras tué devant le grand fétiche.
À midi, on lui donna à manger, mais il ne faisait que pleurer à l’idée d’être exécuté. Au même moment arriva un chat qui lui demanda :
— Pourquoi pleures-tu devant tant de belles victuailles ?
— Je suis confronté à un grave problème. Ce soir, je dois désigner une fille parmi quelques milliers.
— Ne pleure pas mon ami, je t’aiderai si tu me donnes ce lait comme récompense. Voici ce que je vais faire : ce soir, je viendrai avec de la cendre au bout de ma queue et j’en marquerai la fille que tu dois désigner.
— Merci mon ami, à ce soir, répondit le jeune garçon un peu rassuré.
Le soir venu, tout était prêt devant le grand fétiche du village. Le chef envoya son conseiller chercher le jeune garçon chez la vieille femme. Quelques milliers de filles étaient là devant lui. Il resta calme, attendant la venue du chat. Comme convenu, il arriva, traversa la place publique et toucha la fille en question. Le jeune garçon, accompagné par deux conseillers du village, avança lentement vers la fille et la saisit en disant :
— C’est elle, mon père[5] !
Le vieil homme appela la jeune fille et lui demanda :
— Est-ce à cause de toi que ce jeune garçon est là ?
— Oui chef, répondit la jeune fille.
Le dignitaire appela le jeune homme et lui dit :
— Regarde tous ces présents, ces femmes, ces animaux, ces cauris… Prends-les, je te les offre. Pars. Je te conseille toutefois de ne pas te retourner tant que tu n’auras pas franchi la porte.
Le jeune garçon remercia son généreux donateur et se mit en route.
Malgré la faiblesse qui habite tout homme, le jeune garçon ne se retourna pas avant d’être sorti du village.
Arrivé chez lui, il rassembla ses trois frères et toute la population. Ensemble, ils festoyèrent une semaine durant. Le cinquième jour[6], il partagea les animaux, les cauris et les femmes entre tous.
« Depuis ce jour, les hommes commencèrent à épouser deux, trois, quatre femmes selon leurs moyens. »
______________
[1] Ce frère a une motivation complémentaire, celle de ne plus préparer les repas et de ne plus respirer la fumée du feu de bois. S’il conquiert la fille, c’est désormais elle qui préparera les repas.
[2] Les Dogon mangent avec la main droite, sans ustensile, autour du plat commun. Ils font des boules de bouillie de mil ou de riz qu’ils trempent généralement dans de la sauce avant de les absorber.
[3] L’entrée dans l’eau symbolise ici la pénétration dans un monde mythique. Ils tombent l’un et l’autre sur le toit (terrasse de terre battue) de la maison d’une vieille femme, à l’image de celles du pays dogon.
[4] Dans ce monde mythique, les habitants ont la peau marron clair alors que les Dogon sont noirs.
[5] dide : appellation respectueuse.
[6] La semaine traditionnelle dogon compte cinq jours.
L’âne et le rhinocéros, par Saye Dogolou. Téréli-Sodangha
Il y a très longtemps, vivaient ensemble deux amis, l’âne et le rhinocéros. Chaque jour, ils partaient en brousse boire de la bière de mil[1] et revenaient chaque soir sans histoire. Mais après trois années d’intelligente cohabitation, la dissension menaçait.
Un jour comme tous les autres, ils s’en allaient boire de la bière de mil quand ils rencontrèrent sur leur chemin les petits de l’éléphant. Le rhinocéros les interpella :
— Bonjour les enfants, où est votre père ?
— Bonjour ! Notre père est parti chercher de la nourriture.
Le rhinocéros jeta un coup d’œil autour de lui et vit de la farine. Il appela son compagnon et lui dit :
— Mon ami, vois-tu cette belle farine ? Mangeons-en !
L’âne approcha :
— Non, mon ami, ne mangeons pas cette farine. Mon grand-père m’a toujours dit de ne jamais manger la nourriture de l’éléphant au risque de ne pas vivre vieux.
Le rhinocéros, se moquant de la remarque de l’âne, rétorqua :
— Eh bien, moi j’en mange !
— S’il en est ainsi, je me retire ! répondit l’âne.
Après que le rhinocéros fut repu, les deux amis continuèrent leur chemin.
Une heure plus tard, l’éléphant rentra à la maison. Ses enfants lui rapportèrent que deux personnes étaient venu manger la farine. L’éléphant, furieux, partit sur la trace des deux compères. Il les trouva en chemin et les invectiva :
— Eh vous deux, qui a mangé ma farine ?
Le rhinocéros prit la parole :
— Cher ami, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de le demander. Regardez nos bouches. Celui qui a mangé la farine a forcément la bouche blanche !
L’éléphant répliqua alors :
— C’est donc toi, l’âne, qui l’a mangée !
Sans plus parlementer, l’éléphant se tourna vers l’âne à la bouche blanche, l’attrapa par les oreilles, le frappa jusqu’à ce qu’il déféquât puis s’en alla. Mais, avant que l’éléphant n’ait eu le temps de s’éloigner, l’âne, rendu furieux par cette injustice, se mit à rire très fort. L’éléphant se retourna et demanda :
— Qui vient de rigoler ?
L’âne répondit :
— Mon ami, regardez nos deux bouches. On ne peut se méprendre. Ce sont bien les dents du rhinocéros qui sont au-dehors !
L’éléphant s’exclama :
— Ah, c’est donc toi mon ami rhinocéros !
Ce dernier essaya tant bien que mal de se défendre :
— Pardonne-moi si j’ai la bouche fermée, mais j’ai toujours ces deux dents au-dehors.
L’éléphant, ne voulant pas chercher à discuter, vociféra :
— C’est toi !
Puis il frappa le rhinocéros jusqu’à ce qu’il déféquât. Malheureusement, dans sa colère, il lui avait aussi blessé les yeux.
« Depuis ce jour, le rhinocéros a des yeux mi-clos et est l’ennemi de l’âne. »
___________
[1] kᴐɲõ. Boisson fermentée faiblement alcoolisée (env. 3%) fabriquée par les femmes à partir du sorgho rouge — appelé aussi gros mil — ou du petit mil.
L’histoire des dix filles, par Poudiougo Yasserou. Gondome
Il était une fois dix jeunes filles âgées d’une vingtaine d’années qui se côtoyaient chaque jour depuis l’âge de cinq ans. L’une d’entre elles était très curieuse.
Un jour comme tous les autres, elles partirent en brousse chercher du bois de chauffage. De bon matin, elles se retrouvèrent chez la fille du féticheur, la plus âgée[1] d’entre elles. Munies de leur gourde d’eau, elles quittèrent le village. Arrivées au bord de la rivière qu’elles devaient traverser, elles découvrirent un œuf de génie de l’eau[2]. Après l’avoir observé, elles se décidèrent à passer. Mais la jeune fille curieuse s’en retourna pour le prendre. Au moment où elle s’en saisit, il se brisa entre ses doigts. Sans dire un mot, elle rejoignit le groupe. Arrivées en pleine brousse, elles déposèrent leur gourde d’eau sous un grand arbre et se dispersèrent pour chercher du bois. Quelques heures plus tard, elles s’en revinrent en ce lieu pour s’y désaltérer. Pendant ce temps, un oiseau vint se poser sur l’arbre et commença à chanter. La fille du féticheur écouta et s’exclama :
— Il y a quelque chose de curieux, cet oiseau nous fait un signe !
Personne ne répondit.
Après avoir pris un peu de repos, elles s’en retournèrent à la recherche de bois jusqu’à ce que chacune en eût un bon fagot.
Très heureuses, elles rentrèrent au village. En arrivant à la rivière, elles trouvèrent l’œuf cassé flottant à la surface de l’eau quand tout à coup, la fille du féticheur se souvint du signe fait par l’oiseau. Elle devina[3] aussitôt que l’une d’entre elles avait cassé l’œuf. Toutes soupçonnèrent la curieuse. La plus âgée pria alors en chantant :
— Ô vous les eaux, maîtresses de la vie, je n’ai pas cassé l’œuf. Donnez-moi la route[4].
Les eaux se retirèrent et la jeune fille passa. Dans l’ordre de leur naissance, les huit autres filles chantèrent et passèrent. Quant à la curieuse, elle reprit plusieurs fois la prière, mais l’eau ne répondit pas. Chantant de nouveau, la rivière s’assécha brusquement. Elle commença à traverser, mais arrivée au beau milieu du lit, les eaux resurgirent et l’engloutirent. Les autres jeunes filles rentrèrent au village.
Elles tentèrent de cacher la mort de leur amie à sa mère, mais à la nuit tombée, celle-ci s’en vint les trouver. Elles observèrent le silence. Le lendemain matin, de bonne heure, les neuf amies se réunirent pour aller déclarer le décès à la mère. Elles racontèrent tous les détails de la disparition. Rapidement, la femme emmena les demoiselles à la rivière pour y rechercher le corps de sa fille. Elles le trouvèrent ainsi que de la graisse flottant à la surface de l’eau. Le jour même, la mère de la défunte déclara l’ouverture des funérailles. Elle prépara la bouillie de mil avec la graisse qu’elle avait recueillie à la surface de la rivière et invita les neuf jeunes filles. Après avoir mangé, toutes moururent en même temps. Quelques instants plus tard, arriva une femme peul. Elle dit :
— Elles dorment toutes grâce à ton plat. Ma sœur, donne-moi à manger, je n’ai pas dormi depuis deux jours.
La mère de la défunte ne se fit pas prier et en un éclair, la femme peul s’endormit pour toujours avec les autres.
Le soir venu, les familles des victimes vinrent chercher le corps inerte des jeunes filles pour les emmener au cimetière. En chemin, elles rencontrèrent, assise au beau milieu de la piste, une très vieille femme.
La mère, en tête du cortège funèbre, arriva avec le corps de sa fille à son niveau et, l’ignorant, passa par-dessus ses jambes. La vieille ne dit mot. Huit autres mères, comme celle de la fille peul, firent passer elles aussi les corps au-dessus d’elle. La femme qui fermait la colonne était enceinte. Ayant de la difficulté à tirer le corps de sa fille, elle dit à la vieille femme :
— Bonsoir grand-mère, pardonnez-moi, donnez-moi la route.
— Bonsoir ma fille. Il n’y a pas de problème, tu peux suivre le même chemin que les autres.
— Mais je ne suis pas comme les autres !
La vieille retira ses jambes et la femme passa. Aussitôt après, la vieille dame rappela la mère et lui dit :
— Voici la récompense de ton respect.
— Quelle récompense ?
La vieille femme prit une tige de mil et toucha le corps de la défunte qui reprit vie et se leva. Au même moment, la vieille disparut. Très heureuses, la femme enceinte et la jeune fille ressuscitée coururent vers le cimetière relater le miracle aux autres femmes. Toutes se précipitèrent vers le lieu de la résurrection, mais il était vide. Elles convinrent alors que Dieu lui-même s’était manifesté.
« Depuis ce jour, les gens commencèrent à respecter les personnes âgées car Dieu est incarné en elles. »
_______________
[1] Les jeunes filles sont certes de même âge, mais on considère ici seulement la différence des quelques mois qui les séparent.
[2] Nommo (nɔ̀mᴐ). Génie d’eau. Le culte du Nommo est un des principaux aspects de la religion dogon. Ce fils d’Amma, jumeau ou androgyne, fut mis à mort et ressuscité pour purifier l’univers des agissements désordonnés et incestueux du Renard. Nommo préside à la fécondité et à toutes les forces de vie. C’est lui qui a enseigné aux hommes la parole, le tissage et toutes les techniques. Son rôle est de lutter contre les forces de désordre et la mort représentée par le Renard. Il est le maître de l’eau et de la pluie. (D’après Dictionnaire dogon, G. Calame-Griaule).
[3] La fille du féticheur — celui qui pratique la divination du renard pâle — savait interpréter le chant de l’oiseau.
[4] Expression franco-africaine, ici équivalente à “laissez-moi passer”.
Lamentations funèbres
Lamentations de femmes au cours des funérailles de l’une d’entre elles.
Lieu : Mali, vill. de Yendouma. Durée : 01:08. © Agnès Pataux 1993-2024.
L’homme incestueux, par Tembelly Yamalou. Pel
Un homme nommé Amaga avait une fille, Yati, qui était la plus belle du village. Tous les jours, de jeunes garçons venaient demander sa main, mais son père répondait inexorablement :
— Laissez ma fille dans sa famille. Elle est si belle que je l’épouserai moi-même. Ainsi, elle n’aura pas l’occasion de faire le bonheur d’un autre foyer !
Tous les gens du village s’insurgèrent contre ce père incestueux.
Yati ignorait les intentions de son père. Elle en fut informée par une famille voisine. Aussi s’enfuit-elle du village avec la ferme intention de se donner la mort. Elle monta sur un rônier[1] afin de se jeter de sa cime.
Un berger avait suivi la scène des yeux. Il courut vers le village avertir les parents de la jeune beauté qui s’élancèrent aussitôt vers le lieu du drame. Lorsqu’ils arrivèrent au pied de l’arbre, le père tenta de convaincre sa fille de descendre. Yati répondit en chantant :
Ô Dieu tout puissant
Plutôt que d’être épousé par mon propre père
Je préfère dîner chez toi.
Ainsi, chaque fois que ses parents lui demandaient de descendre, la jeune fille chantait la même chanson. Finalement, ne voulant plus entendre ses exhortations, elle sauta du rônier. Inanimé, son pauvre corps fut ramassé puis porté au tombeau.
Quelques années plus tard, un baobab poussa sur la tombe de la jeune fille. Tout le monde ressassait au père :
— L’arbre qui a poussé là est plus beau à voir que toutes les plantes de la brousse.
Afin que personne ne puisse cueillir des feuilles de l’arbre, le père le coupa et le brûla. Puis, comme les gens trouvaient sa souche belle à voir, l’homme s’acharna à faire disparaître les restes du baobab[2]. Pour cela, il creusa un puits si profond qu’il ne put jamais plus en ressortir et périt dans les entrailles de la terre.
« La jalousie porte la destruction en son sein. »
___________________
[1] En Afrique, on consomme les fruits de ce palmier. On prépare également, avec sa sève, une boisson fermentée légèrement alcoolisée.
[2] ɔ́rᴐ. (Adansonia digitata). Le baobab est un arbre commun mais précieux dans tout le pays dogon. Ses fruits sont consommés ou transformés en hochets ; ses feuilles entrent dans la préparation de la sauce accompagnant la bouillie de mil ; les fibres de son tronc servent à fabriquer des cordages ; son bois mort est utilisé comme de combustible.
Dieu et le lièvre, par Poudiougo Atimé. Amani
Un jour, le lièvre se rendit chez Dieu. Il lui dit :
— Je veux devenir l’être le plus malin du monde. Je vous supplie de faire quelque chose pour moi.
Dieu lui répondit :
— Bien mon ami. Je ferai quelque chose pour toi, mais avant tout, apporte-moi la défense de l’éléphant et la morve du cobra.
Le lièvre décida de s’acquitter de ces tâches dans la journée même. Il appela alors tous les animaux de la brousse et leur dit qu’ils allaient jouer au jeu de la maison à étage. Chacun monta sur le dos de celui qui le précédait. Le lièvre se trouvait tout en dessous de la pile. Après s’être assuré que l’éléphant était juché au sommet, il remua et la tour s’écroula. Le gros animal s’écrasa violemment sur le sol, perdant dans le choc ses deux défenses. Avant que le pachyderme n’ait le temps de se remettre de ses émotions, le lièvre ramassa les objets de sa convoitise et s’enfuit.
Chemin faisant, il croisa les enfants du cobra. Il les enleva et les cacha. Lorsque, le soir venu, père cobra rentra chez lui, il ne trouva pas sa progéniture. Il la chercha, mais en vain. Il se mit alors à pleurer. Le lièvre vint à sa rencontre et lui demanda :
— Mon ami, pourquoi pleures-tu ?
— Mes enfants ont disparu, répondit le cobra.
Le serpent avait tellement pleuré, que de la morve sortait en abondance de ses narines.
— Ne pleure pas mon ami, tu retrouveras bientôt tes enfants, répondit le lièvre.
Tout en consolant le serpent, le rusé lapin sécha ses larmes et en profita pour lui subtiliser sa morve. Après cela, il lui ramena ses enfants et s’empressa de retourner chez Dieu :
— Mon Dieu, voici tout ce que vous m’avez demandé !
— C’est bien, va maintenant, tu es désormais le plus malin des êtres vivants dans le monde !
Le lièvre rétorqua :
— Si c’est ainsi, reconnaissez que je suis même plus malin que vous !
Dieu, surpris, vociféra :
— Tu oses m’insulter ! Je vais te montrer ma puissance !
Le lièvre n’attendit pas un instant de plus et prit la poudre d’escampette. Dieu, qui ne désirait pas en rester là, se lança à sa poursuite. Le lièvre pensa : « Lorsque j’aurai parcouru mille kilomètres, Dieu sera fatigué et cessera de me poursuivre ! »
Dans sa course effrénée, le lièvre eut faim. C’est alors que Dieu se transforma en herbe. Mais l’animal rusé sentit le piège et s’abstint de manger. Puis il eut soif. Dieu se transforma en eau. Mais une fois encore, le lièvre flaira le piège et continua sa route. En chemin, il trouva un joli bracelet. Il le ramassa et le passa autour de son poignet. Au même instant, le bijou se resserra sur son bras. Le lièvre s’exclama :
— Comme tu es beau petit bracelet ! Si je pouvais t’enlever de mon poignet, je te passerais autour de mon cou.
Alors Dieu desserra le bracelet. Le lièvre l’ôta doucement et le jeta à terre avant de continuer sa route. Dieu, furieux, le poursuivit, mais jamais, au grand jamais, ne réussit à l’attraper. Très fâché, il dit au lièvre :
— Maudit sois-tu. Va dans le monde entier. À partir de ce jour, tu tomberas lorsqu’on te donnera un seul coup !
« Et c’est pourquoi aujourd’hui, d’un seul coup de bâton asséné par les hommes, le lièvre s'effondre. »
L’origine d’Amma, par Tiguem Dogoulou Saye. Téréli-Sodangha
Il était une fois deux hommes très curieux qui habitaient le même village. Ils étaient tellement curieux qu’ils voulaient voir Amma[1] dont ils avaient entendu parler par le fondateur du village, un chasseur. Tous les villageois connaissaient le nom d’Amma et croyaient qu’il vivait au ciel. Pour cela, ils allèrent tout d’abord trouver le devin[2]. En réponse à leur requête, celui-ci leur enseigna une prière qu’ils devaient réciter : « Amma, vous qui êtes au-dessus de toutes choses, nous vous prions. Amma, nous voulons vous voir. Amma, nous savons que vous êtes capable de tout faire et nous croyons en vous. Amma, faites tout ce qui est en votre pouvoir afin que nous vous voyions tous les cinq jours au nord du village. »
Un matin de très bonne heure, tous les hommes quittèrent le village et prièrent comme le devin le leur avait enseigné. Mais ce jour-là, ils ne virent rien, pas même une mouche. Durant plus de trois années, ils prièrent ainsi tous les cinq jours. Fatigués d’invoquer Amma sans jamais le voir, certains se découragèrent et abandonnèrent. D’autres moururent avant de l’avoir vu.
Mais un jour, tandis que les croyants qui ne s’étaient pas découragés étaient en train de prier, ils entendirent une voix : « Je viendrai le soir du cinquième jour[3]. Vous appellerez tous les incroyants. » Les hommes, gagnés par l’euphorie, rentrèrent au village en criant :
— Nous verrons Amma le cinquième jour, nous verrons Amma le cinquième jour !
En attendant, on fit des préparatifs : partout dans les familles, les femmes préparèrent en quantité de la bière de mil et de la bouillie au gras. On balaya tous les lieux publics.
Le jour venu, hommes et femmes se réunirent chez le chef du village et dansèrent jusqu’au soir. Au cours de leur danse, ils virent venir au loin un homme mal habillé se comportant comme un fou : c’était Amma. Lorsqu’il arriva auprès de la foule, il dit :
— Me voici !
Les hommes, voyant en lui un imposteur, le frappèrent jusqu’au sang en s’écriant :
— Amma n’est pas ainsi, Amma n’est pas ainsi !
Rapidement, l’homme déguerpit. Les villageois continuèrent quant à eux à danser toute la nuit sans voir personne d’autre. Au petit matin, ils rentrèrent finalement chez eux.
Dans la journée même, la population se réunit chez le chef du village afin de juger ceux qui avaient annoncé la nouvelle. Pour la seconde fois, on alla interroger le devin. Le lendemain[4], il donna sa réponse :
— Allez prier une dernière fois et vous verrez Amma.
Ainsi, pour la dernière fois, hommes et femmes, garçons et filles sortirent du village et commencèrent à prier. Au cours de leur invocation, Amma arriva parmi eux. Il était serein et bien habillé. Il prit la parole :
— Ô vous les incroyants ! Me voici. C’est moi-même qui m’étais présenté le cinquième jour.
Après cela, il quitta la foule. Comme il s’était éloigné de quelques pas, les hommes commencèrent à courir derrière lui pour le toucher et lui poser des questions sur le monde, mais nul ne parvint à le rattraper et il disparut.
Les hommes décidèrent alors de ramasser ses traces et d’en faire une boule.
« Depuis ce jour, cette boule de terre représente Dieu et les hommes la nomment Amma ou Omonron[5] ».
________________
[1] ɑ́mɑ. Dieu. Entité spirituelle supérieure de la cosmogonie dogon, créateur du monde.
[2] yurugú kúnonɛ. Celui qui fait la divination (yurugú búmõ ou yurugú kuní) du renard pâle (yurugú) (Vulpes pallida).
[3] dɑ́m(ɑ) bɑ́y. Cinquième et dernier jour de la semaine. Il est le “jour de l’interdit”, ainsi nommé, car ce jour-là, veille du marché de Sangha, les représentants de la tribu d’Arou ne doivent pas travailler. Les noms des quatre premiers jours de la semaine sont définis en rapport avec certains marchés locaux importants : 1er : sɑ́ŋɑ íbɛ (jour du marché de Sangha) ; 2e : íreli íbɛ (jour du marché d’Iréli) ; 3e : íbi íbɛ (jour du marché d’Ibi) ; 4e : bɑ́ni íbɛ (jour du marché de Banani). Le cinquième et dernier jour ne porte pas le nom d’un marché.
[4] Après avoir préparé sa grille de divination dans le sable, posé les questions et déposé de la nourriture pour le Renard Pâle, le devin attend le lendemain matin pour lire les réponses dans les traces laissées au cours de la nuit.
[5] omõrõ. Représentations matérielles des entités spirituelles (monticule de terre, statuette, morceau de bois, de pierre, de métal…). Cette dernière assertion constitue un témoignage des plus importants car elle révèle que le nom du dieu unique des Dogon prend sa source en Égypte pharaonique : Amma => Amon, (l’une des principales divinités du panthéon égyptien, dieu de Thèbes) et Omonron => Amon-Rê (l'une des formes du dieu solaire). On sait qu'un autre nom du dieu principal des Égyptiens était Imen, litt. “le Caché” ou “l’Inconnaissable”, traduisant l’impossibilité de connaître sa “vraie” forme, car il se révèle sous de nombreux aspects. Or le rhombe des Dogon est nommé imina nà dans la langue secrète sigi sᴐ ; il représente la voix du Grand Masque nommé Imina nà. Le rhombe est l'un des objets les plus sacrés des Dogon et seuls les initiés en connaissent l'existence et le nom. Les non-initiés se contentent d'en entendre le vrombissement depuis leur maison où ils doivent se terrer durant les cérémonies au cours desquelles le rhombe est utilisé. Ne voyons ici aucune coïncidence, mais plutôt la perpétuation d'une culture que d'aucun croyait disparue…
Musique de réjouissances na ba
Ensemble constitué de deux tambours en sablier gòmbòy, deux flûtes à embouchure latérale kelé, une demi-calebasse kᴐrɔ̃̀ frappée à mains nues et une seconde kᴐrɔ̃̀ gele munie de perles vibrant lors de chaque frappe.
Lieu : Mali, vill. de Banani. Durée : 03:48. © P. Kersalé 1993-2024.
Le respect des fétiches, par Tagadjou Amono. Yayé
Il était une fois, dans un petit village dogon, des gens qui ne croyaient pas aux lois des esprits et des divinités dont le hogon était détenteur. Très loin d’ici, se trouvait un campement peul où personne ne croyait aux fétiches.
Un jour, un Peul arriva à cheval dans le village dogon situé au pied de la falaise[1]. Il attacha sa monture en contrebas[2] et fut invité à séjourner chez le hogon, en haut du village.
Le terme de son séjour arriva. Il coïncidait avec la grande fête des fétiches du village[3]. Ce jour-là, on devait sacrifier des poulets, des moutons et beaucoup d’autres animaux. Toutefois, personne ne devait manger cette viande hormis le hogon qui goûtait le foie. Mais le Peul ne croyait pas à tout cela. Le matin de bonne heure, les sages du village se réunirent devant le “fétiche de la maladie[4]”, égorgèrent des animaux et firent cuire la viande. Au moment où ils voulurent la mettre dans le sanctuaire, le Peul intervint :
— Vous êtes des sauvages ! Comment pouvez-vous laisser perdre une si bonne viande ? Dieu n’est pas ici, il est au ciel. Donnez-la moi. Il ne m’arrivera rien.
Le hogon répondit :
— Oui, Amma est au ciel. Il y a très longtemps, Dieu s’est montré aux hommes qui ont couru derrière lui, mais ne l’ont pas attrapé. Alors ils ont ramassé ses traces. C’est cette terre[5] que nous appelons Amma.
Le Peul dit alors :
— Même si cela est vrai, l’interdiction de manger la viande est fausse.
Le hogon, qui ne voulait pas blesser le Peul et voyait que beaucoup d’autres gens partageaient l’opinion de son hôte, lui donna la viande. Le Peul la prit, la mangea et demanda la route[6] au hogon. Accompagné des vieux sages du village, le Peul se moqua des féticheurs. Mais quand il arriva auprès de son cheval, il mourut subitement.
« Depuis ce jour, les gens commencèrent à respecter les lois des fétiches. »
_______________
[1] Falaise de Bandiagara.
[2] Les villages de la falaise sont construits sur les éboulis. Il y a donc toujours une partie haute et une basse.
[3] búlu ou búlo. Importante fête du calendrier dogon célébrée lors du solstice d’été, avant les semailles. On effectue à cette occasion de nombreux sacrifices.
[4] silɛ omõrõ.
[5] C’est une partie de cette terre qui constitue le fétiche, représentation physique d’une entité spirituelle. Lorsque l’on souhaite initier un nouveau fétiche dans un village, on prend un peu de la terre d’un fétiche existant que l’on mélange avec d’autre terre non sacralisée.
[6] Expression franco-africaine équivalant ici à “demander congé”.
Les animaux de la brousse organisent une lutte, par Saye Pouloyiré. Téréli-Tatara
Un jour, les animaux sauvages de la brousse décidèrent d’organiser une grande soirée de lutte[1]. Tous étaient invités sans distinction de force, de taille, d’intelligence ou de sexe. Quand, vers une heure du matin, tout le monde fut arrivé, le lion ordonna au chien et au singe de commencer la lutte. Le cabot fit plusieurs fois le tour[2] de l’aire de combat avant d’affronter son adversaire. Quand il se décida à attaquer, il ne lui fallut qu’un court instant pour terrasser son rival qui déféqua à terre. Le lion imposa alors au chien de manger les excréments du singe. Effrayé par l’idée de courroucer le roi des animaux, il obéit. Au second tour, le chien terrassa de nouveau son adversaire qui, une fois encore, déféqua. Pour la deuxième fois, le lion demanda au vainqueur de manger les excréments du vaincu. Il obtempéra.
Découragé d’avoir mangé tellement d’excréments, le chien décida de quitter la place et de rentrer chez lui. En cours de route, il rencontra le caméléon[3] qui marchait lentement. Celui-ci lui demanda :
— Pourquoi rentres-tu déjà ?
Après avoir raconté sa mésaventure, le caméléon dit au chien :
— Tant que tu es sur le terrain, tu ne dois pas manger les excréments du singe.
Le cabot reprit confiance et s’en retourna. De nouveau, il lutta contre le singe et le terrassa. Comme à son habitude, le grimacier déféqua et le lion demanda à l’adversaire de manger le fruit de la peur. Le vainqueur alla trouver le caméléon, mais celui-ci n’osa pas contredire le lion. Alors le pauvre chien mangea les excréments du singe. Mécontent de son aventure avec le caméléon, le chien quitta de nouveau l’aire de lutte pour rentrer chez lui. Chemin faisant, il rencontra le lièvre qui gambadait joyeusement.
— Pourquoi as-tu un si gros ventre lui demanda le lièvre ?
— J’ai mangé trop de déjections de singe, répondit le chien.
Le lièvre éclata de rire :
— Retourne et sois assuré que cette fois, tu n’en mangeras plus !
Ainsi, une fois encore, le chien retourna lutter et terrassa le singe qui déféqua. Le lion demanda au vainqueur de manger ses crottes, mais quelqu’un s’y opposa. Le lion demanda alors à celui qui refusait de venir le trouver. Le lièvre, effrayé par le roi de la brousse, s’abstint de le provoquer et le chien fut une nouvelle fois obligé de manger. Le pauvre cabot, furieux contre le lièvre, prit le chemin de sa maison. En cours de route, il rencontra l'hyène qui le questionna. Il raconta de nouveau son histoire. Pour le convaincre de retourner lutter, l'hyène se mit à courir en tous sens pour lui démontrer sa force. Le chien, aussi naïf que désespéré, accepta de retourner lutter. L'hyène lui dit :
— Ne regarde pas les excréments du chien et, surtout, ne les mange pas.
De nouveau, le chien terrassa le singe qui déféqua. Le roi de la brousse lui demanda de manger les excréments et l'hyène ne put rien faire pour le pauvre lutteur.
Le chien avait désormais perdu confiance en tous les animaux de la brousse et décida de rentrer définitivement, tout du moins le pensait-il, car en chemin, il rencontra l’éléphant, la gazelle, le rhinocéros, enfin presque tous les animaux de la brousse.
La dernière fois qu’il quitta le terrain de lutte, il croisa l’écureuil et refusa de lui répondre car, si l’éléphant n’avait pu le sauver, comment lui, un si petit animal, pourrait-il faire face au lion. Mais l’écureuil sut consoler le chien qui lui raconta finalement toute son aventure. Le petit animal lui donna ce conseil :
— Tant que tu seras avec lui sur le terrain de lutte, ne mange pas ses excréments !
Finalement, le chien lui fit confiance en se disant qu’il ne fallait pas se fier aux seules apparences, puis ils repartirent ensemble. Le chien lutta avec le singe et le terrassa. Le lion le somma de nouveau de manger les excréments, mais l’écureuil s’interposa. Alors, le lion invita celui qui s’opposait à sa décision à rentrer sur le terrain. L’écureuil pénétra et le lion vint le trouver. Le roi des animaux, qui avait cru ne faire qu’une bouchée de ce frêle adversaire, se retrouva avec la queue de l’écureuil dans une narine, tomba et déféqua. Tous les animaux s’enfuirent alors en criant que le lion était tombé, que le roi avait été vaincu.
Ainsi, l’écureuil avait pu tirer son épingle du jeu.
« Depuis ce temps, en pays dogon, tous les animaux se sont éparpillés après avoir été déçus par le lion. »
_______________
[1] Enfants et jeunes gens de villages ou quartiers rivaux organisent des luttes rituelles opposant deux garçons. Il s’agit d’un combat au corps à corps ayant pour but de déséquilibrer l’adversaire. Celui qui est terrassé est vaincu et hué par les supporters du camp adverse. Au contraire, le vainqueur acclamé acquiert respectabilité.
[2] Avant de s’affronter, les lutteurs font plusieurs fois le tour de l’espace délimité par les spectateurs ; ils s’observent et paradent.
[3] ɔ́gᴐ jì:nɛ. (Chamaeleo senegalensis senegalensis).
Lutte rituelle
Les enfants de villages ou quartiers rivaux organisent des luttes rituelles opposant deux garçons. Il s'agit d'une lutte au corps à corps ayant pour but de déséquilibrer l'adversaire. Celui qui tombe à terre est vaincu et hué par les supporters du camp adverse. Les enfants tambourinaires appellent les garçons de villages ou de quartiers rivaux en frappant des tambours gómbòy et encouragent de la même manière les lutteurs.
Lieu : Mali, vill. de Sangha. Durée : 01:49. © P. Kersalé 1993-2024.
Les deux chasseurs et les mauvais génies, par Togo Ousmane. Guéourou
Il y a très longtemps, deux amis chasseurs vivaient dans un village dogon. Ils passaient leurs journées ensemble et partageaient le gibier. En ce lieu vivaient également de vieilles personnes toujours tourmentées par de malins génies.
Un jour, les deux hommes partirent en brousse. Sur le chemin du retour, ils trouvèrent un grand canari[1] rempli de bière de mil appartenant aux génies. Comme ceux-ci étaient absents, ils burent et remplirent leurs outres en peau de mouton avant de s’en retourner au village. Quand les génies revinrent, ils trouvèrent leur canari vide.
Le soir, à force de palabres, deux chasseurs comprirent que le lieu même où ils avaient trouvé la bière de mil était le domaine des génies. Aussi, le lendemain, ils s’y rendirent directement. Comme la veille, le canari était plein. Ils burent et remplirent leurs outres mais, au moment de partir, ils virent venir un tourbillon[2]. Ne sachant que faire, ils jetèrent le reste de la bière, renversèrent le canari et s’y cachèrent. En arrivant, les génies ne trouvèrent personne. Fatigués de chercher, ils allèrent se reposer à l’ombre d’un arbre. Quand tout à coup, un petit génie très curieux invita ses compagnons à le suivre.
En silence, ils s’approchèrent du canari et brusquement le firent basculer.
Les deux chasseurs n’eurent même pas le temps de comprendre ce qui se passait qu’ils étaient déjà capturés.
Le chef des génies prit alors un long couteau et fit des va-et-vient en dansant et en chantant :
Ils n’ont jamais été tués, mais ils vont périr
Les noirs n’ont jamais été tués, mais ils vont périr.
Curieusement, ce chef de cérémonie donna son couteau à l’un des chasseurs qui, avec un incroyable sang-froid, reprit la chanson tout en venant se mettre à genoux devant lui. Celui-ci, à la fois surpris et heureux, ordonna au chasseur de chanter et danser à nouveau. L’homme s’éloigna un peu, revint en chantant et en dansant. Il en profita alors pour trancher par surprise la tête du chef des génies. Effrayés, tous les autres se dispersèrent.
« Depuis ce jour, dans ce village, les mauvais génies ne dérangent plus les vieilles personnes. »
_______________
[1] Poterie sphérique servant au transport et au stockage de l’eau, à la préparation des aliments et de la bière de mil.
[2] Selon la croyance, le tourbillon est une matérialisation des mauvais génies et des sorcières.
Le retour des femmes, par Saye Apourolou. Téréli-Sodangha
Il y a bien longtemps, dans un hameau de la falaise de Bandiagara[1], les habitants étaient dérangés par de mauvais génies. Chaque fois que les hommes se mariaient, ces êtres maudits venaient la nuit enlever leur première épouse dès lors qu’elle mettait un enfant au monde. Voilà pourquoi les hommes furent obligés d’épouser au moins deux femmes.
Tout le monde avait entendu parler du village des génies, mais nul ne savait véritablement où il était. Il semblait se trouver quelque part au milieu d’une forêt dense, très loin du pays des hommes, mais jamais personne n’avait osé s’y rendre. Jusqu’au jour où un garçon d’une vingtaine d’années décida de découvrir ce lieu maudit où vivaient désormais la moitié des femmes de son village. Avant de partir, il alla trouver le hogon afin qu’il lui donnât la route[2]. Très touché par ce geste, le dignitaire réunit tous les vieux sages. Malheureusement, pour ces gens-là, la démarche du jeune homme n’était pas considérée comme une marque de courage, mais plutôt comme une offense à leur égard. Certains demandèrent même que le garçon soit égorgé devant le grand fétiche de la pluie. D’autres étant opposés à ce sacrifice, on lui donna la route. On lui fit cependant savoir qu’il serait exécuté s’il ne ramenait pas toutes les femmes vivantes. Le père du garçon apporta deux coqs, un blanc et un noir, que l’on offrit en sacrifice au fétiche du voyage.
Le lendemain, le garçon quitta le village avant l’apparition du soleil au-dessus des dunes[3]. Il marcha toute la journée, mais ne trouva aucune forêt. Il passa la nuit en brousse sous un grand arbre. Le second jour, il reprit sa route. Au cours du voyage, une grosse mouche vint se poser sur son nez. Comme il restait impassible et silencieux, elle lui demanda :
— Où vas-tu, brave ami ?
— Je pars à la recherche des femmes de mon village emportées par les mauvais génies. Ceux-ci vivent quelque part dans une forêt lointaine.
— Laisse-moi t’accompagner, dit la mouche.
Le garçon reprit sa route en compagnie de l’insecte. En chemin, un serpent vint les trouver. Il monta sur le jeune homme qui n’en fut pas effrayé et ils devinrent amis.
Ainsi le chacal, les abeilles, l’aigle et beaucoup d’autres animaux devinrent ses compagnons de route. Ensemble, ils poursuivirent la recherche.
Finalement, au petit soir[4], à l’heure où les femmes commencent à piler le mil, ils arrivèrent au lieu recherché, un village au milieu de la forêt. La mouche pénétra la première. Elle y découvrit un gros village sans route. L’aigle décida alors d’y emporter un à un tous les compagnons.
Ainsi fut fait.
Tous se retrouvèrent chez le chef des génies. Celui-ci leur présenta un taureau de dix ans qu’ils devaient terrasser et tuer. Les animaux s’organisèrent afin d’aider le garçon. Le lion entra le premier dans l’enclos. Il terrassa le taureau. Pour le tuer, le garçon fit appel aux abeilles et au serpent qui pénétrèrent par tous ses orifices. Une fois mort, le chacal lui ouvrit le ventre. Il en sortit une pintade toute blanche. Par curiosité, le lapin dit :
— Ouvrons le ventre de cette pintade !
Ainsi fut fait.
Il extirpa de son ventre un œuf gris très lourd, plus lourd qu’un village. Le garçon prit un bâton et cassa l’œuf. Des femmes de tout âge en sortirent. Les aigles et beaucoup d’autres oiseaux emportèrent les femmes dans les airs et les déposèrent près du village du garçon. Tout le monde sortit pour les accueillir. Les vieux du village remercièrent le jeune homme et l’on festoya deux semaines durant.
« Depuis ce jour, le hogon et les sages interdirent d’offrir une personne humaine en sacrifice à un fétiche. »
________________
[1] Le pays Dogon est séparé en deux par la falaise de Bandiagara longue de 200 km.
[2] Expression franco-africaine signifiant ici “demander l’autorisation de partir”. Dans ce cas, compte tenu du caractère périlleux de la mission du garçon et de la nature du personnage qu’est le hogon, cette autorisation serait assortie de bénédictions.
[3] Ces dunes font face à la falaise de Bandiagara.
[4] Expression franco-africaine signifiant “crépuscule”.
Le crocodile et le chien, par Saye Ana. Téréli
Jadis, le crocodile et le chien étaient bons amis. Ils se fréquentaient et se donnaient des conseils.
Un jour, le chien invita son ami le crocodile à partager un bon repas à l’occasion de son dix-septième anniversaire. Le crocodile, très content, accepta l’invitation. Arrivé dans la famille de son ami, la chienne lui présenta un plat qu’il adorait. Mais avant de manger, le chien lui dit ceci :
— Pour manger ce bon plat, il faut que l’invité d’honneur s’asseye.
Hélas, le crocodile ne pouvait s’asseoir. Du matin au soir, il essaya, mais en vain. C’est ainsi qu’il rentra chez lui, laissant le chien et la chienne manger seul leur plat.
Le crocodile, à son tour, prépara un bon plat lors de son anniversaire et invita son ami intime le chien. Celui-ci arriva dès l’aube, accompagné de sa femme. Le mets semblait si délicieux que les invités ne pouvaient tenir en place. Le crocodile fixa, de bonne guerre, sa règle :
— Pour manger ce plat d’anniversaire, il faut avoir le nez sec.
Malheureusement, comme chacun sait, le chien a toujours le nez mouillé. Aussi, quand le soleil commença à darder ses chauds rayons, le chien et la chienne sortirent y exposer leur museau. Mais en vain. Le soir venu, leur nez n’était toujours pas sec.
Aussi, le crocodile mangea seul son délicieux plat et le chien repartit furieux tout en maugréant :
— Crocodile ! Gare à toi si je te trouve hors de l’eau !
Quant au crocodile, il répondit à son tour :
— Chien ! Gare à toi si je te trouve en train de rôder autour de mes mares !
« Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas que l’on vous fasse. »
Les deux marchands de mil, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Il était une fois deux grands commerçants qui s’aimaient tant que les gens se demandaient s’ils n’étaient pas frères. Ils allaient de village en village et de marché en marché pour commercer. L’un s’appelait Antanou et l’autre Ansama.
Un jour, ils se préparaient à partir au marché pour y vendre une grande quantité de mil. Le soir, ils commencèrent à charger les marchandises sur leur âne. Antanou avait déposé à terre son bidon d’eau en vue de le placer à la fin, sur son chargement de mil. Quant à Ansama, il avait empoigné son bidon afin de ne pas l’oublier. Lorsque le chargement fut terminé, ils partirent. Mais Antanou, après avoir marché plus d’une heure, s’aperçut qu’il avait oublié son bidon d’eau. Il demanda alors à son compagnon de l’attendre, mais celui-ci répondit :
— Ne t’inquiète pas, mon eau suffira, continuons, ce n’est pas la peine de retourner.
Ainsi, ils se remirent en chemin. Au bout d’une journée, Antanou eut soif et son compagnon refusa de lui donner de l’eau. Comme il insistait, Ansama lui dit :
— Si tu bois une fois de mon eau, tu me donneras un sac de mil.
Antanou donna donc son chargement et resta avec son âne. Mais comme il avait encore soif après avoir bu, son compagnon lui demanda sa monture en échange de son eau. Antanou n’ayant plus vraiment le choix, céda son âne contre un peu d’eau. Malheureusement, il était toujours aussi assoiffé. Il continua à marcher avant de s’écrouler non loin de là, vaincu par la soif. Ansama en profita alors pour lui crever les deux yeux, lui briser les deux mains et les deux pieds puis il partit avec les deux ânes et leur chargement.
Alors qu’Antanou gisait sur le sol, arriva du ciel un oiseau qui lui dit :
— Il y a, non loin d’ici, un arbre dont les branches touchent le sol. Quiconque a les yeux crevés, les mains et les pieds brisés sera guéri s’il en cueille les feuilles et en frotte ses blessures.
Antanou suivit les conseils de l’oiseau et guérit. Vint un second oiseau qui lui dit :
— Quiconque a soif verra aussitôt la pluie tomber s’il coupe les feuilles de cet arbre et les pique avec des épines de dattier.
Suivant une nouvelle fois les conseils de l’oiseau, la pluie se mit à tomber abondamment et il put étancher sa soif.
Vint encore un troisième oiseau qui lui dit :
— Quiconque coupe une branche de cet arbre et en frappe une tombe, fera ressusciter le mort.
Antanou coupa une branche et continua son chemin. Il arriva dans un village où tous les habitants pleuraient la mort du fils du roi, survenue sept jours auparavant. Il se rendit chez le souverain, trouva la tombe du défunt et la fouetta. L’enfant ressuscita. En récompense, le roi lui offrit une femme, une partie de son royaume et de ses biens. Antanou devint très riche.
Pendant ce temps, Ansama avait vendu tout ce qu’il avait emporté au marché. Malheureusement, sur le chemin du retour, des brigands lui volèrent tout son argent. Il devint très pauvre, contraint d’errer et de quémander sa nourriture.
Un jour, il vint trouver Antanou installé sur le trône royal. Celui-ci eut alors pitié de lui et l’installa dans sa cour.
« Le pardon élève l’homme, l’ingratitude l’avilit. »
Une mère, sa fille et la fille de sa coépouse, par Saye Yaguidiéré. Téréli-Tatara
Il était une fois, un village dans lequel les gens s’aimaient beaucoup et où régnait une grande solidarité. Cependant y vivait aussi une famille riche, respectée mais terriblement égoïste. Elle était composée de cinq personnes : le père, deux coépouses et deux filles. Le père s’appelait Amayoko, sa première épouse Yatimé, sa fille Ogohiré, sa seconde épouse Godié et sa fille Yana. Cette famille était tellement égoïste que Godié en mourut. Après ce décès, Yana ne voulait plus vivre avec sa marâtre Yatimé, car celle-ci ne lui donnait rien à manger et la frappait. Elle préparait pourtant chaque jour de bons plats, mais elle les mangeait seule avec sa fille Ogohiré, dont le mari était parti à l’étranger. Yana était altruiste et travailleuse : elle lavait les vêtements, la vaisselle, balayait… Quant à Ogohiré, elle ne travaillait pas et mangeait beaucoup. Lorsqu’elle avait soif, sa demi-sœur lui apportait même à boire.
Un jour, Yana dut entreprendre un long voyage. Et quel voyage ! Sa marâtre lui avait demandé d’aller puiser de l’eau dans un marigot que personne n’avait le droit d’approcher. En fait, la méchante femme souhaitait que la fille de sa coépouse décédée, meure à son tour. Quand Yana prit son seau pour partir puiser de l’eau, les femmes du village se mirent à pleurer et à se lamenter :
—Yana part mourir au marigot, Yana part mourir au marigot !
La jeune fille courageuse quitta le village très tôt le matin. En chemin, elle assista à une querelle entre deux jujubiers[1]. Elle s’approcha d’eux et leur dit :
— La dispute n’apporte rien de bon.
Les jujubiers lui demandèrent :
— Que viens-tu faire ici ?
Elle raconta ses déboires avec sa marâtre et expliqua qu’elle allait chercher de l’eau au marigot interdit. Les jujubiers lui donnèrent des jujubes qu’elle mangea. Les deux arbres lui dirent enfin :
— Tu as notre bénédiction. Puisse Dieu te donner tout ce que tu souhaites.
Elle continua son voyage et rencontra d’autres espèces d’arbres, eux aussi en train de se quereller. Elle leur fit la même remarque qu’aux jujubiers et les arbres lui donnèrent pareilles bénédictions.
Après trois jours de marche, elle arriva au bord du marigot. Elle regarda tout autour d’elle et découvrit, sur sa droite, une paillote près de laquelle une vieille femme fendait du bois. Yana accourut et se saisit de la hache pour l’aider. La femme la remercia et lui demanda de préparer le repas de midi, ce qu’elle accepta volontiers.
Après cela, la vieille lui indiqua un lieu où elle pourrait trouver des os. Yana s’y rendit et trouva effectivement, sur le lieu indiqué, de vieux os. Elle les ramassa, les plongea dans un chaudron et les prépara.
Au fur et à mesure que les os cuisaient, le plat se transformait en un délicieux mélange de riz et de viande. Quand elle eut terminé la préparation, elle partagea le repas avec la vieille. Elle chauffa ensuite de l’eau et lava ses vêtements. La femme, très satisfaite, demanda à Yana ce qu’elle était venue faire en ces lieux. Elle raconta ses mésaventures. À la fin de son récit, la vieille rit et lui dit :
— Ma fille, ma fille, ma fille, reçois mes bénédictions !
Yana passa ainsi un mois chez la vieille femme en l’aidant dans ses tâches quotidiennes. Puis un jour, elle décida de retourner au village pour rapporter l’eau demandée par sa marâtre. Avant de partir, pour la remercier de ses bons services, la vieille femme appela vingt cavaliers en armes, des lions et des éléphants pour défendre Yana. Avant de partir, la vieille lui dit :
— Sors par la porte sans regarder derrière toi.
C’est ainsi que Yana quitta la maison avec autour d’elle des guerriers et de nombreux animaux domestiques : des vaches, des moutons, des chèvres, des ouvriers portant des vêtements, des victuailles, de l’argent. Il y avait même des esclaves. Yana rentra chez elle avec toutes ces richesses.
Quand sa marâtre vit tout cela, elle en fut très jalouse et voulut elle aussi partir au marigot. Elle y envoya sa fille, incarnation de l’impertinence. Ogohiré quitta aussitôt le village. En cours de route, comme Yana, elle vit les jujubiers en train de se quereller. Elle approuva cette dispute et dit en se moquant :
— C’est bien la première fois que je vois des arbres se quereller !
Elle marcha elle aussi deux jours et deux nuits et atteignit le marigot le troisième jour. Elle aperçut la vieille femme qui fendait du bois et se mit à l’insulter. Celle-ci ne lui répondit pas ; elle acheva de fendre son bois, prépara à manger et invita la fille à partager son repas. Le lendemain, les génies vinrent tuer Ogohiré et la transportèrent jusque chez sa mère.
« Il ne faut ni jalouser la richesse d’autrui, ni négliger d’être poli et de bien élever ses enfants. C’est son manque d’éducation qui a coûté la vie à cette fille. »
_____________
[1] ónugo, ónuge. On mange ses fruits crus ou l’on en fait une sorte de gâteau cuit à la vapeur sur des tiges de mil.
Le péteur et le malin, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Il y avait autrefois, tant dans le royaume des hommes que dans celui des animaux, des êtres péteurs et malins.
Dans le royaume des hommes vivait un personnage se croyant plus péteur et plus malin que tous les autres. Un jour, il choisit un bœuf bien gros et bien gras dans son troupeau et partit à la recherche de celui qui serait plus péteur et plus malin que lui. S’il le trouvait, il lui offrirait ce bœuf. Il parcourut le royaume des hommes en long, en large et en travers, mais ne trouva personne qui fût ni plus péteur ni plus malin que lui. De la même façon, il sillonna en vain le royaume des animaux durant trois années avant de revenir dans celui des hommes. De nouveau, il visita chaque village. C’est alors qu’après être entré dans un hameau pour s’y désaltérer, il rencontra un jeune garçon de quatre ans qui jouait au jeu de kintaa[1] sous un arbre. Il envoya l’enfant chercher de l’eau mais, avant de partir, le petit dit à l’homme :
— Si le soleil arrive sur mon trou avant mon retour, prends-le et mets-le à l’ombre.
Trois heures plus tard, l’enfant n’était toujours pas de retour et le soleil vint frapper son trou. Comme le vieux malin voulut le mettre à l’ombre, il creusa un grand trou tout autour du petit pour essayer de l’enlever, mais à chaque fois qu’il voulait y toucher, celui-ci se désagrégeait.
L’enfant revint finalement avec de l’eau. Comme le vieux s’étonnait du temps qu’il avait mis pour cela, le petit lui répondit :
— J’ai pris soin de puiser uniquement l’eau du jour dans le canari de ma mère, car elle l’avait mélangée avec celle de la veille.
Le vieux lui expliqua alors qu’il avait voulu mettre son trou à l’ombre mais qu’à chaque fois qu’il avait essayé, il s’était brisé. L’enfant lui répondit :
— C’est pourtant très facile, il suffit de creuser un nouveau trou à l’ombre et de mettre le sable mouillé dedans !
— Où sont tes parents ? demanda l’homme, inquiet.
— Ils sont partis coudre une mare brisée, répondit imperturbablement l’enfant.
Le vieux s’étonna des propos de l’enfant et réalisa qu’il avait affaire à plus malin que lui. Il lui raconta alors le but de son voyage avec le bœuf. À ces mots, l’enfant paria avec lui. Malin, il l’était assurément, mais péteur ? Il lui fallait le démontrer.
Le vieux péta le premier. Son pet devint un grand vent magique qui fit venir tous les cultivateurs dans les champs. Après le passage de cette tornade, l’enfant péta à son tour. Surgit alors la falaise de Bandiagara qui existe encore de nos jours.
Le vieux laissa alors son bœuf et repartit chez lui tout honteux.
________________
[1] Un trou d’une douzaine de centimètres de diamètre et profond d’autant est creusé dans le sol humide. À une quinzaine de centimètres du bord, on pratique un petit tunnel à l’aide d’un bâton enfoncé obliquement et dont l’extrémité aboutit au fond du trou. On obtient ainsi une sorte de trompe de terre dans laquelle on souffle par le petit trou. Le mugissement attire les bœufs qu’il énerve et dont les enfants évitent les coups de corne en se réfugiant sur les arbres. (D’après M. Griaule – Jeux Dogons – croquis p.92).
L'hyène, ses enfants et les animaux de la brousse, par Saye Yarango. Téréli-Goudio Gourou
Un jour, l'hyène avait faim, si faim qu’elle pouvait à peine marcher. Malgré cela, elle trouva la force de partir à la recherche de quelque proie. Elle avait trois enfants tout aussi stupides qu’elle. Elle parcourut sept villages sans rien trouver à se mettre sous la dent. Heureusement, la chance finit par lui sourire sur le chemin qui menait du septième au huitième village. Elle rencontra un cadavre de chien. Pendant ce temps, ses enfants la poursuivaient. Elle commença à manger seule. À peine eut-elle terminé un gigot, que ses petits arrivèrent. Comme elle ne voulait pas partager sa pitance avec eux, elle trouva un prétexte.
— Voyez mes enfants, dans ce village là-bas devant vous, il y a tellement de chiens morts que vous pourrez vous rassasier à souhait !
C’est ainsi que les trois petits de l'hyène se mirent à courir vers le village. En cours de route, ils rencontrèrent le lion qui leur demanda où ils allaient. Ils lui répondirent qu’il y avait beaucoup de chiens morts dans le prochain village. Le lion se mit à courir à son tour puis, petit à petit, tous les animaux de la brousse en furent informés et coururent eux aussi vers le village.
L'hyène, voyant courir tous ces animaux, crut à son tour à cette nouvelle et se précipita à leur suite !
« C’est pourquoi, depuis ce jour, on considère l'hyène comme l’animal le plus sot qui soit. »
L’enfant et le roi, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Il était une fois une femme stérile qui était la risée du village. Toutes les femmes de son âge avaient déjà deux ou trois enfants tandis qu’elle n’en avait aucun.
Un jour, désespérée, elle partit en brousse s’asseoir sous un grand tamarinier et commença à pleurer. C’est alors que surgit un génie :
— Femme, pourquoi pleures-tu ?
— Toutes les femmes du village se moquent de moi parce que je n’ai donné aucun enfant à mon mari.
— C’est très facile, femme, continua le génie, rentre chez toi et prépare de la bouillie de mil. Avant de mettre la farine, prends une louche d’eau chaude, verses-en par trois fois sur ton genou et tu auras un garçon.
La femme s’en retourna au village et fit ce que lui avait conseillé le génie. Petit à petit, son genou enfla.
Un jour, après être restée une année durant à la maison, elle décida de sortir. Elle se mit à ramper sur le sol et son genou éclata. Trois jours plus tard en sortit un beau garçon.
Peu de temps après, l’enfant s’en allait déjà seul aux champs avec sa houe. Quand on lui demandait son nom, il répondait qu’il s’appelait Kirètèlisso[1]. Quand le roi entendit ce nom, il envoya ses serviteurs apporter du mil à la mère de l’enfant. Ils lui dirent :
— Le roi te demande de faire de la bière avec ce mil d’ici demain[2] car il y aura une grande fête.
La femme commençait à pleurer devant le mil quand son fils entra.
— Mère, que se passe-t-il ?
— C’est le roi ! Il m’a demandé de préparer de la bière pour demain avec ce mil.
— Mère, mais ce n’est rien !
L’enfant se saisit du panier le mil et le rentra dans la maison. Le soir venu, il prit une graine de calebasse et se rendit chez le roi.
— Je vous salue Majesté. Ma mère m’a chargé de vous apporter cette graine de calebasse. Semez-la dès maintenant. Le fruit doit être mûr dès ce soir afin que ma mère puisse l’utiliser comme louche pour servir la bière de mil.
L’enfant donna la graine au roi et partit. Comme le souverain savait qu’une telle chose était impossible à faire, il renvoya ses serviteurs chercher le mil chez la femme.
Un autre jour, le roi envoya un bœuf chez la mère de Kirètèlisso afin qu’il donnât naissance à un veau. L’enfant, qui était présent, ne répondit rien à la vue de cet animal. Vers midi, alors que le roi mangeait, il se rendit à sa cour, entra en omettant les salutations d’usage et grimpa sur l’arbre planté au beau milieu de la cour royale pour y cueillir des feuilles.
Le roi sortit et interpella l’enfant :
— Tu viens ici sans nous saluer et tu cueilles les feuilles de mon arbre !
L’enfant répondit :
— Oh, pardon Majesté ! J’étais pressé d’arriver à la maison pour laver le fils de mon oncle avec ces feuilles.
Le roi s’étonna :
— As-tu déjà vu un homme donner naissance à un enfant ?
Le garçon lui répondit :
— Dans ce cas, venez reprendre le bœuf que vous avez apporté à ma mère !
Trouvant l’enfant plus intelligent que lui, le roi le laissa désormais en paix.
_______________
[1] Litt. “Il n’y a rien que je ne saurai jamais”.
[2] Il faut environ huit jours pour préparer la bière de mil (kᴐɲɔ̃) : trois pour la germination des graines de sorgho rouge, deux pour leur séchage et trois pour la cuisson et la fermentation.
Le mariage traditionnel, par Saye Kito. Téréli-Tarara
Il y a très longtemps, dans un village de cultivateurs, une famille refusa pour la première fois le mariage traditionnel.
Un jour naquit dans cette famille, une très belle fille. Ainsi que le veut la coutume, ses parents annoncèrent la nouvelle à une vieille femme qui, à son tour, avertit la population. Le lendemain de la naissance, le matin de très bonne heure, les femmes du village vinrent, avant les hommes, rendre visite au nouveau-né et à sa mère. Chacune s’informa tout d’abord du sexe de l’enfant puis offrit à la famille des poulets, du mil, des cauris ou encore de la bière de mil. On félicita la mère en ces termes : « Félicitations. Que Dieu fasse grandir ton enfant et que tu puisses t’asseoir auprès de son ombre[1]. » Ce à quoi la mère répondait : « Amin[2], amin, que Dieu réponde à votre prière ! »
Ainsi que le veut la coutume, au cours de cette visite, une femme dit à la mère de l’enfant :
— Comme c’est une fille, elle sera la femme de mon fils Atanou.
La mère accepta et souhaita longue vie aux futurs époux.
Le nouveau-né s’appelait Yati. Il grandit et devint la plus belle fille du village. Lorsque celle-ci eut quatorze ans, âge prédestiné pour les fiançailles, un matin de très bonne heure, les parents d’Atanou envoyèrent, par des forgerons[3], un panier[4] rempli de mil et deux coqs, un blanc et un noir. Mais, comme Yati était très belle, ses parents refusèrent les fiançailles avec Atanou, bien que la mère de celui-ci en ait fait la demande la première. Par la suite, beaucoup de jeunes gens réclamèrent sa main, mais les parents de Yati refusèrent.
Comme la solution à ce genre de problème revient à la mère, un jour, celle de Yati annonça à la population qu’elle donnerait sa fille à l’homme qui aurait pu plonger trois fois dans ses latrines. Le dernier jour de la semaine, tous les jeunes prétendants se retrouvèrent devant le trou. Dès les premières heures, les garçons s’y bousculèrent. Cependant, après avoir plongé une première fois et en être ressorti, aucun d’entre eux n’avait le cœur pour une seconde tentative et, a fortiori, aucun ne plongea trois fois consécutives. Atanou, qui convoitait la belle Yati, était lui aussi venu. Il plongea une fois, deux fois, trois fois et tous les jeunes garçons se moquèrent de la mère de Yati : « Ta fille va bientôt te quitter ! »
Chacun rentra chez lui.
Quelques jours plus tard, Atanou et quelques-uns de ses amis se rendirent chez Yati. Mais cette fois encore, sa mère refusa de laisser sa fille au garçon. Alors, ce dernier rentra avec ses amis en silence.
Le lendemain, avant le premier chant du coq, Atanou remplit un canari de miel et de gris-gris et alla le déposer sur la route par laquelle les femmes partent en brousse pour aller chercher du bois de chauffe. Comme chaque jour, Yati, accompagnée de ses amies, emprunta cette route et trouva le canari. Curieuses qu’elles étaient, chacune d’elles goûta le miel. Mais au moment où Yati le dégusta à son tour, son vagin tomba à terre et s’enfuit en courant. Sans perdre de temps, elle le poursuivit jusqu’à ce que la soif et la faim l’arrêtassent.
Elle aperçut alors son vagin qui se reposait à l’ombre d’un arbre et crut qu’il dormait. Elle se cacha derrière le tronc pour le surprendre mais, au moment où elle voulut le saisir, il détala et alla se reposer sous un autre arbre. Désespérée, elle partit trouver sa mère et lui narra sa mésaventure. Les deux femmes sortirent à la recherche du vagin. Elles le trouvèrent en train de se reposer à l’ombre d’un arbre.
Elles s’approchèrent, se cachèrent derrière le tronc et, subrepticement, se jetèrent sur lui mais, une fois de plus, il leur échappa. Comme si cela ne suffisait pas, la mère perdit elle aussi son propre vagin qui s’enfuit en courant. Toute la journée, les deux femmes poursuivirent leur organe, mais ne parvinrent pas à le rattraper. Épuisées, elles rentrèrent finalement au village.
Émue par cet événement, toute la population se réunit pour chercher une solution. Au cours de leur débat, un homme appela les deux femmes et leur dit :
— D’après mon analyse, tout ce qui vous arrive est le fait d’Atanou. Allez le voir en lui disant que Yati sera à lui.
Les deux femmes, accompagnées par le hogon et de nombreuses personnes, se rendirent dans la famille d’Atanou. Tout en demandant pardon au garçon, elles acceptèrent le mariage. Atanou prit alors une tige de mil avec laquelle il frappa quatre fois les fesses de Yati et de sa mère[5]. Dans l’instant, les deux vagins réapparurent et reprirent leur place.
« Depuis ce jour, on respecta les promesses de mariages. »
_______________
[1] Métaphore. Dans l’Afrique traditionnelle, les enfants pourvoient aux besoins de leurs parents lorsqu’ils sont âgés.
[2] Terme utilisé par les musulmans, équivalent à l'amen des chrétiens.
[3] Les forgerons jouent le rôle de médiateur. Dans la gestion d’un litige, on envoie tout d’abord des parents ou des amis pour tenter de négocier un règlement amiable, demander pardon. En cas d’échec, on délègue les forgerons.
[4] tɑ̀du. Panier à fond carré et ouverture ronde symbolique. Une fois renversé, il représente le ciel (fond carré, image des points cardinaux) et la Terre (ouverture circulaire).
[5] Sur le plan symbolique, le chiffre quatre est lié à la femme et le trois à l’homme.
Chant de réjouissances sāgire
Le sãgire est un chant de réjouissances interprété par les femmes, lors des mariages et des cérémonies joyeuses. Il est ici chanté par quatre femmes, dont deux percutent à mains nues une grosse demi-calebasse kᴐrɔ́ posée sur le sol. Un homme joue quant à lui un tambour à tension variable en forme de sablier gòmbòy.
Lieu : Mali, vill. de Bandiagara. Durée : 03:46. © P. Kersalé 1993-2024.
Pourquoi le chien vit-il au village ?, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Il y a très longtemps, le chien décida de quitter le village pour aller vivre en brousse car il était maltraité par les enfants. En effet, au lieu de lui donner de la viande, ceux-ci ne lui laissaient que les os.
Un matin où il s’était énervé, le chien s’en alla trouver le chacal. Il lui annonça :
— Mon ami le chacal, je vais désormais devenir ton voisin !
Le chacal, étonné, demanda au nouveau venu :
— Combien de plans as-tu préparés pour échapper aux pièges tendus par les gros animaux sauvages ?
— Sept mille sept cent soixante-dix-sept, répondit le chien avec beaucoup d’assurance.
Cette réponse enthousiasma le chacal qui conclut :
— Viens me voir dès demain !
Le chien rentra au village pour saluer son maître et regagna aussitôt la brousse. Il devint l’ami intime du chacal qui espérait, grâce à cette alliance, échapper aux pièges tendus par ses ennemis. Ce dernier offrit tout d’abord à son compagnon une année entière de repos afin qu’il récupérât de toutes les fatigues accumulées au cours de sa vie.
Un jour, durant cette année paisible, le chien, pressé d’aller à la chasse, accompagna le chacal. Ils passèrent la journée entière sans attraper de proie. Vers le petit soir, une pluie venue de l’Est menaçait. Bien qu’ils fussent très loin de leur demeure, ils tentèrent de la rejoindre. Mais entre-temps, la nuit les rattrapa. Aussi se réfugièrent-ils chez l'hyène, partie elle aussi à la chasse et pas encore rentrée. Ils pénétrèrent chez elle et allumèrent un feu pour se réchauffer. Quand l'hyène arriva, elle grelottait. Mais lorsqu’elle aperçut les deux étrangers, elle fut aussitôt envahie d’une immense joie et ses frissons s’évanouirent. En s’approchant du chien et du chacal, sa joie augmenta encore. Elle ressortit pour savourer ce bonheur puis revint en dansant.
Chaque fois qu’elle franchissait la porte, elle exultait en contemplant ces deux nouvelles têtes.
Pendant ce temps, le chacal dit au chien :
— Sauve-moi, toi qui es très intelligent et très malin.
Le chien répondit :
— Toutes mes idées sont parties, il ne m’en reste plus que trois. La première est de courir, la seconde d’aboyer et la troisième de lutter avec l'hyène.
Le chacal rétorqua :
— Mais je croyais être nourri de ton intelligence jusqu’à ma mort ! Tes trois idées ne peuvent résoudre notre problème. Si tu cours, elle nous rattrapera car elle est plus rapide que nous. Si tu aboies en montrant les dents, elle te dévorera car ses crocs sont plus longs que les tiens et si tu luttes, tu n’as guère plus de chance, car elle est vraiment plus forte que toi. Quoi qu’il en soit, si tu agis seul, tu mourras. Alors je vais t’aider. Quand elle reviendra, dis lui d’entrer en prétextant que nous sommes venus lui dire quelque chose d’important.
Quand l'hyène revint, le chien lui demanda respectueusement d’entrer dans la maison puis le chacal prit la parole :
— Mon ami est venu te demander de l’aide car, dans son village, il y a trop de cadavres d’animaux et l’odeur dérange la population.
C’est ainsi que les trois compagnons prirent le chemin du village, le chien en éclaireur et le chacal fermant la colonne. Quand ils arrivèrent près du but, le chacal lança au chien, qui détala, le signal convenu par avance. l’hyène ne put voir que la poussière s’élever devant elle. Elle voulut alors attaquer le chacal mais, quand elle se retourna, elle ne vit la aussi que poussière. l’hyène repartit chez elle couverte de honte.
« Depuis ce jour, le chien n’a plus quitté le village. »
Pourquoi dieu ne parle-t-il plus aux hommes ?, par Douyon Domo. Dourou-Komokan
Lors de la création du monde, partout régnait le bonheur. Les hommes communiquaient directement avec Dieu et celui-ci exauçait aussitôt leurs prières. À cette époque-là, on ne connaissait ni la jalousie ni l’orgueil. Malheureusement, au cours de son existence, l’homme changea. Ainsi, un jour, un homme du nom de Dianviré partit à Omo[1] pour rendre visite à ses oncles, les frères de sa mère. Il effectua seul ce voyage un mois après son mariage. Il resta à Omo plus de trois mois. Durant son absence, un homme très jaloux, nommé Amayoko, courtisa sa femme et l’invita chaque nuit chez lui.
Entre-temps, Dianviré revint au village. Un mois plus tard, il apprit que sa femme était enceinte. Troublé par cette nouvelle, il se rendit chez ses beaux-parents. D’emblée, il attaqua sa femme :
— Il paraît que tu es enceinte ?
— Oui, répondit la femme après beaucoup d’hésitation, j’en suis désolée.
— Et qui est le père, continua Dianviré ?
— C’est Amayoko, le fils du chasseur.
Sans tarder, Dianviré se rendit chez l’homme et tempêta :
— N’as-tu pas d’autre travail que de faire des enfants à la femme des autres !
— Je suis désolé, répondit Amayoko, honteux.
Alors Dianviré, très fâché, s’exclama :
— Que Dieu te tue !
Et Amayoko mourut.
Entre-temps la mère d’Amayoko arriva. Elle s’exclama à son tour :
— Dianviré, que Dieu te tue et donne la vie à mon enfant !
La vœu de la femme fut exaucé.
Troublée par cette nouvelle, la famille de Dianviré se rendit chez Amayoko. Très fâchée, la mère de Dianviré dit à celle d’Amayoko :
— Que Dieu te tue et ne te redonne plus jamais vie !
Et la femme mourut.
De son côté, la famille d’Amayoko fit à son tour entendre sa voix à l’encontre de celle de Dianviré :
— Que Dieu tue toute votre famille et ne lui redonne plus jamais vie !
Et toute la famille trépassa.
Ainsi, par de telles invocations, la plupart des habitants du village moururent. Comme Dieu ne voulait pas tuer toute la population en satisfaisant les demandes des uns et des autres, il cessa de répondre aux prières des hommes et de leur parler.
« Voilà comment l’homme est devenu le géniteur de ses propres malheurs. »
________________
[1] Omo : village de la plaine situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Koro.
Le tambour enchanté, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Un jour, quelqu’un arriva en hâte pour avertir l'hyène de se rendre d’urgence aux funérailles de sa belle-mère. Fanfaronne et désireuse de briller en public, elle alla aussitôt trouver le lièvre.
— Camarade, il faut m’accompagner aux funérailles, dit-elle. Tu m’aideras à y paraître à mon avantage. Je vais emporter mon tambour[1] et je te mettrai dedans. Quand je chanterai, tu répondras.
Le lièvre ajouta :
— J’accepte, mais attention, il ne faudra pas m’oublier au moment du repas !
Arrivée sur le lieu des funérailles, l'hyène attendit que la foule fût suffisamment dense puis elle se mit à frapper son tambour en chantant :
Moi l'hyène,
Quand je frappe mon tambour,
Quand je frappe mon tambour,
Mon tambour fait entendre une voix.
De l’intérieur de l’instrument, le lièvre répondit :
Hé hé ! C’est la vérité
Hé hé ! C’est la vérité.
Tous les curieux venus entourer le chanteur s’étonnèrent :
— On n’a jamais entendu un tambour parler !
L'hyène fit sensation. Mais au moment du repas, aveuglée par la gloire, elle en oublia le lièvre et ne lui donna ni à manger ni à boire.
Ce dernier décida alors de se venger et de se rappeler à l’attention de l’ingrate. Lorsque l'hyène frappa de nouveau son tambour, il conserva obstinément le silence. L’instrument magique avait perdu sa voix. Gênée, l'hyène lança aux spectateurs :
— Attendez-moi, je dois régler une partie de mon instrument !
Elle se retira alors dans une case à l’abri des regards et s’entretint avec le lièvre qui accepta finalement, après s’être rassasié, de reprendre son rôle.
Ainsi l'hyène put de nouveau se tailler un beau succès[2].
[1] bɑr(u)bɑ́, bɑr(u)pó : tambour sphérique (timbale) en calebasse recouvert d’une peau accordable avec une pastille composée d’un mélange de cervelle de vache et d’huile de sɑ́ (Lannea acida) fixée en son centre. Ce type de tambour est utilisé dans divers rituels dogon. Il symbolise la maternité.
[2] Il peut paraître curieux que le lièvre accepte aussi facilement cette tâche mais, en pays dogon, on ne peut refuser de rendre un service, sauf cas de force majeure.
Chant de bienvenue
Chant en l’honneur du grand prophète et chanteur Ambiré. Quand il se rendait dans un village, les gens voulaient le rencontrer, lui tendre la main. Ce même chant est ici interprété en l’honneur des invités. Il est accompagné d'une timbale en calebasse barba.
Lieu : Mali, vill. de Téréli. Durée : 03:54. © Patrick Kersalé 1993-2024.
Yassama, par Saye Apomi. Téréli-Sodangha
Yassama était une belle femme qui ne respectait pas son mari. Une année après son mariage, elle tomba enceinte. Il y avait, dans son village, une loi qui interdisait aux femmes enceintes d’aller en brousse. Malgré cela, Yassama s’y rendait pour y ramasser du bois de chauffage.
Un jour, vers le terme de sa grossesse, elle partit en brousse comme à son habitude. Elle coupa du bois jusqu’au moment où le soleil s’apprêtait à disparaître derrière l’horizon. Sur le chemin du retour, son ventre commença à lui faire mal. Elle s’arrêta. C’est alors qu’elle mit au monde, dans une grande souffrance, deux jumeaux[1] sous un baobab. Mais au même moment, Dieu envoya ses anges[2] pour prendre les enfants. De retour au village, Yassama expliqua avec regret son aventure à son mari. Ce dernier la frappa alors frénétiquement et la chassa de la famille. Sur le champ, le mari accompagné de deux amis, se rendit sous le baobab, mais ils ne trouvèrent rien. À leur retour, Yassama était devenue folle.
Vingt années plus tard, alors que Yassama passait la nuit en brousse, Dieu décida de donner un nom à chaque enfant ; il nomma le premier né Adiè et le second Assè et leur dit :
— Il est maintenant temps de vous envoyer chez votre mère. Partez à sa recherche !
— Mais comment retrouver notre mère ? demandèrent les jumeaux.
— Vous passerez dans tous les villages et demanderez la femme qui avait laissé ses enfants sous le baobab. Elle est votre mère.
Le jour de leur départ, Dieu leur donna deux chevaux, deux tambours et beaucoup de richesses. Un beau matin, les deux garçons, qui chevauchaient allègrement, se retrouvèrent sur la Terre. Ils étaient suivis par des hordes d’animaux : des ânes, des vaches, des chameaux portant de l’or et des cauris. Dès le premier soir, Adiè et Assè arrivèrent dans un village. Au moment où la population sortit pour les accueillir, ils se mirent à chanter en s’accompagnant de leur tambour :
— Adiè et Assè vous saluent, les tambours vous saluent.
— Où allez-vous ? leur demanda la population en chantant.
— Nous cherchons notre mère, une femme qui a laissé ses enfants en brousse.
— Ne suis-je pas votre mère ? répondit chacune des femmes toujours en chantant.
— Sous quel arbre avez-vous laissé vos enfants, demandèrent Adiè et Assè ?
— Sous le karité répondirent les unes, sous le nèrè continuèrent les autres.
— Non, non, vous n’êtes pas notre mère !
Sans perdre de temps, Adiè et Assè continuèrent leur recherche. Ils arrivèrent bientôt dans un autre village avec toutes leurs richesses. Là non plus ils ne trouvèrent pas leur mère.
Après avoir visité ainsi dix villages, les deux garçons arrivèrent dans un onzième.
Ils chantèrent :
— Adiè et Assè vous saluent, les tambours vous saluent.
— Où allez-vous ? leur demanda la population en chantant.
— Nous cherchons notre mère, une femme qui a laissé ses enfants en brousse.
— Ne suis-je pas votre mère ? répondirent chacune des femmes à la vue des richesses.
— Sous quel arbre avez-vous laissé vos enfants ? demandèrent Adiè et Assè.
— Sous le karité[3] répondirent les unes, sous le nèrè[4] continuèrent les autres.
— Non, non, vous n’êtes pas notre mère !
Adiè et Assè passèrent la journée dans ce village. Le soir, au moment de leur départ, Yassama apprit par une petite fille qu’il y avait deux garçons qui cherchaient leur mère, une mère qui les avaient enfantés en brousse. Connaissant déjà la chanson rapportée par la petite fille, Yassama se jeta au milieu de la foule et dit :
— Je suis votre mère, je vous ai enfantés sous le baobab.
Les deux garçons, remplis de joie, se jetèrent sur leur mère, la prirent dans leurs bras et l’habillèrent. Aussitôt Yassama redevint normale. Après quelques instants, elle accompagna ses enfants chez leur père qui accepta la réconciliation avec Yassama. La famille organisa une grande fête qui dura cinq jours.
Depuis ce jour, afin que de tels problèmes ne se reproduisent plus, les gens considérèrent un arbre situé à l’entrée du village comme une maison. Chaque année, ils y font des sacrifices. Ainsi, naître sous cet arbre est équivalent à naître à la maison.
____________
[1] jiŋɛ́. La naissance de jumeaux est considérée comme particulièrement bénéfique et comme un idéal de fécondité. La gémellité représente la règle primordiale des naissances établies par le dieu Amma, mais les hommes l’ont perdue par suite des désordres du Renard. Elle est un aspect de la vision dualiste du monde, caractéristique de la culture dogon. (D’après G. Calame-Griaule. Dictionnaire dogon).
[2] La présence, en pays dogon, de missionnaires chrétiens ou musulmans donne parfois une dimension syncrétique à la religion traditionnelle.
[3] mìɲu. (Butyrosperum parkii). Arbre des régions sahéliennes. Les femmes extraient de leurs noix une substance rouge devenant blanche après un long malaxage : c’est le beurre de karité, utilisé comme cosmétique, médicament ou ingrédient culinaire.
[4] yurõ. (Parkia biglobosa). Connu sous le nom de “nèrè de Gambie”. On consomme ses fruits.
Le lièvre tombe dans son propre piège, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Il y a très longtemps, certains animaux sauvages se moquaient tellement de leurs semblables, qu’ils avaient dû changer leurs habitudes de vie. Ainsi l'hyène avait-elle cessé de se promener le jour, de peur d’être la risée de ceux qu’elle croisait. Désormais, pour chercher ses proies, elle sortait la nuit, après le couvre-feu des bêtes sauvages. Comme le lièvre était lui-même victime de ces moqueries, un jour, il rassembla tous les animaux sauvages sur la place publique et leur dit :
— Depuis de nombreuses années, beaucoup d’entre nous ont peur de se promener le jour, telle ma voisine l'hyène. Nous devons nous entendre et ne plus enfreindre la liberté de nos frères. Je vous propose donc ceci : même si quelqu’un fait une bêtise, personne ne devra se moquer de lui et ce, jusqu’à la fin des temps. Que Dieu tue quiconque enfreindra cette loi, même en cachette !
Cette recommandation plut tellement aux animaux, que tout le monde la respecta pendant longtemps.
Comme le lièvre était pauvre, il décida de tuer les animaux plus riches que lui. Un matin, il prit sa houe et partit sur la colline où passent habituellement passe beaucoup de monde. Il se mit à cultiver une grande surface pierreuse. Arriva l’antilope. En passant, elle se dit à voix basse : « C’est idiot, il vient cultiver ce terrain où jamais la moindre herbe n’a poussé depuis la création du monde. C’est vrai, c’est idiot ! »
À peine eut-elle terminé de parler que le lièvre s’exclama :
— Notre loi condamne ceux qui se moquent de leur prochain. Que tu meures !
Et aussitôt, l’antilope tomba devant lui. Le lièvre emporta son corps dans une grotte se trouvant près de son champ. Après cela, l’éléphant arriva. Comme l’antilope, il s’étonna en prononçant des paroles similaires. Le lièvre s’exclama de nouveau :
— Notre loi condamne ceux qui se moquent de leur prochain. Que tu meures !
Et le grand animal tomba aux pieds du cultivateur qui l’emporta dans sa grotte. Ainsi, presque tous les animaux sauvages trépassèrent les uns après les autres. Vers le petit soir, le lièvre, très fatigué, voulait s’en retourner, quand il vit, au loin, arriver la pintade. Il pensa : « Voici venir l’animal le plus malin de la brousse. Je vais le tuer et je pourrai enfin prendre sa place ! »
À son arrivée, le lièvre prêta attention à ses paroles, mais la pintade ne fit aucun commentaire. Il lui demanda :
— Où vas-tu si vite ?
— Je vais chez Yètimè, la femme du lion, me faire tresser les cheveux.
À ces mots, le lièvre s’étonna[1] mais la pintade s’écria :
— C’est toi-même qui avais proposé notre loi. Il est injuste que tu te moques de moi ! Que la loi te frappe !
Et le lièvre trépassa.
______________
[1] Car le sommet du crâne de la pintade est chauve.
Pourquoi les hommes dirigent-ils le monde ?, par Dolo Soumaïla. Sangha-Bongo
À l’origine des temps, le monde était dirigé par les femmes. Alors pourquoi aujourd’hui tout a changé ?
Tout a commencé dans un petit hameau de cultivateurs où vivait un célèbre chasseur du nom d’Amassagou. Cet homme possédait des centaines de chiens, fidèles compagnons de chasse. Il avait une femme, véritable sorcière. Quant à lui, il avait hérité de son père de grands pouvoirs de sorcellerie.
Amassagou, comme son père, avait pour seule activité la chasse. Grâce à ses chiens, il avait presque éradiqué tous les animaux vivants dans la forêt proche du hameau. Même les génies de la brousse, dérangés par ses coups de fusil, s’étaient mis en colère.
Un jour, un génie furieux se transforma en une belle jeune fille et se rendit au village d’Amassagou. Elle se donna le nom de Yasserou. Le lendemain de son arrivée dans le village, elle annonça qu’elle cherchait un brave mari. Des centaines de jeunes gens se présentèrent à elle, mais seul Amassagou parvint à l’arracher. Après leur mariage, la jeune femme annonça à son mari qu’elle ne se nourrissait que de viande de chien. Comme à cette époque les femmes avaient le pouvoir sur les hommes, Amassagou tuait chaque jour un chien et plus leur nombre diminuait, plus il était désœuvré et moins il allait à la chasse. Jusqu’au jour où il ne lui resta plus qu’un chien, le doyen de la meute. Pendant tout ce temps, la mère d’Amassagou, la sorcière, avait ramassé les os des chiens que Yasserou avait mangés et les avait soigneusement placés dans un grand canari. Arriva le jour où il tua le dernier chien. Ce jour-là fut fatal pour lui. Non seulement il n’avait plus de chien, mais sa femme le quitta pour aller rejoindre les génies de la brousse. Désespéré, il abandonna toute activité et partit à la recherche de sa femme. Des mois passèrent. Ne trouvant nulle trace de son épouse, il se décida finalement, un jour, à retourner à la chasse.
Au premier coup de fusil, tous les animaux de la forêt revenus en l’absence d’Amassagou, l’encerclèrent.
Ne pouvant tuer tous ces animaux, il grimpa sur un baobab. Mais les bêtes sauvages attendirent au pied de l’arbre. La nuit commençait à tomber quand Amassagou se rappela l’un des secrets que son père lui avait donné. Il arracha quelques poils de son sexe, dit une parole magique et les lança en l’air. Quelques instants plus tard, ces poils tombèrent dans les yeux de sa mère qui saisit alors ses cauris et fit une divination. Elle découvrit que son fils était dans une situation grave. Alors elle enleva à son tour quelques poils de son sexe, dit une parole magique et les plaça dans le canari contenant les os des chiens. Aussitôt, des centaines de chiens en sortirent et s’enfuirent vers le baobab où se trouvait Amassagou. Ils attaquèrent les animaux qui montaient la garde au pied de l’arbre. Certains eurent le temps de prendre la fuite, mais beaucoup trouvèrent la mort. Ainsi débarrassé, Amassagou descendit de son perchoir et regagna le soir même son village, accompagné de ses chiens. Comme le village était dirigé par les femmes, le chasseur leur demanda d’envoyer leur mari dans la forêt pour y chercher du bois de chauffe[1]. Toutes les femmes acceptèrent cette demande, excepté la chef du village. Quand les hommes revinrent, chargés de viande, Amassagou les invita à rentrer chez eux. Malheureusement la chef du village eut vent de ce manège. Elle ordonna aux femmes de frapper leur mari. Compte tenu des lois qui régissaient la société de l’époque, ces derniers ne pouvaient réagir et devaient se laisser faire. Mais c’en était trop. Les hommes décidèrent d’un commun accord d’aller fonder un village à côté de celui de leur femme et de désigner leur propre chef. Restés longtemps séparés, les femmes commençant à leur manquer, ils s’en allèrent, une nuit, ravir la femme de leur choix.
« Depuis ce jour, les hommes soumirent les femmes. »
_____________
[1] Métaphore qui désigne en réalité la viande des animaux tués par ses chiens, ceci afin d’échapper au courroux de la chef du village.
Pourquoi le cheval ne parle-t-il pas ?, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Il y a très longtemps, le cheval parlait comme une personne humaine. C’est pourquoi on a aujourd’hui tellement de respect pour lui. Autrefois, son travail était d’aller guerroyer. On ne l’égorgeait jamais pour le manger et on ne le tuait pas sans raison. Il y avait, à cette époque, un village interdit aux femmes. Plusieurs avaient essayé d’y pénétrer, mais toutes avaient péri. En ce temps-là, vivait Yèsama, la fille du roi. Elle était très séduisante quand elle revêtait ses beaux habits, se parait de ses colliers et de ses bracelets en or. Quand elle portait un costume d’homme, celui qui ne la connaissait pas ne pouvait pas dire qu’elle était femme. Dans tout le royaume, on parlait de sa beauté.
Un jour, elle décida de se rendre dans le village interdit aux femmes. Ses parents la supplièrent de ne pas y aller, mais elle s’entêta. Un matin, elle s’habilla comme les cavaliers, monta sur un cheval et partit avec ses frères. À leur arrivée, le fétiche du village s’écria :
— Hé, faites sortir ces étrangers, il y a une femme parmi eux ! Notre village est souillé ! Le malheur va nous frapper !
On fit venir les étrangers chez le chef du village, mais personne ne vit de femme parmi eux. Le fétiche cria une seconde fois :
— Hé, faites sortir ces étrangers, il y a une femme parmi eux ! Notre village est souillé ! Le malheur va nous frapper !
Les villageois s’étonnèrent et cherchèrent rapidement un plan pour découvrir l’intruse.
Quand ils en eurent trouvé un, le cheval dit à Yèsama :
— Gare à toi, ils cherchent à te découvrir. S’ils apportent de l’eau pour ta toilette, ne prends pas l’eau chaude. S’ils t’offrent de la viande, ne mange pas la viande cuite.
Yèsama suivit scrupuleusement les conseils de son cheval et échappa au piège.
À la fin de leur séjour, les villageois organisèrent une course de chevaux au cours de laquelle tous furent battus par Yèsama. Elle chevaucha plus vite et plus loin que tous. C’est alors qu’elle montra ses seins et déclara qu’elle était femme. Les cavaliers poursuivirent les étrangers, mais ne purent les rattraper. Furieux, le fétiche du village se fâcha et se transforma en pluie. Comme la cavalière mettait le pied à terre pour s’abriter, le cheval clairvoyant enleva sa peau pour la couvrir. En effet, si elle était mouillée par cette eau, elle deviendrait stérile. Après la pluie, la fille sortit de la peau du cheval et rentra toute joyeuse avec ses frères à la maison.
Quand son père lui demanda de raconter son voyage, elle expliqua que le cheval n’avait rien fait et qu’elle seule s’était débrouillée pour rentrer. C’est alors que le cheval hennit et cessa de parler.
Depuis lors, à cause de l’ingratitude de cette femme, le cheval a perdu la parole.
Le hogon et le malin, par Dolo Soumaïla. Sangha-Bongo
Il était une fois deux hommes qui vivaient dans deux villages différents : Atimé, le hogon, à Pèguè, et Djonjoro, le malin, à Koundou. Le hogon était un homme respecté dans son village et personne ne discutait jamais ses décisions. Il était considéré par tous comme le plus intelligent.
Un jour, Djonjoro partit en voyage à cheval[1], voyage qui le conduisit à Pèguè. En arrivant, il fut présenté à Atimé le hogon[2] ainsi que le veut la tradition.
Le lendemain matin, Djonjoro se leva très tôt. Au moment où il arriva près de son cheval, il le trouva en train de déféquer. Comme il était malin, il sortit de sa poche une pépite d’or, la dissimula dans le crottin et commença à frapper sa monture. Réveillé par le bruit des coups, Atimé demanda :
— Mais pourquoi frappes-tu ton cheval ?
— Il m’a désobéi. Chez moi, chaque fois qu’il défèque, sort en même temps une pépite d’or. Aussi doit-il s’abstenir lorsque nous sommes en voyage !
Resté silencieux pendant quelques instants, le hogon demanda à Djonjoro :
— Peux-tu me vendre ton cheval ?
— Je ne devrais pas, mais comme vous êtes notre hogon, je ne peux refuser.
— Combien en veux-tu ? demanda le hogon.
— Un sac de cauris, répondit Djonjoro.
Le soir même, Atimé paya le cheval en présence de tous les conseillers du village puis Djonjoro rentra à pieds à Kondo avec son sac de cauris.
Au village de Pèguè, le cheval déféquait, mais son crottin ne contenait pas la moindre trace d’or. Le hogon furieux envoya trois de ses conseillers chercher le malin. Djonjoro, confronté à cette délicate situation, usa de nouveau de ruse. Il dépouilla une souris, remplit sa peau de sang de poule et l’attacha au cou de sa mère qu’il emmena avec lui jusqu’à Pèguè en compagnie des trois conseillers.
Le lendemain matin, tous les vieux du village se réunirent au grand abri[3] pour juger Djonjoro. Au cours du jugement, la mère de l’accusé prenait la parole[4] à tort et à travers et accusait son fils. C’est alors que Djonjoro se fâcha et l’égorgea. Du coup, le hogon et ses conseillers décidèrent de suspendre la séance. Mais l’accusé demanda au hogon de continuer son jugement et proclama qu’il pourrait faire ressusciter sa mère. Intrigué par ce propos, le hogon pardonna à Djonjoro et lui rendit la liberté. Après que tous les conseillers furent rentrés chez eux, Djonjoro sortit de son sac le bout d’une queue-de-cheval et frappa quatre fois[5] la tête de sa mère qui aussitôt se leva. En réalité, Djonjoro n’avait fait que percer de son couteau la peau de la souris contenant le sang de poule.
Le hogon, fasciné par ce miracle, proposa à Djonjoro de lui acheter sa queue-de-cheval. Comme la première fois, le hogon offrit en échange un sac de cauris et les deux protagonistes rentrèrent chez eux.
Le hogon avait toute confiance dans le gri-gri du malin. Durant trois mois, il refusa d’envoyer les offrandes rituelles à Arou[6] où se trouve Amma Na[7]. Pour cela, il fut convoqué à Arou par les hogons des autres villages. Il s’y rendit en compagnie de sa femme. Comme prévu, au cours de la réunion, cette dernière prit la parole à tort et à travers. C’est alors qu’Atimé se fâcha et l’égorgea. Il fut alors décidé de mettre fin à la réunion. Le hogon de Pèguè assura alors qu’il ferait ressusciter sa femme. Impressionnés par le pouvoir de l’accusé, les hogons lui rendirent la liberté. Tout le monde s’éclipsa à l’exception d’Atimé et, bien entendu, de la dépouille de sa femme. Il sortit de sa poche sa queue-de-cheval et frappa quatre fois le cadavre. Rien ne se passa. Il recommença une seconde fois. Rien. Une profonde angoisse l’envahit.
Il réalisa alors qu’il avait été de nouveau berné par le rusé Djonjoro.
De retour à Pèguè, il fit ramener le malin une seconde fois par ses conseillers.
Le jour des funérailles de sa femme, le hogon égorgea une vache et couvrit Djonjoro de sa peau. Il ordonna ensuite à deux de ses conseillers d’aller le jeter dans la rivière qui se situait non loin du village. En cours de route, les deux conseillers rencontrèrent une antilope avec une patte blessée. Ils déposèrent leur fardeau et la poursuivirent. Quelques instants plus tard arriva un berger peul avec son troupeau. Il entendit parler sous la peau de la vache :
— Quoi ? Le paradis ? Non, non et non, je n’aime pas le paradis !
Le Peul intrigué souleva la peau de vache et découvrit Djonjoro. Il lui demanda, pensant avoir mal compris ses propos :
— Que disais-tu à l’instant ?
Sans hésiter, le malin déclara :
— Je vis habituellement au paradis et l’on m’a demandé de rentrer. Moi, je préfère rester ici !
Le Peul, tout tremblant, s’écria :
— Je prie tout le temps pour gagner un jour ce paradis, alors prends mes animaux et mets-moi dans la peau !
En hâte, Djonjoro couvrit sa victime et prit la fuite avec le troupeau. Quelques instants après revinrent les deux conseillers du hogon, furieux de n’avoir pas pu attraper l’antilope. Ils ramassèrent leur fardeau et le jetèrent dans la rivière.
Trois années plus tard, Djonjoro décida de rendre visite à Atimé. Il prit deux calebasses : l’une remplie de lait et l’autre de miel. En se présentant devant lui, il déclara :
— J’arrive du paradis. Voyez ces deux calebasses : ce lait représente l’urine, et ce miel, le sel de ceux qui vivent au paradis.
Afin de gagner à son tour le paradis, le hogon ordonna que l’on égorge une vache. Il s’en fit couvrir et fut jeté dans la rivière.
C’est ainsi que Djonjoro devint hogon à Pèguè. Le jour de son investiture, il déclara à toute la population présente :
— Le hogon est intelligent mais pas malin. Ce n’est pas ainsi que se mérite le paradis !
______________
[1] Il reste aujourd’hui, dans les régions de plaine, quelques rares chevaux avec lesquels les Dogon se déplacent.
[2] Autrefois, tout étranger arrivant dans un village était préalablement conduit chez le hogon, même s’il avait de la famille en ces lieux. Aujourd’hui, la coutume veut que l’étranger se présente chez le chef du village.
[3] tógu nɑ̀. Litt. “grand abri”, appelé aussi abri du conseil . Il est constitué de piliers en bois ou en pierre soutenant des bottes de tiges de mil en couches superposées. Les sages s’y réunissent pour débattre des problèmes communautaires ou simplement pour se reposer aux heures chaudes de la journée. Sa hauteur sous plafond ne permet pas de s’y tenir debout ; l’on dit que c’est pour éviter que les esprits ne s’échauffent. En effet, si l’on voulait se redresser de manière intempestive dans le feu de la discussion, les poutres opéreraient un rapide et douloureux rappel à l’ordre !
[4] L’accès au tógu nɑ̀ est normalement interdit aux femmes, sauf quand il s’agit d’un problème où elles sont directement impliquées.
[5] Selon le principe symbolique liant le chiffre quatre à la femme.
[6] Village de résidence du Grand hogon, chef spirituel possédant un pouvoir supérieur à tous les autres hogons. Il est désigné par une assemblée de notables formée de délégués de toutes les fractions de la tribu. ɑ́ru est l’ancêtre fondateur qui a donné son nom à la plus importante des quatre tribus dogon.
[7] Amma Na : Dieu (ici fétiche) Mère, c’est-à-dire le fétiche mère.
Le point fort de Yalè, par Douyon Wassérou. Iréli
Il y a très longtemps, un homme du nom de Lèdou vivait avec sa femme Yalè. Vingt années après leur mariage, Lèdou devint chef de village. Bien qu’il fût autoritaire envers sa femme, celle-ci lui était très attachée. Elle cherchait toutefois le moyen d’être au moins son égal ou mieux, d'exercer à son tour quelque pouvoir sur lui.
Un soir, comme à l’accoutumée, le couple alla se coucher dans le lit conjugal. Quelques instants plus tard, Lèdou toucha les fesses de Yalè qui se leva subrepticement en disant :
— Je suis la femme du chef du village, une femme de rang supérieur. Je veux dormir sur un lit où le coton sera remplacé par les têtes de tous les oiseaux du monde ! Désormais, tant que tu ne me les auras pas apportées, je ne coucherai pas avec toi.
— D’accord, répondit Lèdou, mais offre-moi au moins cette nuit !
— Il n’en est pas question !
Ainsi Lèdou fut-il contraint d’accepter le marché imposé par sa femme. Il passa une nuit difficile.
Le lendemain, de très bonne heure, comme il est interdit à un chef de village de coucher ou de se marier avec une autre femme, il appela Véré-Véré, le plus rapide de tous les oiseaux. Il lui dit :
— Va à travers le monde et informe tous les oiseaux qu’ils sont convoqués chez moi pour une importante réunion.
— D’accord, répondit Véré-Véré, je le ferai grâce à Dieu et à vous.
En moins d’une semaine, l’envoyé termina sa mission et vint trouver Lèdou qui n’avait pas touché sa femme depuis lors.
Le jour du rendez-vous, tous les oiseaux étaient là, excepté le doyen : le mange-mil. Parmi eux, se trouvait un grand oiseau. Le chef de village l’interpella et lui demanda :
— Pouvons-nous commencer la réunion ?
— Chef, je suis certes le plus grand des oiseaux, mais je ne peux rien dire en l’absence de notre doyen le mange-mil.
Ainsi, le chef dut-il repousser l’heure de la réunion. Il envoya sur le champ Véré-Véré convoquer le mange-mil qui n’arriva qu’après le déjeuner. Comme on ne pouvait ouvrir la séance sans avoir au préalable jugé son retard, le chef du village lui demanda :
— Que faisais-tu ? N’as-tu pas reçu ma convocation ?
— J’ai bien reçu votre convocation, répondit le mange-mil.
— Alors comment peux-tu justifier ton retard ?
— J’étais en train de compter le nombre d’hommes et de femmes dans le monde. Au final, je constate que les femmes sont plus nombreuses que les hommes.
Frappés par cette révélation, le chef du village, sa femme et tous les oiseaux se levèrent et se tournèrent vers le mange-mil. Lèdou compta les hommes et les femmes présents devant lui. Comme les hommes étaient les plus nombreux, il demanda au mange-mil de s’expliquer davantage avant d’être mis à mort. Sans crainte, il dit :
— Chef, vous dites que les hommes sont les plus nombreux. Certes. Mais il y a ici beaucoup d’hommes qui ont les mêmes pensées et les mêmes réactions que les femmes, alors tous ceux-ci je les considère comme des femmes.
Alors Lèdou dit :
— Je vous ai convoqué à cause de ma femme. Elle m’a dit qu’elle ne coucherait plus avec moi tant que je ne lui aurai pas fait un lit avec les têtes de tous les oiseaux du monde ; alors comment me qualifieriez-vous ?
Le mange-mil, tout en déféquant, tempêta :
— Vous n’êtes qu’une femme ! Désormais nous ne vous reconnaissons plus comme chef !
Et tous les oiseaux regagnèrent leur maison.
Le chef du village se dit alors : « C’est parce que je dépends d’elle sexuellement que je ne suis plus chef. Alors, en effet, ma femme est forte que moi. »
L’éléphant, l’autruche et le lièvre, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Un jour, le lièvre, malin mais peu courageux, décida d’entreprendre la culture d’un champ de mil. À l’approche de l’hivernage, il partit chez l’éléphant et lui proposa de cultiver un champ commun. Celui-ci accepta. Il fit de même avec l’autruche qui n’y vit pas plus d’inconvénient. Ainsi, ils cultivèrent ensemble le champ de mil. Toutefois, l’éléphant et l’autruche ignoraient l’un et l’autre que le lièvre s’était entendu avec l’autre partie.
Un matin, ce dernier se rendit chez l’éléphant et lui dit :
— Va couper les buissons et les épines ; demain, je les ramasserai, les mettrai en tas et les brûlerai.
Ainsi l’éléphant alla arracher les buissons et les épines. Après cela, le lièvre se rendit chez l’autruche :
— J’ai terminé de couper les buissons et les épines. Va les mettre en tas et brûle-les dès ils seront secs.
Pour le labour, l’ensemencement et la moisson, le lièvre procéda de la même manière.
Un soir, après que le travail fut achevé, il demanda à l’autruche de se rendre au champ dès le lendemain matin. Ce jour-là, il s’y rendit avant elle et fit semblant de travailler. Quand elle arriva, il lui dit :
— Viens vite te cacher, je vais t’attacher à cet arbre car un chasseur m’a demandé où tu passes la journée.
Ainsi fut fait.
L’éléphant, qui se trouvait assez loin de là, distingua une forme imprécise et bizarre. Effrayé, il appela le lièvre et lui demanda, anxieux :
— Quelle est cette chose étrange à côté de notre champ de mil ?
— C’est la gibecière d’un redoutable chasseur qui me demande où tu passes la journée.
À ces mots, l’éléphant déguerpit, laissant le mil au lièvre. Après cela, ce dernier revint à côté de l’autruche qui s’empressa de demander :
— Qui est venu ?
— C’est le chasseur dont je t’ai parlé.
— Détache-moi, détache-moi vite ! s’écria l’autruche affolée.
Le lièvre, qui ne demandait rien d’autre, ne se fit pas prier deux fois. Ainsi, récupéra-t-il toute la récolte de mil sans avoir jamais travaillé.
Pourquoi la kola est le symbole du mariage ?, par Togo Amono, Togo Diguéron, Togo Honoré, Togo Niongolé. Koporo-Pen
Il était une fois, dans un lointain royaume, un roi très puissant qui avait une très belle fille. À sa naissance, il avait placé entre les trois branches d’un arbre, devant le palais royal, un canari en or et promis de donner sa fille en mariage à qui le ferait descendre. Comme la princesse, l’arbre grandissait. Quand la jeune beauté eut l’âge de se marier, l’arbre mesurait une cinquantaine de mètres et son tronc était épineux. Le roi renouvela sa promesse. Cinq années durant, beaucoup de jeunes gens essayèrent de faire descendre le canari d’or, mais aucun n’y parvint. Le tronc de l’arbre était devenu comme un fétiche. Chaque semaine on lui offrait du sang.
Très loin de ce royaume vivait un homme lui aussi décidé à tenter sa chance. Tout le village se moqua de lui :
— Même les bien-portants n’ont pas réussi ! Comment toi, un malade, peux-tu prétendre y parvenir ?
Il partit un matin de très bonne heure. En chemin, il rencontra une vieille femme en train de cultiver son champ. Il la salua et l’aida toute la journée. Le soir venu, la vieille lui demanda d’où il venait et où il allait. Il lui raconta son histoire. La femme le soigna tout d’abord puis le transforma en lépreux. Elle sortit ensuite une noix de kola et la divisa en deux. Elle lui en donna une moitié comme talisman ainsi qu’une pierre magique. Après cela, le jeune garçon s’en alla passer la nuit au village royal. Au petit matin, il invita tous les villageois à assister à l’ascension de l’arbre.
Le roi donna lui-même le coup d’envoi. Le lépreux escalada le tronc en lui donnant des coups de pieds et de mains, s’assit sur une branche et se saisit du canari. Les hôtes du roi applaudirent et acclamèrent le lépreux. Il redescendit, le canari d’or dans sa main droite, donnant de nouveau des coups de pieds et de main contre le tronc rougi par le sang des malheureux candidats qui l’avaient précédé. Il alla déposer le trésor aux pieds du roi qui lui donna sa fille en mariage ainsi que la moitié de sa fortune.
Le lendemain, l’homme partit avec la fille, ses servantes et les présents offerts par le souverain. En chemin, il s’arrêta chez la vieille femme qu’il avait rencontrée la veille pour la remercier. Avant d’entrer chez elle, il donna la moitié de sa kola à son épouse. Après avoir pénétré dans la maison de sa bienfaitrice, cette dernière le transforma en personne bien portante et lui remit l’autre moitié de la kola. Quand le jeune homme ressortit, sa femme refusa de partir avec lui car elle ne le reconnaissait pas. Alors le jeune homme sortit la moitié de la kola qui était dans de sa poche et demanda l’autre à sa femme qui la lui rendit. Il rassembla les deux moitiés, reconstituant ainsi la kola originale. Sa femme accepta alors de partir avec lui.
Depuis ce jour, la noix de kola est le symbole du mariage.