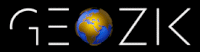- GeoZik
- DOCUS
- KITS
- La musique dans tous ses états
- La voix dans tous ses états
- La danse dans tous ses états
- Le théâtre dans tous ses états
- La littérature orale dans tous ses états
- Archéomusicologie
- Archéochorégraphie
- Instruments du monde
- Matériaux
- Facture instrumentale
- Orchestres
- Communication
- Géographie
- Religion
- Enfance
- Musicothérapie
- Patrimoine UNESCO
- Techniques et modes de vie
- CONF-EXPO
- BLOG
- CONTACT

Les outils sonores de la culture de Đông Sơn
La culture de Đông Sơn, dont l'apogée se situe entre 500 AEC et 300 EC dans les régions qui composent aujourd'hui le nord du Viêt Nam, est célèbre pour ses remarquables contributions à l'art, à la métallurgie et aux pratiques musicales. Parmi ses trésors, les tambours de bronze occupent une place centrale, à la fois en tant qu'outils sonores et objets rituels. L'étude des outils sonores de Đông Sơn permet de comprendre comment musique et société étaient intimement liées, révélant des aspects essentiels de leur quotidien, de leurs croyances et de leurs cérémonies. Mais en approfondissant les recherches, on découvre que les Đôngsơniens n’étaient pas isolés et que d’autres cultures possédaient des outils sonores similaires.
Textes, photos, vidéos © Patrick Kersalé 1998-2025, sauf mention spéciale. Dernière mise à jour : 17 janvier 2025.
SOMMAIRE
. Louche đôngsơnienne décorée d'un joueur d'orgue à bouche
. Statuette exogène joueur d'orgue à bouche
. Fac-similés exogènes de sommiers en bronze
. Iconographie des tambours de bronze
. L'orgue à bouche de type I à travers l'ethnographie
Le jeu des tambours de bronze…
. À travers le tambour Moulié du Musée Guimet (Paris)
. À travers le tambour Sao Vàng du Musée d'histoire du Viêt Nam
. Objets issus des fouilles archéologiques
. Iconographie
Pour aller plus loin
> Site web Bronze drums
> Chaîne YT : Traditional Arts and Ethnology Centre (Laos)
Introduction
La terminologie "outils sonores" est préférée à "instruments de musique" pour aborder plus largement le sujet des objets produisant du son à l'époque de Đông Sơn (actuel Viêt Nam), et pour pallier notre méconnaissance des langues parlées à cette époque. Il est à noter que de nombreuses cultures dans le monde n'ont pas d'équivalent direct pour le terme "musique". Voir à ce propos notre KIT sur la communication.
GeoZik a mené des recherches dans le nord du Viêt Nam et le sud du Laos de 1993 à 2006, afin de documenter l'utilisation actuelle des tambours de bronze par les minorités ethniques, en particulier les Lô Lô. Malheureusement, ces efforts n'ont pas abouti aux résultats escomptés. Les tambours de bronze, qu'ils soient de l'époque de Đông Sơn ou d'origine birmane, ont une valeur marchande et patrimoniale significative dans ces pays. En conséquence, les propriétaires villageois sont généralement réticents à révéler leur possession, craignant la confiscation par les autorités ou la vente à bas prix à des marchands.
Notre étude s'est également étendue aux collections de musées au Viêt Nam, dans le Yunnan (Chine) et à Paris (Guimet, Cernuschi, Quai Branly), ainsi qu'à des collections privées. La rencontre avec Jacques de Guerny, économiste et fin connaisseur des tambours de bronze, a marqué un tournant dans nos recherches. Pour en apprendre davantage sur son travail, nous vous recommandons de visionner le film “L'odyssée des tambours de bronze” réalisé par GeoZik, de consulter le site internet en anglais "Bronze Drums" rédigé par Jacques de Guerny, ou d'écouter sa conférence “Les tambours d'Asie du Sud-Est” présentée à l'Institut Français de Hanoï le 7 novembre 2018.

Lieu & date : Hanoï. 7 novembre 2018. Durée : 1:05:59. © Jacques de Guerny, Patrick Kersalé 2018-2024.
Les outils sonores
Les outils sonores en général et les instruments de musique en particulier de l'époque de Đông Sơn nous sont connus par des découvertes archéologiques, notamment des bronzes et des fragments d'instruments retrouvés lors de découvertes fortuites ou de fouilles archéologiques, ainsi que par l'iconographie des tambours de bronze et de certains objets utilitaires. Ces objets sont disséminés dans divers musées, principalement au Viêt Nam, comme au Musée national d'Histoire du Viêt Nam à Hanoi et dans des musées provinciaux, notamment celui de la province de Thanh Hóa, ainsi que dans des musées d'autres pays. Dans ce KIT, nous n'avons pas la prétention de faire le tour de la question, mais plutôt de présenter une synthèse de nos découvertes de terrain. Nous tenterons également, sans prétention, de corriger un certain nombre d'erreurs et de contre-sens distillés par certains auteurs qui nous ont précédés.
Les objets sonores et les instruments musicaux de la culture đôngsơniens appartiennent à deux familles organologiques selon le système Hornbostel-Sachs : les aérophones et les idiophones. L'unique aérophone attesté est l'orgue à bouche. Les idiophones en bronze sont plus nombreux et comprennent des tambours de bronze, des cloches à battant interne et externe, des sonnailles corporelles (comme des bracelets de chevilles et des boucles de ceinture) ainsi que des grelots. Il est probable que ces populations aient également utilisé des bambous pour produire du son, car l'iconographie des tambours de bronze semble montrer des "bâtons" ; par ailleurs, l'ethnologie contemporaine fournit de nombreux exemples d'interactions entre le bronze et le bambou.
Pour enrichir les informations directement issues de la culture de Đông Sơn, nous avons décidé d'élargir notre champ de références en tenant compte d'autres éléments provenant d'une zone culturelle plus vaste. En effet, il est difficile d'imaginer que les Đôngsơniens aient été culturellement isolés ; la culture se partage par divers moyens tels que les échanges commerciaux, les mariages interculturels et les conflits.
L'orgue à bouche
L'orgue à bouche est considéré comme le premier aérophone polyphonique créé dans le monde. Son origine, probablement chinoise, remonte à plus de 3 000 ans. Il est souvent vu comme l'un des ancêtres des instruments à anche libre modernes, tels que l'harmonica ou l'accordéon. Son influence s'est étendue au-delà de la Chine, avec des variations dans d'autres cultures du Sud-Est asiatique et au Japon. Au fil du temps, l'orgue à bouche a enrichi les traditions musicales locales et contribué à l'évolution des instruments à vent dans le monde.
Dans la culture de Ðông Sơn, l'existence de l'orgue à bouche est attestée par des représentations sur quelques rares tambours de bronze et sur un ustensile de cuisine. Sa présence est également confirmée dans la culture du Royaume de Dian (滇国 diān guó, actuel Yunnan en Chine) à la même époque, et possiblement dans la culture pré-Funan. Cet instrument a perduré jusqu'à nos jours, peut-être même dans sa typologie đôngsơnienne.
Les chercheurs vietnamiens ont identifié deux types d'orgues à bouche dans l'iconographie des tambours de bronze : les types III et IV1. Cependant, le type III, spécifique aux Hmong, pourrait être écarté car il n'utilise pas de calebasse dans sa fabrication. L'orgue à bouche figuré sur l'image du joueur du tombeau de Việt Khê (Hải Phòng) et la découverte de fac-similés en bronze des sommiers2 suggèrent plutôt un instrument de type I, caractérisé par un sommier en calebasse, des tuyaux parallèles et un embouchoir à angle variable. En comparaison, l'angle formé par l'embouchoir et les tuyaux de l'orgue à bouche qeej des Hmong est toujours de 90°, ce qui n'est pas reflété par l'iconographie connue.
_____________
1. Voir notre KIT L'orgue à bouche.
2. Chambre de distribution de l'air intercalée entre l'embouchoir (ou porte-vent) et les tuyaux sonores. Ce terme provient de l'univers de l'orgue liturgique.
Louche đôngsơnienne décorée d'un joueur d'orgue à bouche
Le Musée national d'Histoire du Viêt Nam à Hanoi possède une louche en bronze décorée d'un homme assis jouant de l’orgue à bouche. Une légère excroissance au sommet des tuyaux pourrait laisser penser qu'une calebasse y était positionnée à l'instar des orgues à bouche contemporains de type I.
Statuette exogène joueur d'orgue à bouche
La statuette de bronze ci-dessous a été découverte en vente sur le site web d'une galerie d'art. Bien que son authenticité ne puisse être confirmée avec certitude, deux facteurs ont motivé la décision de la présenter et de la décrire : le caractère unique de l'œuvre, la réputation de la galerie Hioco et l'expertise réalisée aux rayons X. La description qui suit s'inspire en partie des informations fournies par la galerie elle-même.
Il s’agit d’un homme assis sur une sorte de chaise dont les pieds sont faits ou enveloppés de corde et dont l’assise est entre deux poteaux. L’anneau au-dessus de sa tête permettait de suspendre l’objet, soit pour servir de poids à une balance, soit simplement de pendentif. Ses cheveux sont formés de longues tresses enroulées comme des coquilles d’escargot. Il est intéressant de noter que, malgré la corrosion naturelle accumulée au fil des ans, ces tresses sont encore bien visibles.
L’homme est nu, à l’exception d’un pagne, et son corps est décoré de spirales caractéristiques des techniques de cette époque. Ses épaules, son torse et ses jambes sont décorés. Il joue d'un orgue à bouche de type I.
La très belle empreinte de l’assise tressée de la chaise nous amène à conclure que ce bronze a été coulé selon la technique de la cire perdue. De légères craquelures sur les bras et les jambes indiquent la présence de fer dans l’alliage. L’analyse aux rayons X a confirmé son excellent état de conservation, la texture et la densité étant uniformes, sans trace de cassure ou de restauration. La forme de la tête du musicien ne ressemble pas à celle des figures humaines de Ðông Sơn. De même, sa coiffure et sa carrure robuste s'apparentent davantage à celles de l’Indochine centrale ou méridionale, régions étroitement liées aux cultures Ðông Sơn et Ban Chiang.
Il pourrait s’agir d’une culture pré-Funan datant du Ier ou du IIe siècle. Les fouilles dans le cimetière de Lang Vac au Viêt Nam et à Ban Chiang en Thaïlande, ainsi que les récentes fouilles de Charles Higham le long de la rivière Mun dans le nord de la Thaïlande, ont mis au jour de nombreux objets décorés de spirales. Cela suggère un contexte plus large pour cette culture à laquelle ces figures humaines pourraient appartenir. Quoi qu'il en soit, Il est intéressant de remarquer que l'orgue à bouche existe par-delà la culture de Ðông Sơn à cette époque.
Fac-similés exogènes de sommiers en bronze
En 1972, une découverte archéologique importante a été faite dans la tombe n°24 du site funéraire de Lijiashan, situé dans le comté de Jiangchuan (Chine). Il s'agit du fac-similé en bronze d'un sommier d'orgue à bouche, décoré d'un taureau. Cet objet, mesurant 28,2 cm de long, est souvent décrit comme une "calebasse de bronze" et était conçu pour accueillir cinq tuyaux de bambou. La partie antérieure de l'objet comporte un orifice destiné à l'insertion d'un porte-vent, probablement fabriqué en bambou. Pour assurer l'étanchéité des différentes parties assemblées, de la cire d'abeille ou de la résine devait être utilisée.
Iconographie des tambours de bronze
De nombreux tambours de bronze de l'époque de Ðông Sơn ont été exhumés suite à des découvertes fortuites ou des fouilles archéologiques. Cependant, peu d'entre eux comportent une “iconographie” musicale. Seuls des instruments prestigieux, reconnaissables à leur technique de fabrication et à leur qualité d'exécution en sont dotés.
Les images des orgues à bouche représentées sur les tambours de bronze confirment ce qui a été décrit ci-avant. Le sommier dans lequel sont figés les tuyaux de bambou ont toujours la forme massive d'une calebasse piriforme. Parfois, les tuyaux traversent le sommier de part en part, parfois non, comme c'est la cas pour les deux statuettes de bronze décrites précédemment. Cette caractéristique de traversement est valide sur certains orgues à bouche de type I, notamment le ploy des Khmers.
L'orgue à bouche de type I à travers l'ethnographie
L'ethnographie offre une perspective réaliste sur l'apparence probable de l'orgue à bouche dans la culture de Ðông Sơn.
Chez les Xa Pho du Viêt Nam
L'image de la femme Xa Pho du nord du Viêt Nam est proche de celle des deux joueurs décrits ci-avant : tuyaux peu nombreux et parallèles, sommier en
calebasse, porte-vent.
Lorsque nous l'avons rencontrée en 1999, son instrument n'était plus usité et il semble qu'elle avait été la dernière joueuse de cette petite ethnie.
Chez les Kui Luang du Laos

Musiciens connus : Phofan, Phodo et Phokon.
Lieu & date : Laos, prov. Luang Namtha, dist. Meuang Long. Janvier 2018. Durée : 01:56. © Marie-Pierre Lissoir 2018-2024. Courtoisie Traditional Arts and Ethnology Centre (TAEC) Luang Prabang.

À l'instar des musiciens représentés sur les tambours de bronze, ceux de l'ethnie Kui Luang du nord du Laos jouent de l'orgue à bouche naw
en mouvement, en l'occurence en tournant autour d'un pilier. L'instrument comporte cinq tuyaux, non traversant, et un conduit tubulaire en bambou ou en matériau de synthèse fiché dans le
sommier.
La vidéo montre que l'angle formé par l'embouchoir et les tuyaux varie de 90 à ± 120°.
Chez les Oy du Laos
Les Oy du sud du Laos possèdent un orgue à bouche appelé duar. Cet instrument est joué par deux musiciens, chacun utilisant un duar de dimension distincte. Chacun possède six tuyaux disposés de manière asymétrique : deux tuyaux du côté du musicien et quatre à l'opposé.
Le plus grand des deux duar mesure plus de deux mètres. Il comporte une particularité : une seconde calebasse est fixée à environ 30 centimètres de son extrémité supérieure. Cette calebasse supplémentaire semble avoir une fonction plus symbolique que pratique dans la production sonore.
Le jeu des tambours de bronze
Ce KIT n'a pas vocation à décrire en détail les tambours de bronze, Jacques de Guerny en ayant fourni une description suffisante sur le site bronzedrums. L'accent sera plutôt mis sur l'exploration des diverses représentations de jeu musical figurant sur le tympan de certains tambours de bronze remarquables.
Pour ce qui est du jeu des tambours de bronze à l'époque contemporaine (du XXe siècle à nos jours), il existe une riche documentation comprenant des photographies et des descriptions détaillées. Il est toutefois important de noter que les pratiques de jeu et de mise en scène des tambours par les Đôngsơniens différaient significativement des méthodes contemporaines.
À travers le tambour Moulié du Musée Guimet (Paris)
Le tambour de bronze du Musée Guimet, connu sous le nom de "tambour Moulié", a été découvert à Sông Đà au Viêt Nam. Son tympan présente deux groupes distincts de quatre joueurs assis, chacun jouant un instrument. La particularité de ces deux scènes réside dans une différence notable :
- Dans la première scène, les instruments semblent reposer sur un support avec un vide au-dessous.
- Dans la seconde, on observe ce qui pourrait être interprété comme un dispositif d'échappement de l'onde de choc sous chaque instrument.
Cette différence est mise en évidence par les versions colorisées des scènes, qui permettent de mieux distinguer les détails. Cependant, l'explication de cette différence reste incertaine à ce stade.
À travers le tambour Sao Vàng du Musée d'histoire du Viêt Nam
Le plus grand tambour de bronze exposé au Musée national d'histoire du Viêt Nam à Hanoï est nommé Sao Vàng. Daté du IIe au Ier siècle EC, il a été découvert dans le chef-lieu éponyme (Sao Vàng), district de Thọ Xuân, province de Thanh Hóa. D'une hauteur de 86 cm et d'un diamètre de 116 cm, il est l'un des plus grands tambours de bronze de la culture de Đông Sơn.
Au plan musical, l'iconographie de son tympan nous donne une indication sur la manière dont étaient joués les tambours de bronze. L'iconographie présente deux scènes distinctes, symétrisées par rapport au centre, chacune montrant un groupe de quatre tambourinaires.
Dans la scène supérieure de notre iconographie colorisée, on observe un musicien debout tandis que les trois autres sont assis. Dans la scène inférieure, les quatre musiciens sont en position assise. Ces représentations suggèrent que les tambours pouvaient être joués dans différentes postures.
Les tambourinaires utilisent de longs bâtons pour frapper les tambours, ce qui indique probablement une technique de jeu particulière permettant d'obtenir certains effets sonores ou une puissance de frappe spécifique. Un détail intéressant, similaire à ce qui a été observé sur le tambour Moulié du Musée Guimet, est la disposition apparente des tambours. Ils semblent être placés de manière à permettre à l'onde de choc de s'échapper, ce qui avait inéluctablement une influence sur la puissance acoustique.
Sachant que les instruments ont de robustes poignées, nous pensons qu'ils étaient suspendus verticalement afin que l'ensemble de la structure puisse vibrer.
Sonnailles corporelles
Des sonnailles corporelles — bracelets (?), chevillères et boucles de ceinture — ont été retrouvées. Ces outils sonores étaient probablement portés dans des danseurs qui participaient ainsi à nourrir l'outrance sonore. Aucune représentation de ces objets n'apparaît à travers l'iconographie des tambours de bronze.
Cloches et clochettes
Des cloches et des clochettes à battant interne ou externe ont été excavées. Les cloches de grande taille devaient être utilisées dans des cadres rituels, les clochettes plutôt destinées aux animaux domestiques.
Objets issus des fouilles archéologiques
Iconographie
Le tympan du tambour de bronze Sao Vàng, exposé au Musée d'histoire du Viêt Nam à Hanoi, représente un musicien en train de frapper une cloche. Sur l'image ci-contre, le personnage en bleu ferme la procession des danseurs, suivant le joueur d'orgue à bouche. Il est important de noter que les musiciens suivent les danseurs et non l'inverse. Sur la scène diamétralement opposée, le personnage suivant le joueur d'orgue à bouche porte un objet indéfinissable.
Bambous pilonnants
Sur le tympan du tambour Sao Vàng, ce qui a été interprété par certains chercheurs comme une scène de pilage de riz pourrait être réinterprété comme le jeu de bambous pilonnants, une pratique courante en Asie du Sud-Est et dans la région Pacifique. Cette hypothèse se renforce par le fait que l'objet percuté ne ressemble pas à un mortier traditionnel. Une pratique similaire de percussion, existant encore voici quelques décennies chez les Mường du nord du Viêt Nam, consiste à frapper à plusieurs les parois d'une auge en bois. L'iconographie soulève par ailleurs une question sur les décorations au sommet des pilons. Ces ornements pourraient être des tressages de bambou ou de palmier, associant ainsi à une dimension sonore une esthétique visuelle marquée.
Chez les Lawae du Laos

Lieu et date : Laos, prov. Attapeu, vill. Ban Kan. 3 janvier 2006.
Durée : 02:50. © Patrick Kersalé 2006-2024.
Une vidéo tournée au Laos montre et fait entendre à la fois des gongs et des bambous pilonnants. Les musiciens percutent un tabouret en bois.
Chez les Khamu du Laos

Lieu & date : Laos. Prov. d’Oudom Xai. Commune de Ban Na. Janvier 2006.
Durée : 03:51. © Patrick Kersalé 2006-2024.
Cette vidéo, tournée chez les Khamu du Laos, est un parfait exemple de la combinaison du bronze (gongs et cymbales) et du bambou (bambous percutés et pilonnants). À partir de 01:34, femmes et hommes se font face et chantent en pilonnant le sol avec de gros bambous.
La musique des Contemporains
La question de la musique produite par les instruments de la culture de Đông Sơn est complexe. Les instruments de musique et outils sonores constituent un patrimoine matériel conçu pour produire un patrimoine culturel immatériel. Bien que certains objets aient résisté au temps, la musique elle-même s'est perdue. Si le son de base de ces instruments peut encore être entendu, la manière précise dont ils étaient utilisés, notamment pour percuter les tambours de bronze, reste inconnue.
Cependant, en tenant compte du vaste bassin culturel couvrant le sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est continentale (et même insulaire, avec des tambours de bronze encore joués en Indonésie), des éléments tangibles pourraient être retrouvés. Plus une zone culturelle est vaste, plus les patrimoines matériels et immatériels tendent à se consolider et à perdurer, un phénomène que l'on peut observer dans une infinité d'exemples à travers le monde.
Dans l’Asie du Sud-Est continentale et insulaire actuelle, la musique du bronze et celle du bambou des Contemporains* coexistent de manière indépendante tout en étant souvent combinées. Les instruments en bronze et en bambou sont régulièrement joués de concert, témoignant de la continuité et de l’évolution des pratiques musicales régionales. Voici quelques exemples illustrant ces associations avec leurs liens spécifiques :
- khong pe plei des Lawae du Laos : gongs et bambous percutés.
- Nghe du Laos : deux gongs et orgue à bouche.
- Gongs plats chiang des Talieng (Laos) : deux gongs et bambous percuté.
Toutes ces musiques étaient autrefois (et encore aujourd’hui sous certaines réminiscences contemporaines) intégrées aux cérémonies animistes, telles que les funérailles, les inaugurations de maisons ou les offrandes aux esprits. Elles partagent, au-delà de l'association entre le bronze et le bambou, une nature cyclique : leurs séquences musicales, sans début ni fin, reposent sur la répétition incessante d’une courte mélodie, en écho aux cycles biologiques et cosmiques. Le moment précis de leur commencement ou de leur arrêt est déterminé par les hommes ou les nécessités cérémonielles.
Les populations đôngsơniennes, comme celles qui jouent aujourd’hui encore des gongs de bronze et des instruments de bambou, étaient principalement des riziculteurs. Leur mode de vie était rythmé par les cycles saisonniers indispensables à l’agriculture. Elles partageaient une spiritualité animiste, exprimée à travers des offrandes et des sacrifices aux entités spirituelles, garantes de l’équilibre naturel. L’iconographie des tambours de bronze atteste que les Đôngsơniens, tout comme leurs héritiers culturels contemporains, pratiquaient la danse et recherchaient une intensité sonore marquée, mobilisant tambours de bronze, cloches, sonnailles corporelles, orgues à bouche et peut-être des bambous pilonnants ou entrechoqués.
Ces communautés partageaient également la nécessité de se défendre pour protéger leurs terres, leurs villages et leurs récoltes. Les tambours de bronze des Đôngsơniens, tout comme les gongs de leurs descendants culturels, servaient à intimider les ennemis, galvaniser les guerriers et probablement aussi communiquer sur de longues distances. Des récits légendaires témoignent de ces pratiques.
La question de la preuve mérite réflexion. Une première évidence réside dans la territorialité culturelle : l’Asie du Sud-Est est l’un des rares espaces où la musique cyclique s’est développée à une telle échelle. Les populations contemporaines, attachées à la culture du bronze, ont conservé cet héritage. Bien qu’elles maîtrisent le fer pour leurs outils (faucilles, haches, couteaux…), leurs instruments musicaux principaux restent les gongs de bronze. Ce choix, inchangé jusqu’à récemment, reflète l’efficacité du dispositif ancestral — gongs, cycles, offrandes et sacrifices — pour maintenir l'équilibre climatique et social.
Ces populations partagent également une pratique singulière : le jeu mélodique des gongs en hoquet, où chaque musicien exécute une unique note de la mélodie collective. Ces mélodies, souvent issues de chants transmis oralement, perdurent parfois mais risquent d’être oubliées par les jeunes générations. Ce mode de jeu, basé sur une répartition des notes, reflète l’organisation collective des tâches agricoles et la culture communautaire de ces groupes. En revanche, lorsqu’un instrument mélodique (orgue à bouche, flûte de Pan, cithare idiocorde, cithare hétérocorde, xylophone de bambou…) est joué par une seule personne, la technique consiste à reproduire les parties des gongs, mêlant mélodie principale et éventuel accompagnement.
______________
* Nous appelons ici “Contemporains” les populations dénommées “Montagnards” durant la période indochinoise (Viêt Nam, Laos, Cambodge) ; ils sont des peuples autochtones des hauts plateaux d'Asie du Sud-Est. Sur le plan culturel, ils se caractérisent par une grande diversité ethnique, des pratiques agricoles communes (notamment la culture sur brûlis), des croyances animistes, des structures communautaires villageoises et la pratique du jeu des gongs sous forme de musique cyclique. Linguistiquement, ils appartiennent principalement à deux grandes familles : austroasiatique et austronésienne. Ajoutons à ces populations, celle des Mường du nord du Viêt Nam qui, eux aussi, jouent de grands ensembles de gongs de manière cyclique.
La musique des Đôngsơniens
Nous pensons (de manière hypothétique bien entendu) que les Đôngsơniens jouaient une musique cyclique à l'image de celle des Contemporains et ce, pour plusieurs raisons :
- À l'instar des Contemporains, ils étaient riziculteurs ; ils avaient donc les mêmes besoins climatologiques. On sait, d'après les légendes et l'ethnographie, que les tambours de bronze étaient en quelque sorte des régulateurs climatiques “magiques”, notamment pluviométriques. Chez les Contemporains, la régulation climatique est assurée par les ensembles de gongs. La musique est une offrande musicale aux entités spirituelles (yang) qui sont en charge de la régulation du monde ici-bas.
- La structure des décors des tympans et des fûts des tambours de bronze offre une indication d'une pensée cyclique : végétaux, oiseaux, batraciens, etc… sont représentés comme un cycle vital ininterrompu.
- Le nombre “quatre” est récurrent. Les quatre éléments semblent inclus dans l'iconographie des tambours de bronze : eau (animaux aquatiques tels que grenouilles, poissons, tortues, canards…), air (oiseaux en vol), terre (source de fabrication du tambour moulé dans la terre), feu (?) (peut-être l'étoile — qui n'est pas un soleil selon certains chercheurs — au centre du tympan), quatre poignées de portage ou suspension. La musique cyclique des Contemporains est basée sur quatre temps (selon l'acception occidentale) ou l'un de ses multiples. Le nombre de batraciens autour du tympan est de quatre, de même que les groupes de clochettes autour des sonnailles corporelles (chevillère : 4 x 3 clochettes).
L'une des questions fondamentales concerne l'accord des tambours. Sur l'iconographie des deux tambours étudiés (Moulié et Sao Vàng), n'apparaît pas une différentiation notoire de la taille à l'intérieur des groupes de quatre tambours pouvant être retenue comme indice de hauteurs tonales. Nous savons qu'une fois coulé, le tympan de bronze donne une note qui ne peut être modifiée. En explorant la surface interne des tympans des quelques tambours étudiés sur nos terrains, nous n'avons pas trouvé de trace d'enlèvement ou d'ajout de matière. Nous savons en revanche que, dans le cas des gongs, il est possible de modifier modérément la hauteur du son par martèlement de certains zones. Nous ne pensons pas que ceci fut possible pour les tambours de bronze. Deux solutions se détachent alors :
- Les tambours n'étaient pas accordés, ce qui, face à la sophistication de la société đôngsơnienne est peu probable ; à moins que les scènes représentées soient des pantomimes martiales, auquel cas, l'usage de dissonances visant à effrayer l'ennemi et galvaniser les guerriers ferait sens.
- Les tambours réellement joués étaient sélectionnés pour leur hauteur sonore et assemblés pour former un ensemble cohérent selon les critères musicaux de l'époque.
Nous pensons également, compte tenu de l'iconographie des tambours de bonze, de la nature des instruments et outils sonores qui nous sont parvenus, que la recherche d'une outrance sonore, couplée à une outrance visuelle, était une composante culturelle des Đôngsơniens. À ces instruments musicaux et outils sonores devaient se superposer des cris, des clameurs et des chants.
Les peintures de Huashan

Pour aller plus loin dans a compréhension du jeu des tambours de bronze et des rites associés, il convient de s'intéresser aux peintures de Huashan en Chine. De nombreuses études ont été menées par des chercheurs du monde entier. Le site est situé dans la région autonome Zhuang du Guangxi, voisine du Viêt Nam. Il semble avoir été créé entre la période des Royaumes combattants (403-221 avant notre ère) et la dynastie des Han de l’Est (26-220 de notre ère), par un groupe ethnique nommé Luo Yue.
Les motifs représentent principalement des hommes et des femmes (85 %), des animaux et des objets tels que des épées, des poignards, des tambours de bronze et des cloches. Les anthropomorphes sont représentés soit de face, soit de profil, tous dans la même posture : bras tendus au niveau des coudes et jambes semi-accroupies. Un motif particulièrement frappant est celui de la « danse des grenouilles », où des figures humaines adoptent des postures accroupies et écartent largement les bras. Ce geste semble mimer les mouvements de la grenouille, un animal associé à la fertilité et à l’abondance. Ces danses, souvent réalisées en cercle autour des tambours de bronze, sont interprétées comme des rites destinés à invoquer la pluie, essentielle à l’agriculture rizicole, et à garantir de facto la prospérité des communautés.
L’iconographie suggère une forte corrélation entre ces rites et le cycle de la vie. Les grenouilles, dont l’apparition coïncide avec la saison des pluies, symbolisent le renouveau et la régénération. Les tambours de bronze, par leur résonance profonde, auraient pu être perçus comme une voix amplifiée des prières humaines, destinée à atteindre les divinités ou les esprits de la nature.
En combinant musique, danse et symbolisme animal, l’art rupestre de Huashan illustre l’importance des pratiques collectives dans la régulation des forces naturelles et sociales. Ces fresques ne sont pas de simples représentations esthétiques : elles sont des archives visuelles d’une cosmologie où les tambours de bronze et la danse des grenouilles jouaient un rôle clé dans la survie et l’harmonie communautaire.