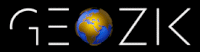- GeoZik
- DOCUS
- KITS
- La musique dans tous ses états
- La voix dans tous ses états
- La danse dans tous ses états
- Le théâtre dans tous ses états
- La littérature orale dans tous ses états
- Archéomusicologie
- Archéochorégraphie
- Instruments du monde
- Matériaux
- Facture instrumentale
- Orchestres
- Communication
- Géographie
- Religion
- Enfance
- Musicothérapie
- Patrimoine UNESCO
- Techniques et modes de vie
- CONF-EXPO
- BLOG
- CONTACT

Le sarcophage de Julia Tyrannia
Le sarcophage de Julia Tyrrania, conservé au Musée départemental Arles antique, constitue un témoignage archéologique exceptionnel de la vie musicale romaine aux IIe-IIIe siècles. Provenant de la nécropole des Alyscamps à Arles, cette œuvre en pierre de Fontvieille offre un panorama unique des instruments de musique de l'époque, à travers une composition sculptée en bas-reliefs. L'épitaphe latine révèle l'histoire de Julia Tyrrania, décédée à l'âge de 20 ans et 8 mois, et célébrée pour ses vertus et sa discipline. Le sarcophage présente, de part et d'autre de cette inscription, quatre instruments musicaux emblématiques : une flûte de Pan, un orgue hydraulique, un luth et une lyre, témoignant de la richesse culturelle et artistique de la période romaine.
Textes, photos, vidéos © Patrick Kersalé 1987-2024, sauf mention spéciale. Dernière mise à jour : 27 décembre 2024.
SOMMAIRE
Description générale
Le sarcophage dit de “Julia Tyrannia” a été fabriqué en pierre de Fontvieille. Provenant de la nécropole romaine des Alyscamps à Arles, il est daté des IIe-IIIe siècles EC. Aujourd'hui mis en sécurité au Musée départemental Arles antique, GeoZik l'avait photographié en 1987 dans l'allée de Alyscamps !
Selon le commentaire de la représentation 3D du sarcophage, la cuve fut récupérée durant la Révolution française par un salpêtrier qui l’utilisa pour son artisanat de fabrique de poudre avant de le rendre à la ville.
Ce sarcophage est, pour l'archéomusicologue, une œuvre exceptionnelle puisqu'elle montre quatre instruments de musique de l'époque romaine : une flûte de Pan (syringa), un orgue hydraulique (latin : hydraulis, français : hydraule, grec : ὕδραυλις organon hydraulikon), un luth (πανδοΰρα, pandura) et une lyre (cithara). Notons toutefois que ces instruments ne sont pas des inventions romaines. L'orgue hydraulique a été inventé par les Grecs et les trois autres instruments dérivent d'inventions plus anciennes dont l'attribution exacte serait pure spéculation.
Du point de vue du musicologue iconographe, on peut d'emblée affirmer que l'artiste qui a conçu ce sarcophage connaissait parfaitement les instruments de musique. La précision est telle qu'elle donne l'impression que les instruments sont réellement posés ou accroché devant nous.
En cliquant sur les chevrons du diaporama ci-dessous, vous pourrez découvrir tour à tour :
- le sarcophage original,
- Le sarcophage avec les quatre instruments détourés,
- Le sarcophage avec des propositions de reconstitution des instruments.
Pour voir le sarcophage en 3D, cliquez ici.
- À gauche. Un orgue hydraulique à huit tuyaux et une flûte de Pan suspendue. Au sol, un quadrupède (lion, bélier ou bouc selon les auteurs) au pied d’un arbre (un pin ?).
- À droite. Une lyre cithara posée sur un socle recouvert d’une draperie, son plectre, un luth à trois cordes. Une pancarte (?) accrochée à un clou.
- Au centre. une inscription latine :
IVLIAE LVC(i) FILIAE TYRRANIAE
VIXIT ANN(os) XX M(enses) VIII
QVAE MORIBVS PARITER ET
DISCIPLINA CETERIS FEMINIS
EXEMPLO FVIT AVTARCIVS
NVRVI LAVRENTIVS VCXORI
À Julia Tyrrania, fille de Lucius qui a vécu 20 ans et 8 mois.
Elle a été pour les autres femmes un exemple tant par sa vertu que par ses principes. Autarcius à sa bru, Laurentius à son épouse.
Structuration des deux scènes instrumentales
De chaque côté de l'épitaphe latine se trouvent deux scènes en bas-relief : à gauche, des instruments à vent (une flûte de Pan et un orgue hydraulique), et à droite, des instruments à cordes (un luth et une lyre). Cette disposition évoque la célèbre opposition musicale entre Pan et Apollon dans la mythologie grecque, rappelant le concours musical jugé par Tmolus où Apollon triomphe de Pan. Cette juxtaposition symbolise probablement l'harmonie entre différentes traditions musicales ou l'étendue des talents musicaux de Julia Tyrannia. La référence mythologique ajoute une dimension culturelle et spirituelle, tandis que la présence d'instruments variés et sophistiqués suggère un statut social élevé et une éducation musicale raffinée de la défunte. De plus, la musique, associée à Apollon, pourrait symboliser l'aspiration à l'immortalité ou à une forme de vie après la mort. Cette iconographie complexe témoigne de la richesse culturelle et des croyances de l'époque romaine, tout en honorant la mémoire et les accomplissements de Julia Tyrannia.
Apollon, dieu grec aux multiples facettes, entretient une relation complexe avec la vie après la mort. Bien qu'il ne soit pas directement un dieu de l'au-delà comme Hadès, son rôle dans la transition entre la vie et la mort est significatif. En tant que dieu de la lumière et de la vie, Apollon possède des pouvoirs de purification et de guérison, qui peuvent être interprétés comme une préparation à l'au-delà. Son omniscience, en tant que dieu oraculaire, s'étend probablement à la connaissance de l'au-delà. Paradoxalement, Apollon est aussi associé à la mort subite, ses flèches pouvant apporter une mort rapide et sans douleur, ce qui pourrait être vu comme une forme de passage clément vers l'au-delà. Le laurier, arbre sacré d'Apollon, symbolise l'immortalité avec ses feuilles persistantes, évoquant une forme de vie éternelle. Enfin, en tant que fils de Zeus, Apollon transmet la volonté divine, ce qui peut inclure des influences sur le destin des âmes après la mort. Ainsi, bien que n'étant pas directement lié à l'au-delà, Apollon joue un rôle important dans la conception grecque de la transition entre la vie et la mort, notamment à travers ses aspects purificateurs, prophétiques et son association avec une forme d'immortalité symbolique.
La flûte de Pan
Il existe, à l'époque romaine, deux types de flûtes de Pan :
- polycalame : fabriquée avec un assemblage d'un nombre variable de roseaux (canisses).
- monoxyle : fabriquée à partir d'une planchette de bois percée d'autant de trous que nécessaire.
L'instrument est typique de la période romaine quant à l'organisation des tuyaux. Si aujourd'hui nous sommes habitués à voir les tuyaux organisés selon une décroissance linéaire, il n'en était pas ainsi à cette époque. Les flûtes de Pan montraient le plus souvent, pour les instruments comportant de nombreux tuyaux, deux ou trois “blocs” accolés, chacun avec sa propre décroissance.
L'instrument représenté sur ce sarcophage présente trois “blocs” maintenus entre eux par ce qui pourrait être un éclat de roseau transversal ou une ligature complexe. À titre d'exemple nous proposons ci-dessous une proposition de reconstitution.
La scène, composée d'une flûte de Pan, d'un arbre et d'un animal (probablement un bouc), présente une particularité significative. La position de la flûte de Pan est délibérément choisie pour permettre au vent de s'engouffrer dans ses tubes, produisant ainsi des sons. Cette représentation est courante dans l'iconographie des sarcophages paléochrétiens, où une flûte de Pan suspendue à un arbre symbolise de manière sonore la présence du dieu Pan.
L'arbre, vraisemblablement un pin, fournit un autre indice de la présence du vent venant de la droite. Ses branches penchent vers la gauche, et celles exposées au vent sont dépourvues de feuilles. Cette représentation reflète l'influence du Mistral, vent caractéristique d'Arles, située au bord du Rhône. Le Mistral, soufflant environ 130 jours par an avec des vitesses de 30 à 120 km/h, façonne considérablement la végétation locale.
L'animal représenté, s'il s'agit bien d'un bouc, évoque la présence de Pan, dieu des troupeaux, renforçant ainsi le thème pastoral et divin de la scène.
Le commentaire associé à la représentation 3D du sarcophage mentionne : « Au sol, un lion ou un bélier au pied d’un pin, deux éléments associés à la déesse Cybèle et à son parèdre Attis. » Certes la queue de l'animal est longue et fait penser à celle d'un lion… Dans le culte de Cybèle, l'aérophone dominant est la tibia qui n'est pas une flûte mais un double hautbois. Cette erreur est commune dans les écrits, fussent-ils ceux des universitaires non musicologues ou ceux des vulgarisateurs…
L'orgue hydraulique
L'orgue hydraulique hydraulis s'impose comme la continuité technologique de la flûte de Pan, une flûte de Pan mécanisée en quelque sorte puisque Philon de Byzance écrivait dans la proximité temporelle de l'invention de l'hydraulis par Ctésibios d'Alexandrie au IIIe siècle AEC : « ἐπὶ τῆς σύριγγος τῆς κρουομένης ταῖς χερσίν, ἣν λέγομεν ὕδραυλιν* » / « sur le type de sýrinx qui se joue avec les mains, que nous appelons hýdraulis. »
Cet instrument de musique révolutionnaire combinait l'eau et l'air pour produire des sons. L'hydraulis mesurait environ deux mètres de haut sur un mètre de large et comportait plusieurs éléments clés :
- une soufflerie composée de deux pompes cylindriques,
- un régulateur hydraulique utilisant un entonnoir renversé immergé dans l'eau pour stabiliser la pression de l'air,
- un sommier supportant les tuyaux,
- des tuyaux généralement en bronze,
- un système de touches pour sélectionner les tuyaux à faire sonner.
Une découverte archéologique majeure a été faite en 1992 à Dion, en Macédoine, où les restes d'un hydraulis datant du Ier siècle ont été mis au jour, comportant 24 tuyaux ouverts de différentes hauteurs. L'hydraulis a été largement utilisé dans le monde gréco-romain et a posé les bases de l'orgue moderne. Bien que son mécanisme hydraulique ait été abandonné au profit de soufflets mécaniques, cet instrument constitue un témoignage remarquable de l'ingéniosité et de la créativité musicale des anciens.
__________________
* Philo Mech. Bel. 61, 77.42f. Thévenot.
Le luth
L'iconographie des luths est rare à l'époque romaine. Le sarcophage de Julia Tyrannia offre une représentation exceptionnelle d'un luth tricorde à manche court, munie d'une caisse de résonance réalisée avec une carapace de tortue terrestre. Le détourage que nous avons effectué au plus près des contours encore visibles laisse peu de doutes quant à cette assertion. Les trois cordes sont attestées à la fois par la présence de trois chevilles d'accordage et par l'existence d'autres instruments tricorde à cette même époque, connus sous la terminologie impropre de “luth copte”. Sept exemplaires de ce dernier nous sont parvenus jusqu'au temps présent. Le luth est connu sous l'appellation grecque πανδοΰρα (pandura).
Le bassin méditerranéen abrite principalement quatre espèces de tortues terrestres : la tortue d'Hermann (Testudo hermanni), présente dans le sud de la France, l'Italie, les Balkans et certaines îles méditerranéennes ; la tortue grecque (Testudo graeca), que l'on trouve en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Espagne et dans certaines parties de l'Europe du Sud ; la tortue marginée (Testudo marginata), originaire principalement de la Grèce, ainsi que de certaines zones d'Albanie et d'Italie ; et la tortue égyptienne (Testudo kleinmanni), plus rare, présente en Égypte et en Libye.
La taille maximale de la carapace de ces tortues varie :
- la tortue d'Hermann (Testudo hermanni) peut atteindre 28 cm, bien que la plupart des individus soient plus petits ;
- la tortue grecque (Testudo graeca) peut atteindre jusqu'à 35 cm, avec des variations selon les sous-espèces ;
- la tortue marginée (Testudo marginata) est la plus grande, avec une taille maximale d'environ 40 cm ;
- la tortue égyptienne (Testudo kleinmanni) est la plus petite, ne dépassant généralement pas 15 cm.
Compte tenu de la petite taille de la tortue égyptienne, ce candidat semble exclu de facto.
Le luthier Benjamin Simão de l'atelier Trinoxamoni propose une reconstitution de ce luth sur la base des proportions de l'exemplaire du sarcophage. Compte tenu de la protection actuelle des tortues du pourtour méditerranéen (Convention de Berne (1979), Convention de Washington (CITES, 1973), Directive Habitats-Faune-Flore de l'UE (1992) et certaines législations locales, le luthier a réalisé une caisse de résonance en bois, imitant une carapace de tortue. Les chevilles ont été organisées à la manière des “luths byzantins”, dits aussi “luths coptes”.
La lyre
La lyre cithara semble avoir eu un nombre limité de cordes concentrées sur un cordier étroit. Un KIT dédié à cet instrument sera bientôt disponible sur GeoZik.