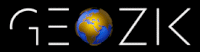- GeoZik
- DOCUS
- KITS
- La musique dans tous ses états
- La voix dans tous ses états
- La danse dans tous ses états
- Le théâtre dans tous ses états
- La littérature orale dans tous ses états
- Archéomusicologie
- Archéochorégraphie
- Instruments du monde
- Matériaux
- Facture instrumentale
- Orchestres
- Communication
- Géographie
- Religion
- Enfance
- Musicothérapie
- Patrimoine UNESCO
- Techniques et modes de vie
- CONF-EXPO
- BLOG
- CONTACT

Le sistre dans l'Égypte antique
Le sistre, instrument emblématique de l'Égypte antique, a joué un rôle crucial dans les rituels et la vie spirituelle de cette civilisation millénaire. Cet outil sonore, étroitement lié au culte des déesses Hathor et d'Isis, fascine encore aujourd'hui les archéologues, musicologues et historiens. Son histoire remonte à l'Ancien Empire et s'étend jusqu'à l'époque gréco-romaine, témoignant de sa pérennité et de son importance dans la culture égyptienne.
Textes, photos © Patrick Kersalé 2022-2025, sauf mention spéciale. Dernière mise à jour : 23 janvier 2025.
Introduction
Le sistre égyptien, objet fascinant de l'Antiquité, a suscité de nombreuses études approfondies au fil des années. Ce dossier vise à offrir une synthèse richement illustrée, s'appuyant sur une vaste iconographie rassemblée par GeoZik en octobre 2022 à travers les temples, tombes et musées égyptiens.
Notre exploration ne se limite pas à l'Égypte ancienne, mais s'étend également au monde gréco-romain et à l'Afrique subsaharienne, proposant ainsi un voyage spatio-temporel à travers l'histoire et les cultures. Cette approche comparative permet de mieux comprendre l'évolution et l'influence du sistre au-delà de ses origines égyptiennes.
Il est important de noter que nous avons délibérément choisi de ne pas aborder le thème du "sistre dans la Bible" pour le moment, en raison de la nature controversée du sujet.
Dans notre analyse, nous adoptons une perspective particulière en considérant le sistre comme un "outil sonore" plutôt qu'un simple "instrument de musique". Cette approche reflète mieux la fonction rituelle et symbolique complexe du sistre dans les sociétés anciennes, dépassant son rôle purement musical pour englober ses aspects spirituels et culturels.
Ce dossier offre ainsi une vue d'ensemble complète et nuancée du sistre, mettant en lumière son importance historique, culturelle et spirituelle à travers les âges et les civilisations.
Rôle du sistre

Le sistre, symbole emblématique de l'Égypte antique, apparaît dans les textes hiéroglyphiques et l’iconographie dès la fin de l’Ancien Empire. Étroitement associé aux cultes d’Isis et d’Hathor, il conserve son importance jusqu’à l’époque ptolémaïque. L'iconographie égyptienne le représente sous diverses formes :
- Comme une offrande précieuse destinée à Hathor et à d'autres divinités.
- En tant qu'incarnation de la déesse elle-même, souvent associé au collier-menat, symbolisant sa puissance sonore et visuelle.
Les temples et les tombes regorgent de représentations de sistre, tandis que les inscriptions hiéroglyphiques gravées dans les sanctuaires révèlent sa relation profonde avec la déesse. À l'époque ptolémaïque, le sistre transcende son rôle d'objet pour devenir un symbole polyvalent :
- Il incarne la puissance divine, notamment en matière de fertilité.
- Les pharaons le brandissent pour apaiser le caractère redoutable de la déesse.
- Il évoque l'aspect érotique d'Hathor, parfois représentée comme l'amante d'Atoum ou sa génitrice dans certaines cosmogonies.
La tradition de l'offrande du sistre par les pharaons perdure du Nouvel Empire à l'époque romaine, témoignant de sa pérennité symbolique. Cependant, la nature polysémique du sistre et l'étendue spatio-temporelle de son utilisation - de la fin de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, du sud de l'Égypte aux confins de l'Empire romain - rendent difficile une interprétation univoque de sa signification.
Typologies
L'Égypte ancienne a connu deux types de sistres : le sistre à naos et le sistre arqué ou cintré, chacun marquant une époque et un contexte spécifiques.
- Le sistre à naos, le plus ancien, apparaît dès l'Ancien Empire. Il se caractérise par sa forme rappelant la façade archétypale du temple égyptien avec ses pylônes. Il est le plus souvent fabriqué en faïence dans des tons bleus et verts, rappelant la turquoise, un matériau associé à Hathor. Il est doté d'une ouverture rectangulaire centrale (la « porte ») et de trous sur les côtés pour recevoir des tiges sur lesquelles glissent des éléments métalliques. L'élément « naos » est flanqué de volutes rappelant les cornes de vache.
- Le sistre arqué, quant à lui, émerge au Nouvel Empire et connaît un essor considérable, particulièrement sous la domination romaine. Il est majoritairement fabriqué en bronze, incluant parfois l'argent et l'or. Certains, comme celui retrouvé dans la tombe de Touthânkamon sont en bois.
Une particularité intrigante de certains sistres est l'absence fréquente de branches horizontales sur lesquels coulissaient des éléments métalliques ronds ou carrés, malgré la présence de trous latéraux, soulevant des questions sur leur état de conservation et leur utilisation originelle. Les deux types de sistres partagent le plus souvent une caractéristique commune : une tête hathorique au bout du manche. Les sistres arqués se distinguent par leurs ornementations spécifiques au sommet de l'arc, représentant des divinités comme Bastet, Bès ou Anubis sous leurs formes animales, une pratique qui contraste avec la réticence gréco-romaine à représenter les dieux égyptiens de cette manière, surtout hors d'Égypte.
Malgré leurs différences esthétiques, ces instruments produisaient vraisemblablement des effets sonores similaires, leurs variations se manifestant principalement dans leur apparence : présence ou absence de façade de temple, de tête hathorique, d'aspect papyriforme, ou dans le choix des divinités représentées et l'ornementation. Cette diversité reflète la richesse et la complexité de la symbolique religieuse égyptienne, ainsi que son évolution au fil des dynasties et des influences extérieures.
Le sistre à travers les textes anciens
Les textes hiéroglyphiques distinguent au moins deux types de sistres, chacun porteur d'une signification particulière :
- Le "sššt" (sechechet). Ce terme, dérivé du verbe "sšš", est souvent interprété comme une onomatopée évoquant le bruissement des tiges de papyrus utilisées lors des rituels dédiés à la déesse Hathor. Cependant, l'hypothèse selon laquelle cette unique interprétation pourrait s'appliquer à quatre millénaires d'histoire mérite d'être questionnée. La pérennité d'une telle signification sur une si longue période soulève des interrogations légitimes quant à l'évolution sémantique et culturelle du terme.
- Le "sḫm" (sekhem). Bien que moins fréquemment employé, ce terme semble désigner plus spécifiquement le sistre arqué dont l'apparition coïncide avec la XVIIIe dynastie. Cette évolution terminologique reflète probablement des changements dans la conception et l'utilisation de l'instrument. L. Manniche* note : « Les textes du temple de Dendara indiquent qu'à l'époque gréco-romaine ce “naos” n'était pas en fait considéré comme un naos, mais comme une porte monumentale par laquelle le ba de la déesse, encapsulé dans une statue, passait à l'occasion de la fête du Nouvel An pour se rendre sur le toit du temple afin de recevoir les premiers rayons du soleil. Cette porte ou portail signale ainsi la présence d'Hathor. De plus, les poignées des deux types de sistres sont souvent ornées du visage de la déesse. »
____________
* Manniche, L. (2010). The cultic significance of the sistrum in the Amarna period. In A. Woods, A. MacFarlane & S. Binder (Eds.), Egyptian Culture and Society: Studies in Honour of Naguib Kanawati (Vol. II). Cairo.
Le sistre à travers l'iconographie
Les représentations de sistres abondent dans l'art égyptien ancien, ornant les murs des temples et des mammisi, les parois des tombes, les sarcophages, les stèles, le mobilier et même les ostraca.
Dans les scènes d'offrandes aux divinités, quatre configurations distinctes se dégagent, reflétant probablement la complexité des rituels et la hiérarchie sociale des officiants :
- L'offrande d'un seul sistre, soit à naos, soit arqué.
- La présentation de deux sistres du même type.
- L'offrande simultanée des deux types de sistres, un dans chaque main.
- La combinaison de sistres et de colliers-menat, associant ainsi deux puissants symboles rituels.
Cette diversité dans les représentations d'offrandes souligne la richesse symbolique du sistre et suggère des nuances subtiles dans sa signification rituelle, variant peut-être selon le contexte, la divinité honorée, ou le statut de l'officiant.
Bas-reliefs des temples
Fresques des tombes
Divers
Les sistres issus des fouilles
Les fouilles archéologiques ont mis au jour un certain nombre de sistres, désormais exposés dans des musées à travers le monde. Les typologies mises au jour confirment les représentations iconographiques. Les objets excavés présentent cependant une grande variété de formes, de styles, de matériaux, reflétant leur usage symbolique et leur évolution au fil du temps.
Sistres à naos
Les sistres à naos, reconnaissables à leur cadre en forme de temple miniature, sont l’un des types les plus courants. Le naos représente souvent un sanctuaire dédié à une divinité, notamment Hathor, dont les visages sont parfois sculptés sur les objets eux-mêmes. Les barres transversales sont très souvent absentes, une tendance confirmée par l'iconographie.
Sistres arqués
Les sistres arqués, avec leur cadre en forme de U renversé, sont souvent associés à Isis et au culte isiaque, particulièrement lors de la période gréco-romaine. Ils existaient sous deux variantes principales :
- Avec barres transversales : Ces barres produisaient le cliquetis caractéristique du sistre lorsqu’il était secoué. Leur fonction rituelle restait centrée sur la création d’une ambiance propice au rituel et à la méditation.
- Sans barres transversales : Ces sistres, souvent décoratifs ou symboliques, ne pouvaient pas produire de son. Nous ignorons pourquoi ces sistres étaient “muets”. Ce fait est confirmé par l'iconographie de certaines tombes.
Nous présentons ci-après deux sistres d'exception, l'un pour sa qualité artistique, l'autre pour sa provenance prestigieuse.
Le sistre du Louvre
Ce sistre arqué du musée du Louvre, identifié sous le numéro d’inventaire E 11201, est un exemple exceptionnel de l’art religieux de l’Égypte antique. Il mesure 40 cm de hauteur, 7,5 cm de largeur et 6,1 cm d’épaisseur.
Description et Décor. Le manche du sistre est surmonté d’une tête d’Hathor ornée d’un collier ousekh, flanquée de deux uræus (serpents sacrés), chacun coiffé de la couronne blanche. Au-dessus, un serpent à tête de femme est dressé, portant des cornes enserrant un disque solaire. Ce décor renforce l’association de l’instrument à Hathor, déesse de la musique, de la joie et de la protection.
Sur l’arceau, plusieurs scènes gravées enrichissent l’objet :
- Isis et Mout : Ces deux déesses sont représentées debout, chacune tenant deux sistres arquées. Isis est coiffée de cornes entourant le disque solaire, tandis que Mout porte la couronne pschent symbolisant l'union de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte.
- Amon-Rê : Le dieu est figuré sous forme d’un bélier couché, surmonté d’un disque solaire.
- Maât : Déesse de la vérité et de l’ordre cosmique, elle est représentée accroupie.
- Nékhbet : Le vautour sacré est montré en vol, tenant dans ses serres des symboles puissants tels que le chen (infini), la croix ânkh (vie), le ouas (puissance), ainsi que deux signes neb (seigneurie).
Inscriptions et dédicaces. Le sistre porte des inscriptions hiéroglyphiques contenant une formule d’offrande. Les textes mentionnent plusieurs divinités majeures, notamment Amon-Rê, Isis, Mout, Khonsou, ainsi que les déesses protectrices Nékhbet et Ouadjet. Ils évoquent également Henouttaouy, une maîtresse de maison et chanteuse-chémayt d’Amon et d’Amon-Rê, titres qui soulignent son rôle religieux et musical au sein des rituels.
Techniques et matériaux. L’instrument combine des techniques raffinées d’incrustation et de placage, utilisant le bronze comme matériau principal et l’or pour les éléments décoratifs. Ce mélange de métaux précieux et de motifs symboliques confère à l'objet un statut sacré et une grande valeur artistique.
Le sistre de la tombe de Touthânkamon

Provenant de la tombe du pharaon Toutânkhamon, cet objet surprend par sa simplicité. Il s’agit de l’un des instruments les plus modestes qui soient. Son manche octogonal, avec une partie supérieure carrée, est en bois. Il est surmonté d’un cadre traversé par trois tiges transversales serpentiformes en bronze, sur lesquelles coulissent trois petites pièces carrées du même matériau. Malgré sa modestie apparente, l’ensemble de l’objet est recouvert de feuilles d’or, lui conférant une élégance raffinée. Ce sistre aurait appartenu à la reine Tiyi, grand-mère du jeune roi.
Le sistre dans le monde greco-romain
Les mentions tardives grecques et latines ne livrent qu’un seul terme pour désigner le mot « sistre ». En grec, le neutre seistron (σειστρόν) semble avoir été repris dans un esprit étymologique similaire en latin sous la forme de sistrum. Cependant, l’origine du terme grec demeure incertaine. La plupart des commentaires anciens, notamment ceux de Plutarque, le rattachent au verbe grec σείω (« secouer, agiter »), en référence à un objet que l’on manipule pour produire un son. Ce lien étymologique suggère que l’accent est mis sur l’action (le mouvement) qui génère le son, plutôt que sur le son lui-même, comme cela est le cas dans la langue égyptienne.
La proximité phonétique entre le mot égyptien et le terme grec, comme l’a souligné à juste titre Corinne Bonnet, pourrait également indiquer une intégration directe du terme égyptien dans la langue grecque. Toutefois, cette adoption n’exclut pas un éventuel jeu étymologique avec le verbe σείω. Par ailleurs, le terme latin crepitaculum, utilisé par Apulée dans ses Métamorphoses, est également associé au sistre, bien que cet emploi semble être une exception contextuelle. Le passage décrit l'apparition de la déesse Isis à Lucius, le protagoniste des Métamorphoses. Le sistre, instrument sacré associé au culte d'Isis, est décrit avec précision, soulignant son importance dans le rituel et la symbolique religieuse de l'époque.
Texte original en latin
"Dextra quidem ferebat aereum crepitaculum, cuius per angustam laminam in modum baltei recurvatam traiectae mediae paucae virgulae, crispante brachio trigeminos iactus, reddebant argutum sonorem."
Traduction française
"La déesse tenait dans sa main droite un sistre d'airain, dont la lame étroite et courbée en forme de baudrier était traversée de quelques baguettes qui, lorsqu'elle agitait le bras, rendaient un son aigu."
Quoi qu’il en soit, cette analyse terminologique montre que le sistre est toujours désigné soit par le son qu’il produit, soit par l’action nécessaire pour le générer.
Le sistre chez les Dogon du Mali

Les sistres dogon portent des noms différents selon la langue ou le dialecte : sisekesi, siseketi ou sɛgɛdɛm (tɛngu kɑ̃̀), segede (togo kɑ̃̀). On peut aisément faire un rapprochement sonore entre des différents noms dogon et les deux appellations connues en Égypte. Il est probable que tous ces termes soient originellement onomatopéiques. Ils nous offrent la sonorité du sistre par les “s” et ”š” et peut-être même le rythme grâce aux autres consonnes. Les quatre consonnes inclinent à penser que des sessions à deux aller-retour composaient un secouement. Malheureusement il serait hasardeux d'en dire plus. Une étude comparative des séquences rythmiques des sistres africains utilisés dans les rituels permettraient peut-être de dégager des tendances.
Nous vous invitons à consulter notre KIT consacrés au sistre accompagnant les chants de circoncis chez les Dogon.
Bibliographie
Ouvrages généraux
-
Lise Manniche – Music and Musicians in Ancient Egypt. British Museum Press, 1991.
- Un ouvrage essentiel pour comprendre le rôle de la musique dans la culture égyptienne, avec des références spécifiques aux instruments comme le sistre.
-
Kathryn Bard (dir.) – Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt. Routledge, 1999.
- Une référence qui inclut des sections sur les instruments musicaux, dont le sistre, et leur contexte archéologique.
Études spécialisées
-
Hans Hickmann – La Musique de l'Égypte ancienne. PUF, 1955.
- Un classique des études sur la musique égyptienne ancienne, incluant des détails sur les instruments de culte comme le sistre.
-
Christiane Ziegler (dir.) – Les Instruments de musique dans l'Égypte ancienne. Louvre éditions, 1979.
- Une publication directement liée aux collections du musée du Louvre, avec un accent sur les sistres conservés dans leurs galeries.
Analyses iconographiques et rituelles
-
Dominique Mallet – Les Instruments de musique dans les scènes de culte égyptiennes. Institut français d'archéologie orientale, 2007.
- Étude approfondie des représentations d’instruments, notamment le sistre, dans l’art religieux égyptien.
-
Rosalie David – Religious Ritual at Abydos. Cambridge University Press, 1981.
- Analyse du rôle des instruments dans les rites funéraires et religieux, avec des mentions des sistres dans le culte d'Osiris et d'Hathor.
Articles académiques
-
Helen Roberts – "The Sistrum in Ancient Egypt." Journal of the American Research Center in Egypt, vol. 15, 1978, pp. 121–133.
- Une analyse détaillée des aspects matériels et symboliques des sistres égyptiens.
-
Beverley Moon – "Hathor’s Sistrum: Sound and Symbol in Ancient Egypt." Studies in Ancient Egyptian Culture, vol. 23, 1994, pp. 45–67.
- Étude des liens entre le sistre et Hathor, avec une exploration de ses significations symboliques.
Catalogues d'exposition
-
Howard Carter – The Tomb of Tutankhamun: Volume II - The Burial Chamber. Cassell, 1933.
- Contient une description des sistres retrouvés dans la tombe de Toutânkhamon, avec des détails précis sur leur fabrication et usage.
-
Christine Cardin (dir.) – Trésors d'Égypte ancienne : Objets du culte et du quotidien. Musée du Caire, 2011.
- Catalogue qui documente les objets religieux, y compris les sistres, et leur signification dans la vie quotidienne et spirituelle.