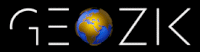- GeoZik
- DOCUS
- KITS
- La musique dans tous ses états
- La voix dans tous ses états
- La danse dans tous ses états
- Le théâtre dans tous ses états
- La littérature orale dans tous ses états
- Archéomusicologie
- Archéochorégraphie
- Instruments du monde
- Matériaux
- Facture instrumentale
- Orchestres
- Communication
- Géographie
- Religion
- Enfance
- Musicothérapie
- Patrimoine UNESCO
- Techniques et modes de vie
- CONF-EXPO
- BLOG
- CONTACT

La harpe angulaire des origines au XVIIe siècle
xxx
La harpe et la lyre dans l’imaginaire collectif
xxx
David, le musicien qui apaise l'âme
La harpe angulaire se distingue par un manche formant un angle marqué avec la caisse de résonance. Elle est également qualifiée de “harpe ouverte” car elle ne possède pas de colonne de renforcement entre l'extrémité du manche et celle de la caisse de résonance.
L'organologie divise les harpes angulaires en deux catégories principales selon leur orientation et leur mode de jeu : les harpes angulaires à positionnement vertical et celles à positionnement horizontal* :
- La harpe à positionnement vertical est soit appuyée contre le corps du musicien, soit inclinée vers l’avant. Les cordes suivent un alignement essentiellement vertical, tandis que le manche s’étend vers l’extérieur à la base de l’instrument.
- La harpe à positionnement horizontal se caractérise par une caisse de résonance maintenue en position horizontale, avec un manche qui s’élève verticalement à l’extrémité opposée par rapport au musicien.
Différences dans le nombre de cordes et le jeu
- Harpe à positionnement vertical : Équipées de 15 à 25 cordes, elles sont généralement jouées en pinçant les cordes avec les doigts. Leur position verticale permet au musicien d’avoir les deux mains libres, puisque l’instrument s'appuie contre son corps.
- Harpes à positionnement horizontal : Dotées de moins de 10 cordes, elles sont parfois jouées à l’aide d’un plectre. Le musicien tient l'instrument sous le bras gauche, laissant la main droite jouer les cordes tandis que la main gauche peut étouffer celles qui ne doivent pas vibrer. Cette technique existe aujourd'hui encore dans le jeu de la lyre simsimyia.
Évolution de la structure au fil du temps
Au cours des premiers siècles, la harpe à positionnement vertical se distinguait par une structure robuste : un corps droit, en forme de colonne, s’élargissant vers le haut, associé à un manche massif. Avec le temps, cette conception a évolué. Le corps de l’instrument s’est légèrement courbé vers l’avant, facilitant le jeu et rendant l’ensemble plus ergonomique.
Des modèles plus légers ont également émergé, avec un manche plus fin qui n’était plus directement fixé à la caisse de résonance. Ce manche descendait légèrement à partir de la caisse et se prolongeait souvent en une extension en forme de queue. Cette configuration permettait à l’instrument de rester stable lorsqu’il était joué en position assise, offrant ainsi davantage de flexibilité au musicien.
_______________
* Le terme "positionnement" fait référence à l’orientation de la caisse de résonance pendant le jeu. il convient de préférer l’expression « harpe à positionnement vertical/horizontal » plutôt que « harpe verticale/horizontale », car l’organologie s'intéresse à la structure de l'instrument, et non à sa positi durant l’utilisation. Un exemple bien connu est celui de la flûte ney, souvent qualifiée de « flûte oblique », bien que ce terme ne désigne que sa position de jeu, laquelle peut parfois être verticale et non oblique. De même, le tambour-sablier tama d’Afrique subsaharienne, surnommé « tambour d’aisselle » en raison de sa tenue sous l’aisselle, alors que d'autres positions de jeu sont employées
Orient antique
La harpe angulaire apparaît aux alentours de 1850 AEC en Mésopotamie et en Iran. Au fil des siècles, elle devient le modèle prédominant au Moyen-Orient, avant de se déployer à travers l'Asie, à l'exception notable de l'Inde.
Les premières représentations de la harpe peuvent être observées dans des œuvres d'art datant des deuxième et premier millénaires AEC, notamment sur des tuiles en terre cuite mésopotamiennes. En Égypte, l’introduction de la harpe angulaire s’est produite environ cinq siècles plus tard, au XVe s. AEC, où elle a coexisté avec diverses types de harpes arquées.
Grèce antique
Dans les peintures sur vase de la Grèce antique, des harpes angulaires à corps courbé apparaissent dès la seconde moitié du Ve s. AEC. La poésie mentionne, dès le début du
VIe s. AEC, un instrument appelé pektis, d’origine lydienne.
Des auteurs attiques ultérieurs évoquent également un instrument à plusieurs cordes appelé trigonon ou trigonos (τρίγωνος, litt. « triangulaire »), qui pourrait
correspondre à la harpe angulaire. Dans le monde hellénistique ultérieur, ce ne sont pas les harpes grecques qui se sont diffusées, mais les harpes angulaires orientales, qui se sont
répandues sous une forme quasi identique et standardisée.
Certaines iconographies montrent des harpes angulaires renforcées par une “colonne”, la faisant passer de statut organologique de harpe ouverte à celle de harpe fermée.
Zone steppique
Lors de fouilles réalisées en bordure de la steppe eurasienne, sur le site de Pazyryk dans l'Altai, ainsi qu’au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, plusieurs harpes remarquablement bien conservées ont été découvertes, datant du Ve au IVe s. AEC. Leur construction et leur forme sont très proches de celles des harpes angulaires horizontales présentes sur les reliefs assyriens datant d’environ 700 AEC. La principale différence réside dans le fait que, contrairement aux harpes assyriennes à neuf cordes, celles retrouvées dans ces régions possèdent cinq cordes. Selon certaines hypothèses, ce type de harpe assyrienne aurait pu se diffuser dans les steppes par l’intermédiaire des Scythes et d’autres peuples nomades équestres.
http://simplearp.free.fr/pages/envois/21orient.html
https://itoldya420.getarchive.net/amp/topics/angular+harps
https://www.bradshawfoundation.com/news/cave_art_paintings.php?id=Musical-depictions-in-Indian-rock-art
https://www.youtube.com/watch?v=yJtIuwARnlY&ab_channel=MIMBrussels
https://www.wikiwand.com/en/articles/Angular_harp