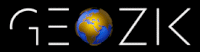- GeoZik
- DOCUS
- KITS
- La musique dans tous ses états
- La voix dans tous ses états
- La danse dans tous ses états
- Le théâtre dans tous ses états
- La littérature orale dans tous ses états
- Archéomusicologie
- Archéochorégraphie
- Instruments du monde
- Matériaux
- Facture instrumentale
- Orchestres
- Communication
- Géographie
- Religion
- Enfance
- Musicothérapie
- Patrimoine UNESCO
- Techniques et modes de vie
- CONF-EXPO
- BLOG
- CONTACT

Le roi David : harpe ou lyre ?
La harpe et la lyre occupent une place singulière dans l’imaginaire collectif, symbolisant à la fois l’harmonie spirituelle et les traditions musicales anciennes. Ces deux instruments, souvent confondus, ont traversé les âges en incarnant des fonctions multiples : accompagnement poétique, médiation spirituelle ou représentation artistique. Du pluricorde (lyre ou harpe) associé au roi David dans la Bible à la harpe des civilisations indienne, khmère ou ottomane, leur présence témoigne d’un riche héritage culturel. Toutefois, des évolutions historiques, techniques et sociales ont conduit à leur déclin progressif, remplacés par des instruments plus adaptés aux besoins musicaux des époques suivantes. Cet article explore l’histoire de ces instruments emblématiques, leurs usages, ainsi que les raisons probables de leur disparition dans trois cultures.
Textes © Patrick Kersalé 2025, sauf mention spéciale. Dernière mise à jour : 9 juillet 2025.
SOMMAIRE
Sujets connexes
La harpe et la lyre dans l’imaginaire collectif

Le roi David, figure emblématique de la Bible hébraïque, est souvent représenté comme un guerrier, un roi et un poète. Mais il est aussi, et peut-être avant tout, un musicien dont le talent a marqué l’histoire biblique et influencé les traditions artistiques et spirituelles. David est fréquemment associé à la harpe (en hébreu nevel נֵבֶל) ou à la lyre (en hébreu kinnor כִּנּוֹר), deux instruments à cordes qui, bien que distincts, sont confondus dans l’imaginaire collectif et plus encore. Dans l'iconographie du Moyen Âge, on le voit également jouer du psaltérion ou de la vièle à archet.
Dans l’Antiquité grecque, la lyre est associée au dieu Apollon, symbolisant l’harmonie et la raison ; la harpe, elle, est plus rarement mentionnée. Au Moyen Âge, les enlumineurs représentaient souvent David avec une harpe, la traduction du terme original étant peu clair ou bien avait déjà été galvaudé. Cette tendance s’est poursuivie à la Renaissance et à l’époque moderne, où la harpe devient l’instrument emblématique du roi David.

Cette confusion reflète peut-être une volonté de simplifier et d’universaliser l’image de David en tant que musicien. La harpe, avec sa forme élégante et son timbre cristallin, est devenue un symbole de spiritualité et de paix, incarnant parfaitement le rôle de David en tant que psalmiste et musicien, apportant la paix à l'âme.
À l'époque prébiblique, avant que les récits de tradition orale ne soient sanctuarisés par l'écriture, la lyre et la harpe avaient probablement une dénomination usitée par les spécialistes et une autre par les gens du commun. Chez les spécialistes, le nom est précis ; dans la culture populaire, on constate une distanciation. Ce phénomène existe de tout temps et dans toutes les aires géographiques. Le nom de l'instrument est parfois attaché à sa fonction. Si un instrument différent assure une fonction précise, il pourra être nommé par le nom de celui qu'il remplace. C'est une explication possible à la confusion régnant entre harpe et lyre.
David, le musicien qui apaise l'âme

Le passage de la Bible mettant en scène David en tant que musicien se trouve dans le Premier Livre de Samuel (1 Samuel 16:14-23) : « Et lorsque l’esprit mauvais venant de Dieu était sur Saül, David prenait la lyre et jouait ; alors Saül se trouvait soulagé et se sentait mieux, et le mauvais esprit se retirait de lui. »
Ce passage est vraisemblablement la plus ancienne citation préfigurant ce qui deviendra la musicothérapie. Il est toutefois peu explicite, et ce à plusieurs égards :
- Est-ce le seul son de la lyre qui apaise Saül ?
- Est-ce une mélodie spécifique ?
- Est-ce à la fois le son spécifique de la corde et la mélodie ?
- Peut-être le roi David accompagnait-il son chant de la lyre ?
À cette époque, la lyre et la harpe sont deux instruments que l'on pourrait qualifier de sophistiqués. Selon la culture et le savoir-faire du musicien, ils permettaient de :
- Jouer une mélodie.
- Jouer une mélodie agrémentée de notes d'accompagnement.
- Accompagner ou auto-accompagner mélodiquement, harmoniquement et rythmiquement le chant.
- Créer des alternances chant / musique instrumentale.
En revanche, la structure de ces deux instruments ne permet pas d'imiter les fioritures vocales telles que le vibrato ou le glissando, c'est pourquoi ils ont disparu de nombreuses cultures, remplacés par des cordophones plus performants et structurellement moins contraignants, comme le luth et la cithare à frettes hautes.
Raisons de la disparition de la harpe
La harpe et la lyre, héritières plus ou moins directes des instruments des temps bibliques, ont soit disparu, soit évolué. La lyre a survécu principalement près des rives de la mer Rouge (en Jordanie, en Égypte...) et en Éthiopie. Quant à la harpe, elle a effectué de longues migrations et s'est transformée en de nombreuses variantes, atteignant des sommets technologiques, notamment avec la grande harpe à pédales d'Occident. Nous nous pencherons ici sur le cas de trois harpes disparues à différentes époques et en diverses zones géographiques :
- La harpe arquée indienne vīṇā a disparu entre les VIIIᵉ et XIIᵉ siècles, remplacée par des luths et des cithares.
- Ce même instrument, importé au Cambodge au début de l'ère commune est demeuré florissant au moins jusqu'au début du XIIIᵉ siècle dans l'Empire khmer parce qu'il a su s'adapter et remplir une fonction à la fois dans les temples hindouistes et bouddhistes (sous le règne du roi Jayavarman VII).
- Le çeng ottoman a été florissant jusqu'au XVIIᵉ s. en Turquie avant d'être détrôné par le luth 'ud.
Nous ne reviendrons pas, dans le développement ci-après, sur les raisons techniques qui ont probablement conduit au remplacement de la harpe pour nous concentrer sur les causes historiques.
Déclin et disparition de l'usage de la harpe vīṇā en Inde
La harpe, connue sous le nom de vīṇā, a joué un rôle important dans la musique classique de l'Inde ancienne. Elle est mentionnée dans des textes anciens comme le Rig-Veda et le Sama-Veda, où elle est associée à des rituels et à des pratiques musicales sacrées. Des sculptures et des représentations artistiques, comme celles des temples de Sanchi et Amaravati, montrent des harpistes, attestant de son importance dans la culture musicale de l'époque.
Elle a progressivement disparu du paysage musical indien, avec un déclin marqué principalement entre le VIIIᵉ et le XIIᵉ siècles. Ce déclin s'explique par diverses raisons liées à l'histoire tumultueuse du sous-continent à l'époque médiévale tardive (XIIᵉ-XVIᵉ siècles). Par ailleurs, la structure de l'instrument interdisant, du fait de sa technologie, l'imitation possible de certaines techniques vocales comme le vibrato et le portamento, joue également un rôle dans ces disparitions, phénomène observé à des périodes variées à travers le monde.
Nos connaissances sur le déclin et la disparition de l'usage de la harpe vīṇā en Inde se basent à la fois sur la présence ou l'absence de la harpe dans l'iconographie et les textes.
L'iconographie (sculptures et peintures) des périodes anciennes, notamment sous les Gupta (IVᵉ-VIᵉ siècles), montre des représentations de la harpe (vīṇā ou vipanchi vīṇā). Cependant, ces représentations deviennent rares à partir de la période médiévale. Les sites tels qu'Ajanta et Ellora présentent des fresques illustrant des harpes, mais ces instruments ne sont plus représentés dans l'art postérieur des dynasties Chola ou Moghol, indiquant un déclin.
Des textes anciens comme le Nāṭya śāstra नाट्य शास्त्र (IIᵉ s. AEC - IVᵉ s. EC) mentionnent la harpe parmi les instruments de musique, mais les traités postérieurs comme le Saṃgītaratnākara संगीतरत्नाकर (XIIIᵉ s.) mettent davantage l'accent sur d'autres instruments tels que le sitar et le tanpura. Cette transition reflète un changement dans les préférences musicales et les instruments utilisés. Les invasions et influences islamiques entre le VIIIᵉ et le XIIᵉ siècles ont introduit des instruments persans comme le rabâb et ont remodelé les pratiques musicales. Les instruments traditionnels comme la harpe semblent avoir été progressivement remplacés. Pour plus de détails, consultez notre article La harpe arquée en Inde (SOA).
Déclin et disparition de la harpe vīṇā dans l'Empire angkorien
Notre site web associé soundsofangkor.org est la première source d'information mondiale sur la harpe khmère, une recherche qui nous a occupé durant plus d'une décennie ! Pour plus de détails, consulter nos articles consacrés à la harpe arquée au Cambodge (SOA).
Le premier témoignage de l'existence de la harpe sur le territoire de l'actuel Cambodge remonte au IIᵉ siècle EC, attestée par une représentation sur un médaillon retrouvé dans un cimetière. L'ultime témoignage, relié à la période angkorienne, date du début XIIIᵉ s. EC à travers les sculptures du Bayon. La mémoire de la harpe a toutefois perduré jusqu'au temps présent (forme générale et nom khmérisé), un instrument que nous dénommons “harpe postangkorienne". Nous ignorons toutefois quand l'instrument a disparu, dans quelles conditions et par quoi il a été immédiatement remplacé. L'hypothèse que nous pouvons émettre est qu'il s'est probablement raréfié à partir du XIVᵉ s., période d'émergence du bouddhisme theravāda où aucun instrument de musique n'accompagnait la cantillation des moines. Une peinture, provisoirement datée du XVIᵉ s. par nous-même, dans le sanctuaire bakan du temple d'Angkor Vat, montre un orchestre composé de percussions mélodiques et de tambours. Cet orchestre, probablement venu du royaume du Siam ou inspiré par lui, a remplacé l'orchestre à cordes angkorien. Sa efficacité acoustique est indéniable comparativement à l'orchestre à cordes.
On pourrait se poser la question à propos de la "magie de la harpe" remplacée par des instruments à percussion. Il n'en est rien à notre avis. En effet, la harpe n'était probablement qu'un instrument d'accompagnent, la mélodie étant jouée par la cithare monocorde. Par ailleurs, et nous l'avons testé dans les temples angkoriens, le son des instruments à cordes était supplanté par les voix et les percussions, toujours présentes dans les orchestres. À cette époque, et dans le contexte religieux, la musique de la harpe n'a pas vocation à charmer ou apaiser l'âme, mais à animer la danse des danseuses sacrées communiquant avec les divinités de l'hindouisme puis du bouddhisme sous le règne du roi Jayavarman VII. Aussi, le remplacement des cordes par des percussions mélodiques a permis de porter spatialement plus loin le son.
Déclin et disparition de la harpe çeng dans l'Empire ottoman
Le çeng puise ses origines dans les civilisations anciennes. Des représentations d'instruments similaires chez les assyriens et les égyptiens sous la dynastie lagide. En organologie, cette harpe est qualifiée d'angulaire.
L'ancêtre direct du çeng ottoman est le çeng iranien, qui a été introduit dans l'Empire ottoman et a subi des modifications locales. Au fil du temps, il est devenu un instrument emblématique de la culture ottomane, notamment entre les XVᵉ et XVIIᵉ siècles. Des manuscrits persans du XIVᵉ siècle, comme le Kenzü't-Tuhaf, ainsi que des œuvres poétiques comme le Çengname d'Ahmed-i Dâî, témoignent de son importance culturelle et artistique.
Dans l'Empire ottoman, le çeng était un instrument joué aussi bien par des hommes que par des femmes. Il accompagnait des récitations poétiques, des discussions savantes et des cérémonies soufies ; sa musique était considérée comme un moyen de transcendance spirituelle. Les miniatures ottomanes, comme celles du Süleymanname ou du Surnâme-i Hümâyûn, montrent le çeng dans des contextes variés, reflétant son rôle central dans la vie culturelle de l'époque. Notons toutefois que certains auteurs doutent de l'usage de cet instrument à la cour car les producteurs des miniatures sus-citées n'avaient pas accès aux cercles du pouvoir, se contentant de représenter une cour fantasmée. Le mystère demeure donc.
Le çeng connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Depuis la fin du XXᵉ siècle, des artisans et des musiciens, comme Fikret Karakaya en Turquie, ont reconstruit l'instrument en s'inspirant de descriptions historiques et des miniatures anciennes. Aujourd'hui, des harpistes comme Şirin Pancaroğlu explorent ses possibilités musicales, fusionnant traditions anciennes et innovations modernes.
Pour plus de détails sur la harpe angulaire, consultez notre article La harpe angulaire.
Le kinnor : harpe ou lyre ?
Dans son ouvrage "Music un Ancient Israel*", Alfred Sendrey évoque le difficulté qu'ont les chercheurs à se positionner sur la nature du kinnor.
Le point de vue de quelques chercheurs
Le texte traite des débats sur la nature de cet instrument biblique de l’Antiquité hébraïque. Les avis divergent : certains pensent qu’il s’agissait d’un luth ou d’une guitare (sic), d’autres d’une harpe. Fétis, s’appuyant sur des sources classiques, assimile le kinnor au trigonon portatif à neuf cordes, mais Aristoxène distingue clairement le trigonon d’autres instruments à cordes comme l’enneachordon, une lyre à neuf cordes. Athénée, citant Aristoxène, considère plusieurs instruments à cordes comme étrangers, dont le trigonon. Ambros partage l’avis de Fétis, mais Weiss objecte que le peuple israélite, connaissant les harpes égyptiennes puissantes, n’aurait pas choisi un instrument aussi peu sonore que le trigonon.
Ce dernier serait d’origine syrienne, et les Israélites, en contact avec les Syriens, auraient pu adopter le kinnor par ce biais. En Égypte, une harpe triangulaire à neuf cordes appelée kinnyra existait, mais elle n’était pas identique au trigonon syrien. Portaleone décrit le kinnor comme une harpe à quarante-sept cordes, ce qui paraît peu plausible pour un instrument portable. La recherche moderne penche plutôt pour une parenté du kinnor avec la cithare grecque (kithara), opinion fondée sur la traduction de la Septante et des représentations antiques égyptiennes et assyriennes. Des images de kithara apparaissent dans les tombes égyptiennes et sur des monuments assyriens, où elles sont souvent associées à des captifs sémites.
Weiss conclut que la kithara n’est pas d’origine égyptienne, mais sémitique, et que son usage était répandu en Asie. Les Grecs la désignaient parfois comme « lyre asiatique ». Plutarque mentionne que les harpistes de Lesbos utilisaient toujours cette « harpe asiatique ». Des monnaies juives de l’époque de Simon montrent des kinnor proches de la kithara grecque. Ces représentations pourraient refléter la forme authentique du kinnor, car les traditions instrumentales juives sont restées très conservatrices. Cependant, Bathja Bayer avertit qu’il ne faut pas exagérer l’immuabilité de l’Orient : les instruments peuvent évoluer. Selon elle, la lyre du roi David serait celle représentée sur un vase philistin de Megiddo.
Un commentaire du XIIᵉ siècle d’Abraham ibn Ezra décrit le kinnor comme ayant la forme de la menorah, ce qui rappelle la cithare asiatique. Les monnaies de Bar Kokhba montrent une caisse de résonance volumineuse. Les Pères de l’Église décrivent la caisse du kinnor "en bas", celle du psaltérion "en haut", et utilisent divers termes pour la désigner. Ils divergent aussi sur le jeu au plectre. Jérôme affirme que la kithara avait six cordes, certaines chantantes, d’autres bourdonnantes. Une lettre apocryphe lui attribue vingt-quatre cordes et une forme triangulaire, ce que reprend Isidore de Séville, qui assimile le kinnor à la "cithare barbare".
Chrysostome distingue le mouvement de la kithara (par le bas) et du psaltérion (par le haut), ce qui pourrait concerner la façon de jouer. Sachs note que le terme kinnor désignait aussi la lyre en Égypte.
Malgré l’unanimité sur le fait que le kinnor est un instrument à cordes, Movers propose qu’il ait pu désigner un instrument à vent, s’appuyant sur des passages bibliques évoquant la musique funèbre. Cependant, cette hypothèse est réfutée : les deux passages utilisent des métaphores différentes. Les rabbins emploient le verbe « frapper » pour jouer du kinnor, ce qui pourrait indiquer l’usage du plectre, comme le rapporte Josèphe. Certains pensent que le peuple utilisait le plectre tandis que les Lévites jouaient à mains nues, mais cela semble peu probable.
Les cordes, appelées minnîm ou yeter, étaient en boyau de mouton ou fibres végétales, jamais métalliques. Les descriptions patristiques divergent parfois, mais il est clair que le kinnor était un instrument à cordes, probablement proche de la lyre ou de la kithara, avec des variations de forme et de jeu selon les époques et les usages.
______________
*Sendrey, Alfred. Music in Ancient Israel. New York : Philosophical Library, 1969.
Le point de vue de l'archéo-ethno-musicologie
Du point de vue de l'archéomusicologie, la fiabilité de la transmission des noms d’instruments dans l’Ancien Testament est une question complexe, qui dépend de nombreux facteurs culturels, linguistiques et historiques. Pour la majorité des gens de l’époque biblique, la distinction entre des instruments comme la harpe et la lyre, ou entre le kinnor et le nebel, était souvent imprécise, voire inexistante. À l’écoute, ces instruments à cordes produisaient des sonorités semblables, rendant difficile leur différenciation pour des oreilles non expertes. Un « multicorde » était simplement perçu comme tel, sans que l’on s’attache à préciser sa structure exacte. Seuls les spécialistes, tels que les Lévites ou les musiciens de cour, possédaient une connaissance fine des nuances techniques. Pour le reste de la population, ces instruments étaient surtout associés à leur fonction rituelle ou festive, et non à leur construction organologique.
Les rédacteurs de l’Ancien Testament ont travaillé à partir de traditions orales ou écrites dont la précision variait selon la compétence des informateurs. Les prêtres et musiciens du Temple avaient une connaissance approfondie des instruments sacrés, mais les récits populaires ou les traditions locales, transmis sur plusieurs générations, pouvaient simplifier ou déformer les termes. Les scribes, selon leur époque et leur origine, adaptaient aussi le vocabulaire à leur propre contexte culturel. Par exemple, le nebel, décrit comme une « outre » en hébreu, a été traduit par psaltérion dans la version grecque de la Bible, la Septante, peut-être en raison d’une assimilation à des instruments connus dans le monde hellénistique.
Au fil du temps, chaque génération et chaque communauté a réinterprété les termes instrumentaux selon son propre cadre de référence. Par exemple, le terme araméen pesanterin, utilisé dans le Livre de Daniel, dérive probablement du terme persan santir ou santur (سنتور), un instrument à cordes frappées, mais il a été traduit par psaltérion en grec puis psalterium en latin, assimilant ainsi l’instrument à un outil familier des traducteurs, bien qu'organologiquement différent. Jérôme ou Eusèbe, ont aussi décrit le nebel comme une « cithare » (psalterium), projetant sur l’instrument biblique leur connaissance des instruments romains de leur époque. Cette réinterprétation n’est pas une falsification, mais une contextualisation nécessaire pour rendre le texte accessible à leur public.
En conséquence, le vocabulaire des instruments dans la Bible est moins une nomenclature fixe qu’un processus dynamique de transmission. Chaque génération actualise le lexique en fonction de ses propres références culturelles et musicales. Dans les textes sacrés, la précision technique est souvent secondaire par rapport au rôle symbolique de l’instrument. Par exemple, le kinnor de David est avant tout associé à la louange divine, indépendamment de sa forme exacte.
Ainsi, la transmission des noms d’instruments dans l’Ancien Testament a été influencée par des imprécisions liées aux différences culturelles, par des adaptations linguistiques au fil du temps, et surtout par la volonté de privilégier le sens symbolique ou religieux de l’instrument plutôt que sa description technique précise. Les termes comme kinnor ou nebel sont moins des étiquettes techniques que des concepts évolutifs, modelés par les besoins narratifs et cultuels des communautés qui les ont transmis. Cette plasticité n’invalide pas la valeur historique de ces termes, mais invite à les analyser comme des témoignages culturellement situés, plutôt que comme des descriptions objectives. Ainsi, l’adaptation des noms d’instruments au fil du temps révèle le dialogue constant entre traditions sacrées et réalités locales, un processus universel dans l’histoire des textes anciens.
Du point de vue de ethnomusicologie internationale, l’expérience montre que les instruments de musique, objets technologiques complexes, portent des noms qui restent souvent obscurs pour la plupart des gens. Ainsi, un même terme peut désigner des instruments variés, tandis que des appellations différentes peuvent parfois s’appliquer un même instrument.